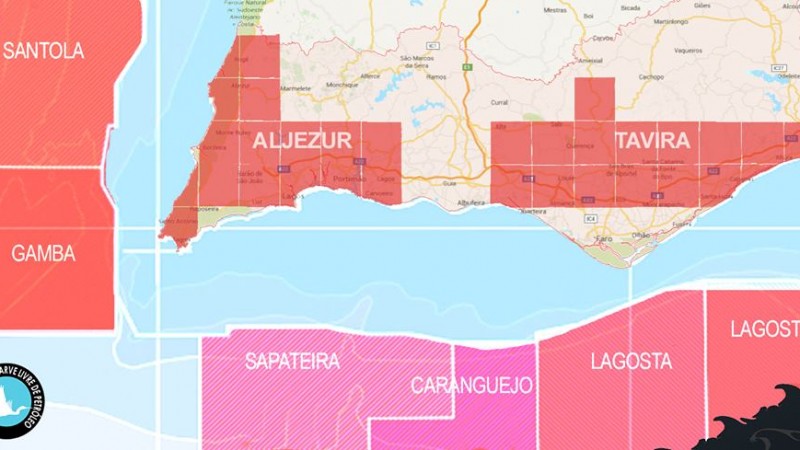Le racisme anti-noir en Inde de nouveau à la une après le lynchage d'un Congolais
vendredi 10 juin 2016 à 11:34
Des lyncheurs ont battu sans pitié trois étudiants nigériens à Delhi en septembre 2014. Capture d'écran de la vidéo No country for black men.
Il y a quelques semaines, Mason Kitanda Olivier, un jeune homme de 23 ans originaire de la République démocratique du Congo a été battu à mort par trois hommes dans le quartier de Vasant Kunj dans le sud de Delhi. Olivier était parti en Inde pour ses études universitaires et avait récemment commencé à enseigner le français dans un institut privé. Ses assaillants auraient proféré des insultes racistes au moment de s'en prendre à lui.
C'est loin d'être le seul cas récent de violence contre des individus originaires du continent africain en Inde. Le 25 mai, un étudiant nigérian de 26 ans, Bamilola Kazim, a été frappé avec une barre de fer après une altercation avec un habitant de la ville d'Hyderabad au sujet d'une place de parking. Il a été soigné dans un hôpital local puis autorisé à sortir.
En janvier, une Tanzanienne de 21 ans qui étudiait en Inde a été frappée, déshabillée et exposée nue dans les rues de Bangalore par la foule qui pensait à tort qu'elle avait renversé et tué une de leurs concitoyennes. Trois de ses amis ont également été attaqués et on a mis le feu à la voiture dans laquelle ils circulaient. Après en avoir fini avec eux, la foule enragée s'est dirigée vers les maisons où logent les étudiants africains et s'en est pris à eux.
Au cours des dernières années, des attaques similaires ciblant des ressortissants de pays africains et des personnes d'ascendance africaine ont fait très régulièrement les gros titres. Alors, cela signifie-t-il que l'Inde a un problème de racisme avec les Africains ?
Pas si vous le demandez à Sushma Swaraj, ministre des Affaires étrangères indienne, qui s'est montrée réticence à qualifier le meurtre de Masonga Kitanda Olivier de raciste. Swaraj a assuré que l'attaque avait été perpétrée par des éléments asociaux et a soutenu que donner à l'affaire une connotation raciste ne serait pas juste envers le peuple indien, qui croit pour l'essentiel en une coexistence harmonieuse.
I would like to assure African students in India that this an unfortunate and painful incident involving local goons.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 25 May 2016
Je voudrais assurer aux étudiants africains en Inde que ceci est un incident pénible et regrettable qui implique des idiots du coin.
La ministre s'est tournée vers Twitter pour inciter les Indiens à déclarer aux Africains que l'Inde les aimait et à leur serrer la main. Toutefois, beaucoup ont trouvé cela naïf et hypocrite étant donné les violences récentes contre des ressortissants africains ainsi que les discriminations qui perdurent dans certains secteurs de la société indienne.
Even after 70 years of Independence, we can't even make the Indians love each other, and they want us to tell Africans that we love them.
— Mr. Tippler (@MrTippler) June 2, 2016
Même après 70 ans d'indépendance, nous ne parvenons pas à ce que les Indiens s'aiment les uns les autres, et ils veulent que nous disions aux Africains que nous les aimons.
@SushmaSwaraj Maybe we shd work on better awareness and not superficial steps. Besides, rights shd not depend on love. #AfricaIsNotACountry
— Mihira Sood (@mihira_sood) 2 June 2016
Peut-être devrions-nous œuvrer à une plus grande prise de conscience au lieu d'avancées superficielles. De plus, les droits ne devraient reposer sur l'amour.
me: India loves you
African citizen: Africa isn't a country https://t.co/UQbY0tPLmR— fluffy (@curiousgawker) 2 de junio de 2016
moi : l'Inde vous aime
l'Africain : l'Afrique n'est pas un pays
@SushmaSwaraj Better still. Urge fellow Indians to not be racist and xenophobic. Let's truly change who we are. @apercevoir
— Harish Subramanian (@HarishSub) 2 June 2016
Encore mieux. J'encourage mes compatriotes indiens à ne pas être racistes et xénophobes. Changeons réellement notre être.
Say “India loves you,” then, to Muslims, Dalits, Africans, seculars…and go right back to kicking them in the face? https://t.co/sGXaArGadM
— Nehr-who? (@threeinchfooll) 2 June 2016
Dites « l'Inde vous aime » aux musulmans, aux Dalits [intouchables], aux Africains, aux pro-laïcité … et remettez-leur tout de suite après votre poing dans la figure ?
Une minorité de personnes sur Twitter ont semble-t-il néanmoins considéré que c'était une bonne idée.
@SushmaSwaraj tried it the kenyan guy was so happy…told me how so many indians work in kenya and how much they are respected there felt gd
— Bharathsnayanar (@Bharathsnayana1) 5 June 2016
J'ai essayé, le mec kenyan était tellement content … Il m'a dit que de nombreux Indiens travaillaient au Kenya et à quel point ils étaient respectés là-bas, ça m'a fait du bien.
To all fellow Africans,
India loves you.— टिंपाटराव (@manya747) 2 June 2016
A tous mes camarades africains,
l'Inde vous aime.
Les « grossiers stéréotypes sur les Africains datant de l'époque coloniale »sont toujours là
Les Africains et leurs gouvernements ne sont pas restés muets après les récentes attaques. Selon Al Jazeera, un groupe d'ambassadeurs africains s'est réuni pour défendre les ressortissants de leurs pays respectifs en Inde, qu'ils estiment vivre dans un « climat croissant de peur et d'insécurité » suite à la série d'attaques visant des individus africains. Ils ont averti que, si celles-ci continuaient et que leurs auteurs restaient impunis, ils feraient pression auprès de leurs gouvernements respectifs pour qu'ils n’envoient plus d'étudiants en Inde.
Ce n'est pas la première fois que le sujet préoccupe les diplomates africains. En 2015, avant la troisième édition du sommet Inde-Afrique, les ambassadeurs de pays africains à New Delhi auraient envisagé de boycotter la journée mondiale de l'Afrique, organisée tous les ans par le Conseil indien des relations culturelles à Delhi, en raison de la xénophobie subie par les ressortissants en Inde.
40 envoys almost boycott Africa Day
Africans go on camera recounting racism in India.
And minister blames media.
Enough said.— Madhavan Narayanan (@madversity) May 30, 2016
40 ambassadeurs sur le point de boycotter la Journée de l'Afrique.
Des Africains racontent devant les caméras le racisme en Inde.
Et la ministre s'en prend aux médias.
Tout est dit.
Des Africains ont relaté leur expérience du racisme à différents médias. Dans un article pour Scroll.in daté du 4 juin, une étudiante sud-africaine [indienne] originaire d'Asie du Sud-Est décrit les formes subtiles que prennent les stéréotypes raciaux et culturels en vigueur en Inde :
It was also not uncommon for many students to have conversations with me, which they assumed were progressive, about Africa and Africans that were based on crude colonial stereotypes of Africans as being close to nature, having a good sense of rhythm or even, and possibly the most colonial, having big penises. While many of the students at JNU had an impressively extensive knowledge of their own colonial, independence and post-independence cultural, political, social and religious, and regional histories, as well as knowledge of western theory and philosophy, and were committed to an idea of Left politics that took ideas like South-South solidarity seriously, their knowledge of African social, political and cultural histories as well as present realities was limited.
Il n'était pas rare non plus pour de nombreux étudiants d'avoir une conversation avec moi, qu'ils jugeaient progressiste, sur l'Afrique et les Africains, et qui reposait sur de grossiers stéréotypes sur les Africains datant de l'époque coloniale comme quoi ceux-ci étaient proches de la nature, avaient le rythme dans le sang et même, probablement le stéréotype qui renvoie le plus au colonialisme, avaient de gros pénis. Si un grand nombre d'étudiants de JNU [l'université Jawaharlal-Nehru à New Delhi] possédaient des connaissances incroyablement étendues sur leur propre histoire coloniale, celle de l'indépendance et de la post-indépendance sur les plans culturel, politique, social et religieux y compris au niveau régional, ainsi que des connaissances sur les théories et la philosophie occidentales, et étaient attachés à l'idée d'une politique de gauche qui prendrait au sérieux des conceptions telles que la solidarité sud-sud, ce qu'ils savaient de l'histoire sociale, politique et culturelle de l'Afrique ainsi que de ses réalités contemporaines était limité.
Des manifestations ont également eu lieu. Par exemple, après le meurtre d'Obodo Uzoma Simeon, un citoyen nigérian de 36 ans, devant un restaurant africain de Parra dans l'Etat de Goa en 2013, plus de 50 Nigérians ont bloqué l'autoroute. Ils ont arrêté le corbillard qui transportait Simeon et ont traîné son corps sur la route afin d'attirer l'attention sur l'affaire et empêcher toute tentative de dissimulation du meurtre.
En dépit de cela, les autorités ont réagi à la contestation par l'adoption de mesures répressives contre les Nigérians sans-papiers, une campagne qui semble seulement avoir accentué l'hostilité vis-à-vis des Africains. Les prises de position négatives se sont poursuivies après le meurtre de Masonga Kitanda Olivier. En réaction à un cas présumé de viol impliquant un ressortissant nigérian, le ministre du Tourisme de Goa a accusé publiquement les Nigérians de commettre des crimes dans le but de prolonger leur séjour en Inde. « Nous devrions avoir une loi stricte pour pouvoir les expulser. Mais il n'existe malheureusement pas de telle loi en Inde aujourd'hui, a-t-il déclaré.
Il fait peu de doute que la vague d'agressions contre des Africains a discrédité l'Inde aux yeux de la communauté internationale et mis à mal ses relations avec les pays africains. Afin de remédier à cette situation inquiétante, Sushma Swaraj s'est efforcée d'apporter des garanties aux ambassadeurs des Etats africains tout comme à leurs ressortissants en Inde. Un groupe d'étudiants africains a par conséquent annulé une manifestation dans la capitale indienne.
Reste à espérer que le pays s'engagera rapidement sur la voie de la paix et de la sécurité pour les Africains comme pour les communautés marginalisées en Inde.