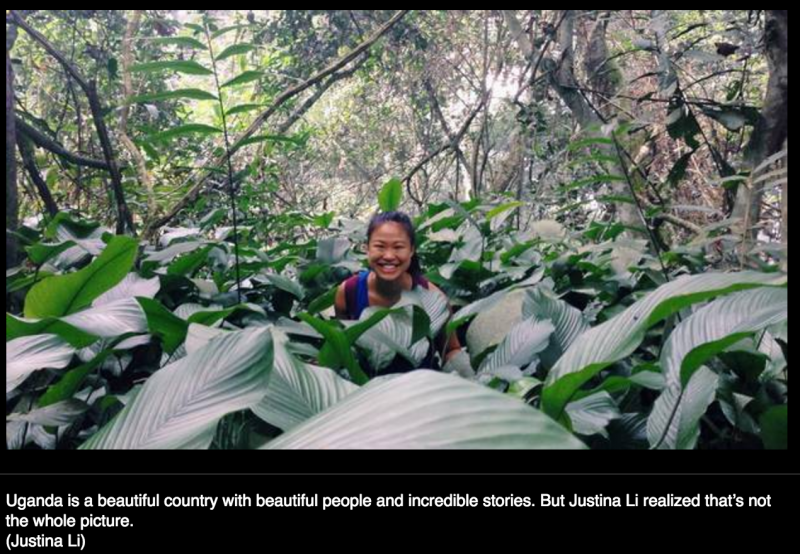Un Palestinien documente sur Snapchat les périls de la vie sous occupation
lundi 12 juin 2017 à 12:11
Inscription : ‘Danger – zone de tirs, interdit d'entrer.’
Image prise dans une zone désertique de Cisjordanie.
La commémoration par les Palestiniens de 50 ans d'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza le 5 juin nous rappelle l'angoisse, la détresse et les inimaginables injustices qu'ils doivent subir depuis ce qui ressemble déjà à une éternité.
Elle nous rappelle que l'adversité affrontée par les Palestiniens n'est pas seulement une force agissante qui définit leurs vies quotidiennes et dicte leurs moindres gestes, c'est aussi la lente descente quotidienne vers l'indifférence, voire l'oubli total de la part du monde extérieur. L'article qui suit raconte l'histoire d'un homme palestinien muni d'une caméra et d'un sac à dos, qui essaie de créer une mémoire permanente de ce qui constitue cette adversité.
Si la plupart des nouvelles provenant des Territoires Occupés évoquent le spectre de l'hostilité ou de la désespérance, il existe un Palestinien de Cisjordanie qui voudrait changer le portrait du territoire, tout en offrant aux gens un aperçu de la riche culture, des fascinantes traditions et de l'histoire glorieuse de cette terre.
Ceux qui regardent ses films n'en voient pas moins la brutalité de l’occupation subie de plein fouet par les habitants de la Cisjordanie. Si certaines de ses excursions se passent plutôt bien, l'aventureux jeune homme rencontre de nombreux et dangereux obstacles en parcourant un environnement qui menace constamment sa vie.
Motasem Ilaiwi est un jeune Palestinien d'une vingtaine d'années, originaire de Naplouse en Cisjordanie.
Ilaiwi s'est gagné une grande attention positive dans la région avec ses vidéos colorées et informatives, qu'il partage sur Snapchat (sous le nom de ps.live), et dans lesquelles il visite les nombreuses pittoresques cités de la Cisjordanie, offre des leçons d'histoire impromptues sur les endroits où il passe, et souligne la résilience des Palestiniens face à la répression.
En dépit du caractère positif de ses vidéos, Ilaiwi insiste aussi sur la rudesse de la maltraitance, la discrimination forcenée, et les méthodes brutales utilisées par les Forces de Défense israéliennes (IDF) contre les habitants de la Cisjordanie.
Le thème central de ses expéditions est la ségrégation institutionnalisée. Dans la vidéo ci-après, Motasem est intercepté par des policiers israéliens parce qu'il marche sur une route réservée – ce qu'il ignorait – aux citoyens israéliens.
Pendant toutes ses vadrouilles, Ilaiwi circule dans l'ombre des IDF, qui ont tué tant de ses compatriotes Palestiniens.
Israël exerce notoirement depuis longtemps un contrôle oppressif sur la Cisjordanie, et applique des mesures discriminatoires contre les citoyens palestiniens, avec des postes de contrôle militaires, des routes séparées pour Palestiniens et Israéliens, et des restrictions d'accès aux commodités de base.
Tandis que les critiques d'Israël estiment que ce système ressemble de façon frappante à l'Afrique du Sud de l'apartheid, l'ancien ambassadeur aux Etats-Unis Michael Oren affirme, lui, que la “large majorité des colons et des Palestiniens choisissent de vivre séparés à cause de leurs différences culturelles et historiques, et pas de la ségrégation…Les routes séparées ont été créées en riposte aux attentats terroristes — pas pour ségréguer les Palestiniens, mais pour sauver les vies juives.”

Ilaiwi passe par le camp de réfugiés d'Aida, à environ deux kilomètres au nord de Bethléhem. Source: Facebook.
En avril 2016, une mère palestinienne de 24 ans et son frère de 16 ans ont été abattus parce qu'ils marchaient sur la voie des véhicules au lieu de celle des piétons. Maram Saleh Abu Ismael se rendait à Jérusalem, elle venait d'obtenir le permis pour entrer dans la ville.
Les soldats de l'IDF leur auraient crié après en hébreu, supposément pour leur ordonner de quitter la chaussée, mais comme Maram ne parlait pas cette langue, elle s'est figée de peur. Les soldats ont réagi en tirant sur elle et sur son frère Ibrahim Taha quand il a couru à son secours.
Les forces d'occupation ont maintenu que Maram, qui s'est vidée de son sang, portait un gilet explosif, mais il a été révélé par la suite qu'elle était enceinte.

Ilaiwi à Hébron. Source: Facebook.
Quand Global Voices a demandé à Motasem quels dangers particuliers il rencontre et comment il s'en prémunit, il a répondu que “provoquer” les soldats israéliens à lui tirer dessus est l'une de ses craintes principales.
Et la ville la plus dangereuse où il s'est rendu ? Sans hésitation, Hébron.
Essentiellement, explique-t-il, à cause de la présence militaire renforcée et de l'hostilité générale des colons israéliens dans la ville. Impossible d'éviter les implantations à Hébron, ajoute-t-il, et il est extrêmement difficile de se frayer un chemin qui ne conduise pas à une rencontre avec les IDF.
Lors d'une de ses visites dans cette ville au sud de Jérusalem, il a trouvé le Caveau des Patriarches, ou Mosquée d'Abraham, bouclé par l'armée israélienne à cause d'une fête juive se déroulant dans le voisinage de la mosquée. Les Israéliens avaient mis la musique à fond, les enfants s'amusaient et les gens dansaient, pendant que les Palestiniens regardaient du haut de leurs terrasses. Ilaiwi grimpa sur une des terrasses pour filmer la scène via Snapchat.
La vidéo présente une juxtaposition affligeante, mais ne fait qu'effleurer la surface des injustices dans la région. La famille qui avait accueilli Ilaiwi chez elle pour qu'il puisse filmer lui a dit avoir reçu le jour même une lettre des IDF leur notifiant qu'ils allaient aussi devoir squatter leur terrasse, dans le cadre de leurs opérations de surveillance.
Hébron connaît une multitude d'agressions de colons contre les Palestiniens, depuis les jets d'ordures et de pierres jusqu'aux voitures-bélier.
L'armée israélienne rejette régulièrement ces affaires, traitées comme des accidents, même lorsque des témoins attestent que la collision semblait délibérée. En avril dernier, Middle East Monitor (MEMO) a rapporté au moins trois incidents de colons-chauffards à Hébron, avec des enfants parmi les victimes. Des incidents qui paraissent renforcer l'affirmation de nombreux critiques qu'Israël jouit d'une ‘culture de l'impunité’.
En août 2016, Israël a provoqué indignation et polémique en annonçant son intention d'étendre les quartiers juifs à Hébron, où vivent environ 30.000 Palestiniens et 1.000 Israéliens.
Une vie d'assiégés
Ilaiwi choisit d'emprunter des routes de montagnes plutôt que les voies principales, et adopte de temps en temps le comportement et l'attirail vestimentaire d'un touriste occidental. Il alterne le port de la casquette, de la casquette à rabat voire du tarbouche, en plus d'un grand sac à dos de campeur. Au contact des soldats israéliens, il parle anglais, convaincu qu'ils peuvent être facilement bernés car beaucoup ne parlent pas cette langue.
D'après un rapport de l'ONG Defence for Children International, 264 enfants palestiniens au total ont été tués par des tirs au hasard des forces israéliennes entre 2000 et 2017, un nombre qui n'inclut pas les victimes de bombardements aériens ou terrestres.
Le rapport 2016/2017 d'Amnesty International sur Israël et les Territoires Occupés a confirmé que les forces israéliennes (agents de sécurité, policiers, soldats) ont tué illégalement au moins 98 Palestiniens en Cisjordanie, huit à Gaza, et trois en Israël. Le plupart de ces victimes, dont des enfants, ne représentaient aucune menace immédiate.
Ilaiwi a déclaré à Global Voices :
Je jure devant Dieu que je n'ai absolument aucun problème avec les Juifs, j'en ai plutôt avec les mentalités qui envisagent le monde uniquement en termes d'armes, de guerre, de vol et de destruction. Très sincèrement, j'ai pitié d'eux plus que je ne les méprise [les forces israéliennes]. Je pense dans mon for intérieur, quelle tristesse que de grandir dans une communauté qui encourage la violence et vomit la haine. Je suis reconnaissant d'être du côté des victimes dans ce contexte, comme je détesterais devoir grandir au milieu d'une mentalité qui justifie et est responsable du meurtre d'enfants et de la destruction d'habitations en toute impunité.