
L'association Coalition pour stopper les violences faites aux femmes a organisé une manifestation sous le slogan “Arrêtons de fermer les yeux sur la violence” à Erevan, le 25 novembre 2016. (Photo réalisée par Photolur)
Le texte qui suit est une adaptation d'un article écrit par Armine Avetisyan, initialement publié sur notre site partenaire OC Media.
Armine (nom d'emprunt) s'est mariée deux fois. Son premier mariage n'a duré que quelques jours parce qu'elle a découvert que son mari et la belle-mère de son mari entretenaient une relation intime et se servaient du mariage comme couverture.
Cinq ans plus tard, elle rencontre un autre homme et part en Russie avec lui. Elle ne disposait pas de permis de séjour et devait donc rester à la maison. Quand il rentrait du travail le soir, il cherchait toujours une raison pour se disputer avec elle et lui donner des coups.
“Il m'a frappée avec une chaise, avec de la vaisselle. Il a déchiré mes vêtements, m'a encore frappée et m'a obligée à coucher avec lui. Un jour, je me suis même évanouie à cause de la douleur, et il m'a alors balancé de l'eau au visage”, raconte-t-elle.
Pendant sa grossesse, la vie d'Armine a connu un certain retour au calme. Cependant, après la naissance de son enfant, le niveau de violence s'est encore aggravé. Lorsque son mari voulait avoir des rapports sexuels avec elle, elle lui demandait d'utiliser un préservatif. Mais cela le mettait encore plus en colère, et il refusait systématiquement. Armine est tombée enceinte quatre fois et a avorté à chaque fois. Elle n'avait pas d'argent pour acheter un moyen de contraception et c'est son mari qui lui procurait les médicaments nécessaires pour avorter.
“Un jour, une personne de notre entourage est venue nous rendre visite. Je lui ai tout raconté et cette personne m'a alors aidée à m'échapper. À la nuit tombée, j'ai fui la maison avec mon bébé, je me suis précipitée à l'aéroport et je me suis envolée pour l'Arménie”, confie-t-elle.
L'humiliation et le silence
Le viol conjugal et les violences sexuelles touchent de nombreuses femmes en Arménie. Alors que les modifications apportées à la loi étaient censées améliorer la situation, de nombreuses militantes affirment que le problème de la violence sexuelle demeure grave et que les femmes qui en sont victimes ne bénéficient que de très peu de protection.
Comme beaucoup de victimes de violences sexuelles, Armine n'est pas allée porter plainte à la police, car elle sait que cela aurait été inutile. Elle craint également que son mari aurait alors chercher à se venger.
Armine ajoute : “Les gens me diraient : ‘comment se fait-il que vous ne soyez arrivée à vivre avec aucun des deux hommes ? Vous êtes coupable. Votre comportement est immoral’”.
Selon les données fournies à OC Media par la police arménienne, il n'y aurait eu que 112 cas de violences sexuelles perpétrées à l'encontre des femmes en 2016, et le nombre officiel tombe à 94 en 2017.
Mais cela ne traduit pas nécessairement une diminution des violences sexuelles. Zara Hovhannisyan, militante de l'association Coalition pour stopper les violences faites aux femmes [qui lutte contre les violences faites aux femmes] affirme que la réticence des femmes à porter plainte auprès des services de police s'explique par leur peur de l'humiliation du fait de ces violences sexuelles subies, un sujet tabou en Arménie.
“Je n'ai pas suivi les traditions arméniennes”
La relation idyllique de Lilit et son mari a perduré jusqu'à la naissance de leur premier enfant.
“Mon mari m'aimait comme un fou, il exauçait tous mes souhaits à chaque instant. Je ne savais pas ce que signifiait le mot “non”. Et pendant ma grossesse, il me traitait comme une reine. Bref, ma vie ressemblait à un conte de fées. Puis, ce conte s'est transformé en enfer”, dit Lilit (nom d'emprunt).
Suite à la naissance de son bébé, dit-elle, son mari a changé. Quelques jours après l'accouchement, alors que Lilit allaitait, son mari s'est approché d'elle, a mis le bébé sur le lit et ils ont eu un rapport sexuel passionné. Cette scène s'est répétée à plusieurs reprises. Au début, c'était agréable pour Lilit.
“Peu de temps après, cependant, j'ai remarqué des changements dans son comportement : il me forçait à faire des choses au lit qui m'étaient désagréables et douloureuses, et si jamais je résistais, alors il m'attachait.”
Ces violences sexuelles ont perduré pendant environ six mois. Elle n'a rien dit à sa famille, car elle était gênée de parler de ses problèmes intimes.
Au début, elle voulait préserver leur relation familiale, et elle a donc demandé à son mari d'aller consulter un sexologue et un psychologue. Mais il a refusé.
“Je suis en vie aujourd'hui car je n'ai pas suivi la tradition arménienne, que je n'ai pas eu peur de porter l'étiquette de “femme divorcée” et que j'ai osé demander le divorce. Je n'ai pas signalé les faits à la police. À cette époque, je ne voulais pas que les gens connaissent mon histoire de vie”, raconte Lilit.
Autonome du point de vue financier, Lilit a pu partir avec son bébé et louer une maison. Selon elle, son ex-mari a tenté de restaurer leur relation à plusieurs reprises. Lilit pense que son mari est accro à la violence sexuelle et est d'ailleurs convaincue qu'il viole également sa femme actuelle.
“Je la connaissais de vue”, explique Lilit. “C'était une jolie fille aux formes généreuses qui venait de la campagne. Après leur mariage, je l'ai croisée quelques fois dans la rue. Elle est devenue terriblement maigre, elle marche avec le dos voûté et son cou est toujours couvert. Quand j'étais mariée, mon cou aussi était toujours couvert, parce qu'il l'avait attrapé et serré fort avec ses gros doigts – pour m'étrangler.”
Il m'avait dit : “je rêve de coucher avec un cadavre.”
Faire avancer la législation sur la violence domestique
En septembre 2017, le Ministère de la Justice a présenté un projet de loi sur “la prévention de la violence domestique et la protection des victimes de violence domestique”, en vue de son examen. La loi devait servir de base juridique pour la prévention de la violence domestique, la protection des victimes de violences domestiques et l'accès à la justice, puisqu'aucun de ces points n'était alors réglementé par la législation en vigueur.
Mais tout le monde n'était pas en faveur de cette loi. Plusieurs députés et personnalités politiques et publiques ont décidé de s'opposer à ce projet. Certains ont même affirmé que la loi était “imposée par l'Union européenne” à l'Arménie et qu'elle “visait à détruire des familles et à arracher les enfants à leurs parents”.
Après une période de débats intenses, une nouvelle version a été adoptée en décembre 2017, intitulée “Prévention de la violence domestique, protection des personnes victimes de violence dans la famille et rétablissement de la solidarité au sein de la famille”.
Les militantes de l'association Coalition pour stopper les violences faites aux femmes affirment que les modifications de l'intitulé de la loi ainsi que certains des concepts qu'on retrouve dans le texte posent problème. Ces derniers rappellent que le terme “violence domestique” a été supprimé à la fois du nom de la loi et de son texte, et remplacé par le terme “violence dans la famille” qui, selon eux, est plus ambigu d'un point de vue juridique.
Dans la loi adoptée, l'expression “causer des douleurs physiques” a été supprimée et remplacée par “causer intentionnellement des souffrances physiques”. Le terme “souffrance physique” n'est pas défini dans le Code pénal arménien.
Par conséquent, “si une femme a été victime de violence, a été blessée physiquement, mais que les traces de l'agression ou les blessures sur le corps ne sont pas apparentes, cela n'est plus considéré comme une infraction punissable”, a confié Hovhannisyan, membre de l'association Coalition pour stopper les violences faites aux femmes à OC Media.

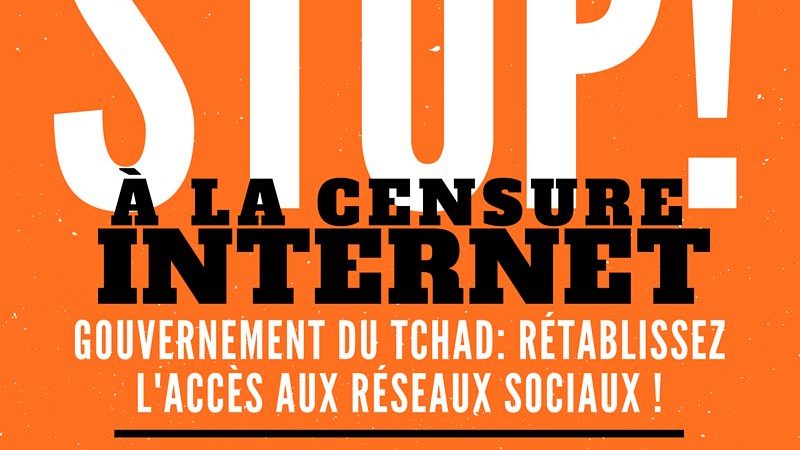
 (@Medall333)
(@Medall333) 



