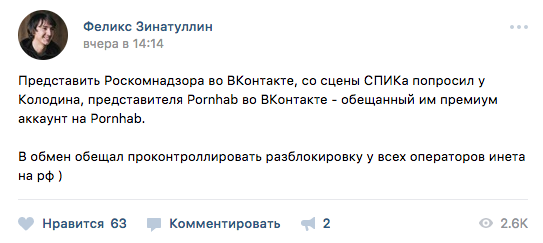En Turquie, les défenseurs des droits de l'homme toujours derrière les barreaux
samedi 15 juillet 2017 à 13:45
Un policier lance du gaz lacrymogène pendant les manifestations au parc Gezi à Istanbul, juin 2013. Photo de Mstyslav Chernov via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
Huit des défenseurs des droits de l'homme les plus respectés de Turquie ont été arrêtés la semaine dernière avec deux formateurs d'informatique venus de Suède et d'Allemagne. Les dix personnes arrêtées sont toujours en garde à vue mais n'ont pas été inculpées.
Le groupe s'était réuni pour un atelier en sécurité numérique et gestion des informations sur une des îles d'Istanbul, Büyükada, le 5 juillet lorsque la police a perquisitionné l'atelier, détenu les participants et confisqué des équipements électroniques, ordinateurs et téléphones mobiles. Parmi les personnes arrêtées se trouvait la directrice d'Amnesty International Turquie, Idil Eser.
Le journal turc Cumhuriyet a rapporté que la police avait également fait une descente dans les maisons de certains défenseurs des droits de l'homme arrêtés, et a saisi des livres, des CD, des téléphones et des appareils numériques. Le 11 juillet, Hürriyet Daily News a rapporté que « les perquisitions aux domiciles des personnes arrêtées étaient toujours en cours. »
Amnesty International a annoncé le 11 juillet que les dix personnes resteront toutes en garde à vue au moins sept jours de plus.
Le directeur d'Amnesty International en Turquie, Salil Shetty, a décrit les arrestations comme un « abus grotesque de pouvoir et soulignant la situation précaire des défenseurs des droits de l'homme dans le pays. »
Hugh Williamson, responsable d'Europe et d'Asie centrale à Human Rights Watch, a décrit la situation comme « une nouvelle étape répressive pour l'État turc » et a appelé à leur libération immédiate.
Questionné sur les détentions à une conférence de presse le 8 juillet au sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a soutenu que la réunion « allait constituer une reprise des événements du 15 juillet », faisant référence à la tentative ratée de coup d'État de 2016.
Les autorités turques n'ont fourni aucune preuve ni aux médias ni au public des affirmations du président. Tous les dix font preuve d'un engagement pour la protection pacifique et constructive des droits de tous les Turcs tels qu’ inscrits dans les lois du pays et les normes internationales des droits de l'homme.
Dans un tweet de son personnel, Amnesty International a rappelé son action pour défendre Erdogan quand il a été arrêté en 1998 lors de son mandat du maire d'Istanbul.
Les gouvernements et les agences intergouvernementales de par le monde ont exprimé leurs inquiétudes de l'absence de procès en bonne forme et d'abus de pouvoir de la part du régime. L'ancien Premier ministre de Suède, Carl Bildt, a qualifié les arrestations de « signe très inquiétant » :
Very worrying sign with Turkish authorities detaining key human rights defenders. Prosecutors running amok. https://t.co/pAx3s78CX5
— Carl Bildt (@carlbildt) July 8, 2017
Signe très inquiétant avec les autorités turcs détenant les principaux défenseurs des droits de l'homme clés. Les procureurs perdent la raison.
La député européenne néerlandaise Kati Piri s'est jointe aux appels pour la libération du groupe :
Ahead of EP vote on #Turkey, we called for immediate release of human rights defenders, including director of @amnesty
— Kati Piri (@KatiPiri) July 6, 2017
Avant le vote du Parlement européen sur la Turquie, nous avons appelé à la libération immédiate des défenseurs des droits de l'homme, y compris le directeur d'Amnesty
Les sympathisants des défenseurs des droits de l'homme partagent les informations sur le groupe Facebook Free Rights Defenders – Hak Savunucularına Dokunma. Sur Twitter, les sympathisants utilisent les hashtags #HakSavunucularınaDokunma, #FreeRightsDefenders et #Istanbul10.
L'Organisation mondiale contre la torture a aussi publié une déclaration signée par 40 organisations des droits de l'homme de par le monde, affirmant que « le travail des droits de l'homme ne doit pas être criminalisé » et exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les dix participants détenus.