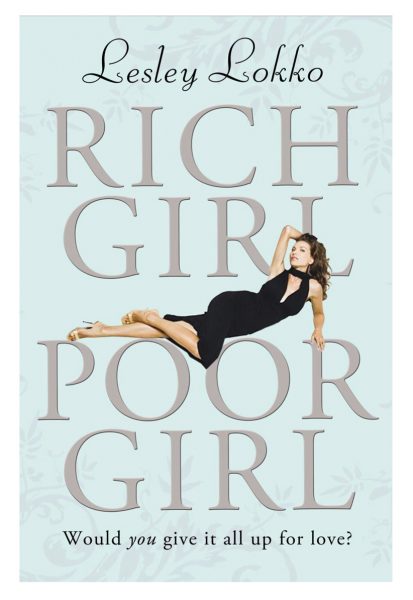Entretien avec l'architecte et romancière d'origine ghanéenne et écossaise à Trinité-et-Tobago

Pr. Lesley Lokko lors de son intervention intitulée “Tropic Antics” [Pitreries tropicales] à l'occasion d'une conférence publique gratuite à Port d'Espagne, organisée par l'Institut des architectes de Trinité-et-Tobago. Photographie : courtoisie de Mark Raymond, utilisée avec permission.
De descendance ghanéenne et écossaise, le professeur Lesley Lokko a une vision du monde unique. Elle a grandi au Ghana sous la protection de son père, un médecin qui a fait ses études au Royaume-Uni. À 17 ans, elle est partie en internat en Angleterre, et c'est là qu’elle est soudainement passée [fr] de la conscience d'être “demi-caste” (un terme ghanéen pour “métis”) à noire – ou plutôt, pas blanche.
Lokko a brillamment occupé cet espace entre le noir et le blanc toute sa vie – à travers son écriture, son œil d'architecte et maintenant, son approche de l'enseignement, et ses leçons récurrentes soulèvent continuellement des questions de culture et d’identité.
À l'invitation de l’Institut des architectes de Trinité-et-Tobago et de Bocas Lit Fest, le principal événement littéraire annuel du pays, Pr. Lokko a récemment fait sa première visite dans la république des îles jumelles, où elle a donné quelques conférences publiques sur l'importance de l'architecture, la société, la littérature et plus encore.
Global Voices (GV) : Vous avez choisi de vivre et de poursuivre votre carrière dans l'éducation en Afrique du Sud, à bien des égards le centre névralgique des relations entre Noirs et Blancs. À quoi ressemble cette fonction pour une personne métisse dans l’après-apartheid ?
Lesley Lokko (LL): The thing that drives me crazy about some white South Africans — let me emphasise: some, not all — is the feeling I often get behind our conversations that, somehow, the responsibility for managing change must be mine, because I’m the one who wants that change. We — as in black people — were the ones to bring change about so we must be responsible for handling the fallout. I call it the ‘Oprah Syndrome’. The responsibility for managing their own emotions, their guilt? They don’t want it, so they want to pass it back. What’s that if not racist? I’m not here to soak up your pain. You’ve had 200 years of talking about your pain! I’m done with it.
Le Black Economic Empowerment – the South African government's programme to redress the inequities of apartheid by giving black citizens economic advantages that white citizens cannot access – has reduced the argument about progress and equality down to money. It’s not actually about only money. Money is the symbol of a whole host of issues: class, culture, mobility, aspiration, self-esteem, identity…it’s all in there. Money becomes the be-all and end-all, the means in itself instead of the means to a more progressive end.
Lesley Lokko (LL) : Certains Sud-Africains blancs me rendent folle – permettez-moi de souligner : certains, pas tous – à cause du sentiment que je perçois souvent derrière nos conversations que, d'une certaine manière, la responsabilité de gérer le changement doit être la mienne. Je suis celle qui veut ce changement. Nous – c'est-à-dire les Noirs – avons provoqué le changement, nous devons donc être responsables d'en gérer les retombées. J'appelle ça le “syndrome d'Oprah”. La responsabilité de gérer leurs propres émotions, leur culpabilité ? Ils n'en veulent pas, alors ils veulent la renvoyer. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas raciste ? Je ne suis pas là pour absorber votre douleur. Vous avez eu 200 ans pour parler de votre douleur ! J'en ai fini.
Black Economic Empowerment [fr] – le programme du gouvernement sud-africain pour redresser les injustices de l'apartheid en donnant aux citoyens noirs des avantages économiques auxquels les citoyens blancs n'ont pas accès – a réduit le débat du progrès et de l'égalité à une question d’argent. En fait, il ne s'agit pas seulement d'argent. L'argent est le symbole de toute une série de problèmes : la classe, la culture, la mobilité, l'aspiration, l'estime de soi, l'identité… tout y est. L'argent devient le départ et l'arrivée, le moyen en soi au lieu d’être la clé pour une fin plus progressive.
GV : C'est comme un déni continu de cette identité noire. Vous avez fait beaucoup de travail sur la race, la culture et l'identité. Comment l'architecture, par exemple, prend-elle en compte notre identité en tant que peuple caribéen multi-ethnique ?
LL: Because of the historical relationship that Africans have always had with others — Europe, the United States, the Caribbean — we’re acutely aware of ‘other’ black cultures… African-Americans, West Indians, black Britons. We’re aware of these communities that are somehow connected to us, but also dispersed — so the psyche of Africans, no matter where in the world we are, is very fluid. It’s not about rootedness, being in one place only, having only one identity, speaking only one language… it’s much more open-ended than that. However — and here’s the rub — architecture is all about rootedness, location, a fixed place in the world. That’s the impulse of the architect — to dig a foundation, place something there, anchor it to the ground and to make sure it stays upright for as long as you possibly can. So, in effect, the very nature of the discipline is always in tension with the nature of the African diasporic psyche, which is all about movement, about dispersal, about multiplicity.
What are the implications of this for architects? I'll try to give you a really concrete — no pun intended — example: one of my closest friends is a Dominican architect. She’s married to a Swiss architect and they run a practice together in Basel [Switzerland]. When she studied at Cornell 25 years ago, there was no talk about race or identity or fluidity. Anyway, her practice won the job of refurbishing a local school and during the design process, she decided to try and bring into the classrooms a certain quality of light that reminded her of Santo Domingo [Dominican Republic] — soft, golden, hazy. The light in Basel is very different; it’s much colder…a blue, harsh kind of light. So my friend takes a little palette of Estee Lauder gold eye shadow to her meeting with the engineers who were making the shutters, and she said, ‘Make me a metal shutter that filters the light to produce this colour.’ And they did it! And it was a little victory for her because it meant that when the shutters came down on a cold winter’s afternoon, the students inside the classroom were bathed in this Caribbean light, which the vast majority of them have never experienced, right there in Basel. I find it a really interesting example, particularly for African and diasporic architects who are now struggling to match their emotive responses, impulses and histories with a discipline that historically hasn’t wanted them.
Still, we have a long way to go. I was just at the Venice Biennale and the question on everybody’s lips was, ‘Where was Africa?’ Not a single African country was represented — at least not in a national sense. The South African government has a 20-year lease on a building in the Arsenale, but because of financial ‘irregularities’ this year, there was no tender put forward for South African architects. So the building has been paid for but it’s just standing there, empty. Back in South Africa, there’s understandable fury at the government for allowing it to happen. It’s incredibly sad. Government has the mandate to provide opportunities for culture to flourish…and it doesn’t. And that goes for all African countries. Not a single African government was able to support a single African architect at the world’s most important architectural event — and it’s not because we’re too poor to afford it. But the situation is also part of a more complex question about the relationship between us — citizens — and government, and I don’t think there’s anywhere where that relationship is more difficult than across Africa.
We’re a deeply feudal society — and I don’t mean that in terms of ‘good’ or ‘bad’; it’s just how it is. I often compare the set-up of the ruling elite to the court of Henry VIII. A few ministers gather around a powerful central figure on whose patronage their very lives depend. But the citizens outside the court exist in the 21st century, at a time when vast amounts of information are available to us in terms of seeing other places, having other aspirations, learning about other ways of doing things…everything from the welfare state to efficient public services…and we don’t see that reflected in our leaders’ plans or actions for us. Actually, it’s mostly the opposite. We look to government as a sort of benevolent father figure who will improve the quality of our lives but, nine times out of ten, that same father figure is looking to line his own pockets — and the pockets of those around him — not ours. We’ve inherited a political structure that comes from a very different source, both in time and place, and we’re struggling to adapt. Henry VIII didn’t become Henry VIII to make money; he already had money. You can question how he accumulated his wealth, but the fact remains that he had a lot longer than a political term of four years to do it, which creates its own kind of pressure and temptations. Still, for all that, you do get leaders who have the power to change things. And many of those have come out of Africa and the African diaspora…Mandela, Martin Luther King, Malcolm X.
LL : À cause de la relation historique que les Africains ont toujours entretenue avec les autres (l'Europe, les États-Unis, les Caraïbes), nous sommes parfaitement conscients des “autres” cultures noires… afro-américaine, antillaise, britannique noire. Nous sommes conscients de ces communautés qui sont en quelque sorte liées à nous, mais aussi dispersées, de sorte que la psyché des Africains, peu importe où nous sommes dans le monde, est très fluide. Il ne s'agit pas d'enracinement, d'être au même endroit, d'avoir une seule identité, de ne parler qu'une seule langue… c'est beaucoup plus ouvert que ça. Cependant, et c'est là le problème, l'architecture repose sur l'enracinement, l'emplacement, un lieu fixe dans le monde. C'est l'impulsion de l'architecte : creuser une fondation, y placer quelque chose, l'ancrer au sol et s'assurer qu'il reste droit aussi longtemps que possible. Donc, en effet, la nature même de la discipline est toujours en tension avec celle de la psyché de la diaspora africaine, toute en mouvement, dispersion, multiplicité.
Quelles en sont les implications pour les architectes ? Je vais essayer de vous donner un exemple très concret : une de mes amies les plus proches est une architecte dominicaine. Elle est mariée à un architecte suisse et ils travaillent ensemble à Bâle. Quand elle étudiait à Cornell il y a 25 ans, on ne parlait pas de race, d'identité ou de fluidité. Quoi qu'il en soit, sa pratique a permis de rénover une école locale et pendant le processus de conception, elle a décidé d'apporter dans les salles de classe une certaine qualité de lumière qui lui rappelait Saint-Domingue, douce, dorée, brumeuse. La lumière à Bâle est très différente, il fait beaucoup plus froid… une sorte de lumière bleue et dure. Alors mon amie a pris une petite palette d'ombre à paupières Estee Lauder à sa réunion avec les ingénieurs qui fabriquaient les volets, et elle leur a dit: « Faites-moi un volet métallique qui filtre la lumière pour produire cette couleur. » Et ils l'ont fait ! Et ce fut une petite victoire pour elle car cela signifiait que lorsque les volets tomberaient par un froid après-midi d'hiver, les étudiants dans la salle de classe seraient baignés dans cette lumière caribéenne, que la grande majorité n'a jamais vécue, à Bâle. Je trouve que c'est un exemple très intéressant, particulièrement pour les architectes africains et de la diaspora qui luttent maintenant pour mettre en relation leurs réponses émotionnelles, impulsions et histoires avec une discipline qui historiquement ne voulait pas d’eux.
Nous avons encore un long chemin à parcourir. J'étais juste à la Biennale de Venise et la question sur toutes les lèvres était : « Où est l'Afrique ? » Pas un seul pays africain n'était représenté, du moins pas au niveau national. Le gouvernement sud-africain a un bail de 20 ans sur un immeuble de l'Arsenale, mais en raison d'irrégularités financières cette année, aucun appel d'offres n'a été lancé pour les architectes sud-africains. Donc le bâtiment a été payé mais il est juste là, vide. En Afrique du Sud, il y a une colère bien compréhensible contre le gouvernement pour avoir permis que cela se produise. C'est incroyablement triste. Le gouvernement a le mandat de fournir des occasions pour la culture de s'épanouir… et il n'en fait rien. Et cela vaut pour tous les pays africains. Aucun gouvernement africain n'a été capable de soutenir un seul architecte africain lors de l'événement architectural le plus important du monde, et ce n'est pas parce que nous sommes trop pauvres pour nous le permettre. Mais cette situation fait aussi partie d'une question plus complexe sur la relation entre nous – les citoyens – et le gouvernement, et je ne pense pas qu'il y ait un autre endroit où cette relation soit plus difficile qu'en Afrique.
Nous sommes une société profondément féodale, et je ne veux pas dire que c'est une “bonne” ou une “mauvaise” chose. C'est juste comme ça. Je compare souvent le comportement de l'élite dirigeante africaine à la cour de Henri VIII [fr]. Quelques ministres se réunissent autour d'une figure centrale puissante dont dépend leur vie même. Mais, au XXIe siècle des citoyens existent hors de cette cour, à une époque où de vastes quantités d'informations sont disponibles pour voir d'autres endroits, avoir d'autres aspirations, apprendre d'autres façons de faire… tout, depuis l'État-providence à l'efficacité des services publics… et nous ne voyons pas cela reflété dans les plans ou les actions de nos dirigeants pour nous. En fait, c'est surtout le contraire. Nous considérons le gouvernement comme une sorte de figure paternelle bienveillante qui améliorera la qualité de nos vies, mais, neuf fois sur dix, ce même personnage paternel cherche à remplir ses propres poches (et celles de ceux qui l'entourent) et pas les nôtres. Nous avons hérité d'une structure politique qui vient d'une source très différente, à la fois dans le temps et dans l'espace, et nous avons du mal à nous adapter. Henri VIII n'est pas devenu Henri VIII pour gagner de l'argent; il en avait déjà. On peut s'interroger sur la façon dont il a accumulé sa richesse, mais il n'en demeure pas moins qu'il a eu beaucoup plus de temps qu'un mandat politique de quatre ans pour le faire, ce qui crée son propre genre de pression et de tentations. Malgré tout, vous obtenez des leaders qui ont le pouvoir de changer les choses. Et beaucoup d'entre eux sont venus d'Afrique et de la diaspora africaine… Mandela [fr], Martin Luther King [fr], Malcolm X [fr].
[Le professeur Lokko parlant des transformations radicales de l'architecture dans la série Safe Space: Session # 01 de UJ GSA sur Vimeo.]
GV : Il y a une dynamique très similaire en ce qui concerne le leadership des Caraïbes.
LL: I’ve been running the Graduate School of Architecture for four years now, and every day, I’m reminded that leadership is like its own profession — it’s not some side thing you do in addition to your day job — that is the job. In the corporate world, there’s an incredible amount of thinking that goes into how to lead, how to manage, how to create better companies, better teams…in the public sector, however, there’s not so much. I suppose in the corporate world the bottom line — profit — is what drives success.
I look at many African leaders in government and I wonder if any of them have ever had anything like the level of support that’s required to lead. It is interesting that we never speak about those support mechanisms — the milieus that surround leaders. The psychology, the history, the mentoring…the add-ons that can make the difference between being a mediocre manager and a really great leader.
LL : Je dirige la Graduate School of Architecture depuis quatre ans, et chaque jour, je me rappelle que le leadership est comme sa propre profession : ce n'est pas quelque chose que vous faites en plus de votre travail journalier, c'est le boulot. Dans le monde des affaires, il y a énormément de réflexion sur la façon de diriger, de gérer, de créer de meilleures entreprises, de meilleures équipes… Dans le secteur public, cependant, il n'y en a pas beaucoup. Je suppose que dans le monde de l'entreprise, l'essentiel (la rentabilité) est ce qui motive vers le succès.
Je regarde beaucoup de dirigeants africains dans des gouvernements et je me demande si aucun d'entre eux a jamais eu le niveau de soutien nécessaire pour diriger. Il est intéressant que nous ne parlions jamais de ces mécanismes de soutien, les milieux qui entourent les dirigeants. La psychologie, l'histoire, le mentorat… les ajouts qui peuvent faire la différence entre être un manager médiocre et un très bon leader.
GV : Vous avez parlé de l'approche de l'enseignement en “forçant les étudiants à s'ouvrir” pour découvrir ce qui les motive. Quel est l'impact potentiel de faire cela ?
LL: That’s a difficult question to answer. On the one hand, I hope the impact of opening up difficult topics like race and identity will make an enormous difference but on the other, I also long for a time when such questions aren’t seen as marginal, or only of interest to black students. That's partly why I’m here [in Trinidad and Tobago]. It’s really important for us (and I use that in a very broad sense) to have spaces and places — like really great schools of architecture — where those concerns are central. And they’re central in really deep, rigorous, creative, investigative, explorative ways. They’re not just what you ‘allow’ black students to do simply because they’re black. I think that’s the potential I see in the Graduate School of Architecture. South Africa, for many reasons, is the right place to put these issues on the table and see them succeed. It has the infrastructure, there’s money available for education, and for the first time, there’s a political imperative. Since the student protests in 2016, ‘decolonisation’ and ‘transformation’ are on everyone’s lips. The moral imperative and the political will to bring about change is there. They can’t duck the question anymore.
LL : C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. D'une part, j'espère que l'impact d'aborder des sujets difficiles comme la race et l'identité fera une énorme différence, mais d'autre part, je souhaite aussi que ces questions ne soient pas considérées comme marginales, ou seulement intéressantes pour les étudiants noirs. C'est en partie pourquoi je suis ici [à Trinité-et-Tobago]. Il est vraiment important pour nous (et j'utilise cela dans un sens très large) d'avoir des espaces et des lieux – comme de très grandes écoles d'architecture – où ces préoccupations sont centrales. Et elles sont centrales de manière vraiment profonde, rigoureuse, créative, investigatrice et exploratrice. Ce n'est pas simplement ce que vous “permettez” aux élèves noirs de faire simplement parce qu'ils sont noirs. Je pense que c'est le potentiel que je vois dans la Graduate School of Architecture. L'Afrique du Sud, pour de nombreuses raisons, est le bon endroit pour mettre ces questions sur la table et les voir réussir. Elle a l'infrastructure, il y a de l'argent disponible pour l'éducation et, pour la première fois, il y a un impératif politique. Depuis les manifestations étudiantes de 2016, “décolonisation” et “transformation” sont sur toutes les lèvres. L'impératif moral et la volonté politique d'amener le changement sont là. Ils ne peuvent plus éviter la question.
GV : Afin d'accomplir ces changements, ce que vous êtes vraiment en train de réaliser à la GSA, vous avez sûrement dû être inspirée par d'autres. Parlez-nous de quelques architectes et écrivains qui vont ont influencés.
LL: For me, architecture begins and ends with Mies van der Rohe. It’s a cliché, I know, but it’s true. His work moves me in ways that I can’t adequately express. His buildings make ‘sense’ to me and that’s the product of seven years of a particular Modernist kind of training that is deeply ingrained. Literature is different. I never studied literature, so my tastes are probably more intuitive, less ‘trained.’ I’m influenced by subject matter as much as style, which I’m grateful for! Two writers in particular have had a huge influence on me. One is South African writer Nadine Gordimer — and not just because of her subject matter, which is what most people assume — but because she uses language the way an architect uses space; it’s structural, formal, very muscular. She’s a very difficult person to read because she doesn’t often follow conventions of punctuation and so on, but for me, she's the best. The other is an Australian writer called David Malouf. Both are loosely post-colonial writers, but their work a real example of how the same subject matter can be articulated so differently. As far as West Indian writers go, I read Walcott and Naipaul a lot when I was younger. Contemporary writers? Patrick Chamoiseau, Junot Diaz.
LL : Pour moi, l'alpha et l'omega de l'architecture, c'est Mies van der Rohe [fr]. Je sais, c'est un cliché mais c'est vrai. Son travail me touche d'une façon que je n'arrive pas à exprimer. Ses bâtiments ont une “signification” pour moi, résultat d'une formation de sept ans d'un genre particulier de modernisme, qui est profondément ancrée en moi. La littérature, c'est différent. Je n'ai jamais étudié la littérature, donc mes goûts sont probablement plus intuitifs, moins “formés”. Je suis influencée par les sujets autant que par les styles, et j'en suis heureuse ! En particulier, deux écrivains ont eu une énorme influence sur moi. L'un est l'auteure sud-africaine Nadine Gordimer [fr] (et non à cause de ses sujets, comme le supposent la plupart des gens) mais parce qu'elle utilise la langue comme un architecte utilise l'espace : c'est structurel, formel, très musclé. Elle est très difficile à lire parce qu'elle ne suit pas souvent les règles de ponctuation etc, mais pour moi c'est la meilleure. L'autre est un écrivain australien appelé David Malouf [fr]. Ce sont tous deux des auteurs post-coloniaux, mais leur travail est un véritable exemple de la différence de traitement d'un même sujet. En ce qui concerne les auteurs antillais, je lisais beaucoup Walcott et Naipaul quand j'étais plus jeune. Les auteurs contemporains ? Patrick Chamoiseau [fr], Junot Diaz [fr].

Pr. Lesley Lokko parlant de littérature au siège du Bocas Lit Fest à Port d'Espagne. Photographie de Mark Raymond, reproduite avec autorisation.
GV : Et les auteurs africains ?
LL: I struggle with a lot of African writers. There’s huge talent and an almost infinite range of stories to tell, but for many, the fact that they are African still dominates the narrative. I’m impatient for us to be free of that bind or that veil of ‘otherness’ through which we often have to write…it will take time.
I’m starting my literature talk [with Bocas Lit Fest founder Marina Salandy-Brown] with two conversations I had with my publishers after book three and after book six. Everyone said to me, your second novel’s going to be the hard one because the first has done really well. But it was the third one that fell apart. My contract was one novel a year, and the third one took three years and at one point my publishers got really fed up and said, ‘Bring the girl to London.’ So we get there and they're asking me why I'm finding it so difficult to write the novel. Eventually one of my editors, a really nice woman, said to me, ‘Lesley, for the love of God, we cannot understand what it is that you don’t understand. Boy meets girl, boy gets girl, boy loses girl, boy gets girl again.’ My agent, who I think felt rather sorry for me, leaned across and whispered, ‘Don’t forget, that’s exactly what the Classics were about.’ I don’t know that it made me feel any better but it did have the effect of making me less precious. But by my sixth novel, I'm back in the same boardroom for a really awkward meeting that has since become the title of a talk that I give: ‘No more than three, please.’
LL : J'ai beaucoup de mal avec les auteurs africains. Il y a un énorme talent et quasiment une infinité d'histoires à raconter, mais pour beaucoup, le fait qu'ils sont Africains domine encore leur narration. J'ai hâte que nous nous libérions de cette contrainte ou de ce voile d'”altérité” à travers lequel nous devons souvent écrire… Cela va prendre du temps.
Je commence ma présentation littéraire [avec la fondatrice de Bocas Lit Fest Marina Salandy-Brown] par deux conversations que j'ai eu avec mes éditeurs, après mes troisième et sixième livres. Tout le monde me disait : ton deuxième roman va être difficile parce que le premier a vraiment bien marché. Mais finalement, c'est le troisième qui s'est effondré. J'avais un contrat pour un roman par an. Le troisième a pris trois ans et à un moment, mes éditeurs en ont vraiment eu assez et ont dit “Amenez-la à Londres”. Et donc nous y allons et ils me demandent les raisons pour lesquelles je trouve difficile d'écrire ce roman. Finalement, l'un d'eux, une femme très gentille, me dit : “Lesley, pour l'amour de dieu, nous n'arrivons pas à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Un garçon rencontre une fille, il la conquiert, il la perd, il la récupère.” Mon agent, qui je pense, était assez désolé pour moi, s'est penché vers moi et m'a murmuré : “N'oublie pas, les classiques faisaient exactement pareil.” Je ne sais pas si ça m'a réconfortée mais ça a au moins eu l'effet de me faire me sentir moins précieuse. Et puis à mon sixième roman, je suis de retour dans cette salle de réunion pour une entrevue très inconfortable qui est depuis devenue le titre d'une de mes présentations : “Pas plus de trois, s'il vous plaît”.
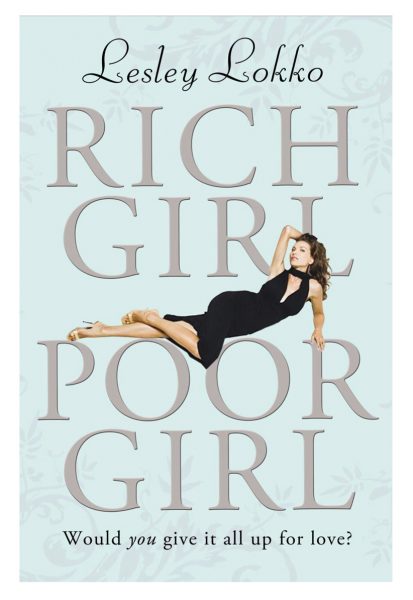
Couverture de l'un des romans de Lesley Lokko. Image fournie par Lesley Lokko et reproduite avec autorisation.
GV : “Pas plus de trois” quoi ?
LL: [Grins mischievously] My editor says to me, ‘Lesley, we’ve had a little chat amongst ourselves and the thing is, we love your books…I mean we just love your books’ — and I’m thinking, ‘What on earth is going to come now?’ Then she says, ‘But we really feel we’ve got to draw a line somewhere. So we’ve had a chat among ourselves and we’ve looked at everything, and what we’ve decided is that we’d really like you to stick to three. No more than three.’ I’m fairly confused at this point and I ask them, ‘No more than three what? Will you just spit it out?’ And she says, ‘No more than three black characters.’
What they were essentially saying was, ‘Look, we appreciate that in all of your novels you feel you have to have a black character, but could you just limit it? Because after all, your audience is here.’ It was one of those moments where the wind is taken out of you. Was it a marketing decision? A moral decision? An ethical one? And then — my way of being sarcastic — I said, ‘Does mixed race count?’ In the end, I don’t know that I stuck to it — some books have less, some have more — but for me, it was the beginning of the end of that fiction-writing phase because I realised that what I thought I was doing and what they thought I was doing were two completely different things. I thought that I was merging a number of different genres — chick lit, thrillers, literary fiction, historical novels, political memoirs — but, in essence, I was really only writing sex-and-shopping blockbusters that still conformed to very particular rules. So, where I thought I was bending the rules, in actual fact I was simply obeying them, give or take a black character or three. I stopped writing after eleven novels and my publishers and I parted company very amicably, but I still think they underestimated the reading public.
What's interesting for me is that I still sell really well in Italy — relative to the overall size of readership, that’s my biggest market. I sell more numbers of books in the U.K., but the U.K. has a much bigger reading audience. If you look at the Italian book covers, you’d think I’m a completely different kind of writer and the questions I get asked when I do talks in Italy I’d never get in the U.K. More importantly, the books I write don’t speak to ‘black’ issues in the way that the literary world understands them…My UK editors were lovely, but there was always a hesitation to foreground those issues or promote me as a black writer, largely because they thought I’d go into the black interest section in book stores and sell 300 copies — and I’m not even that black.
If you look at writers like Taiye Selasi or Chimamanda Ngozi Adichie, who are black in a very different way, they’re promoted as black — or African — writers, partly because the world of literary fiction, which is very different from commercial fiction, thrives on those kinds of distinctions, and partly because their work speaks very directly — and beautifully — to questions of identity in a very contemporary way. But there’s something about people like me — not quite black enough, not quite white enough, not writing to type — I think that’s quite difficult for a publisher to deal with.
But Meghan Markle’s going to change all of that. I watched the Royal Wedding the day before I left South Africa to come on this lecture tour. It struck me that we were watching something really profound, even if we only come to see it in hindsight. I’d like to expand on that a little. If someone asks me where I’m from, I’ll always say ‘Ghana.’ I would never say ‘England’ or ‘Scotland’, even though I was born in Scotland to a Scottish mother. But asking a mixed-race person where they’re from is always a more complex question. It’s invariably followed by, ‘But where are you really from?’ or ‘Where are your parents from?’ If I were pushed, I might say, ‘Well, I’m partly British.’ Now, I studied in the U.K. in the '80s and '90s, which was a very special time. It was the beginning of Cool Brittania, especially for everyone connected to the arts. Suddenly — and I remember this very clearly — there was another identity available to those of us who weren’t English, Welsh, Scottish — at least in the white, original sense of identity. That identity was contemporary British-ness and it gave all those bits and pieces of the former empire a different, legitimate meaning, especially in London. For me, Meghan Markle’s marriage has gone the other way, right to the heart of Englishness, in a way that no one else has. I don’t know that it will change anything immediately, but, for the first time that I can recall, Englishness has been broken apart.
LL : [avec un sourire malicieux] Mon éditrice me dit : “Lesley, nous avons eu une petite conversation entre nous et le truc, c'est qu'on aime vos livres… Je veux dire, on aime vraiment vos livres”. Et là, je me demande “Mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ?” Et c'est là qu'elle annonce “Mais on pense vraiment qu'il faut mettre une limite quelque part. Donc nous avons discuté et nous avons bien tout regardé et ce que nous avons décidé, c'est que nous aimerions vraiment que vous vous limitiez à trois. Pas plus de trois.” À ce stade, je suis plutôt perplexe et je leur demande : “Pas plus de trois quoi ? Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?” Et elle me répond : “Pas plus de trois personnages noirs.”
En fait, ce qu'ils me disaient là, c'était : “Écoutez, on comprend bien que vous ayiez besoin d'avoir un personnage noir dans chacun de vos romans, mais est-ce que vous pourriez simplement vous limiter ? Parce que, apres tout, votre lectorat est ici.” Ça a été l'un de ces moments où on vous coupe les ailes. Était-ce une décision marketing ? Morale ? Ethique ? J'ai fini par demander, sarcastique à ma facon : “Est-ce que les métis comptent ?” En fin de compte, je ne sais pas si j'ai respecté ça. Certains livres ont plus, d'autres moins [de personnages noirs], mais pour moi, ça a été le début de la fin de cette phase d'écriture de fiction, parce que j'ai réalisé que ce que je pensais que je faisais et ce qu’ils pensaient que je faisais étaient deux choses complètement différentes. Je croyais que je fusionnais plusieurs genres différents – chick lit, thriller, littéraire, historique, mémoires politiques – mais en fait, je ne faisais qu'écrire des romans à succès avec du sexe et du shopping et qui se conforment à des règles bien particulières. Je pensais que je dérogeais aux règles quand ne faisais que leur obéir, modulo un, ou trois, personnages noirs. J'ai arrêté d'écrire après onze romans et mes éditeurs et moi nous sommes séparés à l'amiable, mais je pense toujours qu'ils sous-estiment les lecteurs.
Ce qui est intéressant pour moi, c'est que mes livres se vendent vraiment bien en Italie. Rapporté à la taille du public, c'est mon marché le plus important. Je vends plus de livres au Royaume Uni, mais il a un lectorat bien plus important. Si vous regardiez les couvertures italiennes, vous vous diriez que je suis un écrivain complètement différent et quand je donne des présentations en Italie, on me pose des questions qu'on ne me poserait jamais au Royaume Uni. Plus important encore, les livres que j'écris n'abordent pas les questions “noires” de la façon dont le monde littéraire les comprend… Mes éditeurs au Royaume Uni étaient adorables, mais ils hésitaient toujours à mettre ces sujets sur le devant de la scène et à me promouvoir comme une auteure noire, essentiellement parce qu'ils pensaient que ça me cantonnerait à la section des livres sur les questions noires des librairies et que je n'en vendrais que 300 exemplaires… Et je ne suis même pas aussi noire que ca.
Prenez le cas d'auteures noires comme Taiye Selasi [fr] ou Chimamanda Ngozi Adichie [fr], qui sont noires mais différemment. Elles sont promues comme des écrivaines noires, ou africaines, en partie parce que le monde de la fiction littéraire, qui est très différente de la fiction commerciale, prospère grâce à ces différences, et en partie parce que leur travail parle très directement (et admirablement) des questions d'identité dans un contexte très contemporain. Mais il y a quelque chose à propos des auteurs comme moi, pas tout à fait assez noirs, pas tout à fait assez blancs, et qui n'ont pas envie de se conformer à des types, qui nous rendent difficiles à traiter pour un éditeur.
Mais Meghan Markle [fr] va changer tout ça. J'ai regardé le mariage royal la veille de mon départ d'Afrique du Sud pour entamer ma tournée. Nous regardions quelque chose de vraiment profond (même si nous ne le réaliserons qu'avec du recul) qui m'a frappée. J'aimerais développer. Si quelqu'un me demande d'où je suis, je réponds toujours “du Ghana”. Je ne dirais jamais “d'Angleterre” ou “d'Écosse”, bien que je sois née en Écosse d'une mère écossaise. Mais poser cette question à un métis est toujours plus complexe. Elle est invariablement suivie de “Mais d'où êtes-vous vraiment ?” ou “D'où viennent vos parents ?”. Si on insiste, je répondrais peut-être : “Hé bien, je suis en partie britannique”. J'ai étudié au Royaume Uni dans les années 80 et 90, une époque vraiment spéciale. C'était le début du Cool Britannia [fr], surtout pour tout ceux en relation avec les arts. D'un coup, et je m'en souviens très clairement, une autre identité est devenue disponible pour nous autres qui n'étions pas anglais, gallois, écossais, tout du moins pas dans une définition originelle, blanche, de l'identité. Cette identité était une identité britannique contemporaine. Elle donnait à tous ces petits bouts de l'ancien empire une signification différente, légitime, surtout à Londres. Pour moi, le mariage de Meghan Markle va exactement dans la direction opposée, droit au cœur de l'anglicité, d'une façon que rien d'autre n'a fait. Je ne sais pas s'il va changer quoi que soit immédiatement, mais pour la première fois que je me souvienne, l'anglicité a été brisée.
En fin de compte, peut-être que l'impulsion vers un changement à long terme viendra en brisant le statu quo que l'architecture, la littérature et d'autres formes d'expressions culturelles ont maintenu pendant si longtemps.