La directive Copyright n’est pas une défaite pour l’Internet Libre et Ouvert !
mardi 18 septembre 2018 à 15:5918 septembre 2018 - Bien que la directive droit d'auteur soit le symptôme d'une soumission économique de nos industries aux géants du Web, elle crée néanmoins l'opportunité de remettre en cause ces géants, au profit de l'Internet décentralisé.
C'est ce que nous rappelle Calimaq, membre de La Quadrature du Net, dans cette tribune - initialement publiée sur son blog.
Qu’est-ce qu’une victoire et qu’est-ce qu’une défaite ? En un peu plus de 10 ans de militantisme pour les libertés dans l’environnement numérique, j’ai souvent eu l’occasion de me poser cette question. Et elle surgit à nouveau de la plus cruelle des manières, suite au vote du Parlement européen en faveur de la directive sur le Copyright, alors même que le précédent scrutin en juillet avait fait naître l’espoir d’une issue différente.

L’expérience m’a cependant appris que rien n’est plus trompeur que les votes parlementaires pour apprécier si l’on a « gagné » ou « perdu ». En 2012, lorsque le Parlement européen avait rejeté l’accord anti-contrefaçon ACTA, nous pensions avoir remporté une victoire historique qui changerait le cours des choses. Et nous avons ensuite sincèrement œuvré en ce sens, pensant que ce serait le premier acte d’une réforme positive du droit d’auteur. Mais le recul nous montre qu’il s’agissait en réalité d’une simple séquence au sein d’un ensemble plus vaste, qui a progressivement conduit au revers de cette semaine.
Les votes dans les assemblées nous abusent telles des illusions d’optique, parce qu’ils ressemblent à ce que les spécialistes de stratégie appellent des « batailles décisives ». Pendant des siècles, les généraux ont cherché à obtenir cet ultime Graal de l’art militaire : un unique affrontement ayant la faculté de mettre fin à la guerre en désignant sans ambiguïté un gagnant et un perdant. Mais les historiens ont montré que la bataille décisive constituait aussi un mythe dangereux, dont la poursuite pouvait devenir la cause même de la défaite. En 1941, au début de l’opération Barbarossa, l’armée nazie remporte ainsi sur les soviétiques une série de victoires comptant parmi les plus spectaculaires de toute l’histoire. Mais ces succès ne l’empêchèrent pas ensuite de connaître un échec cuisant devant Moscou, qui marquera le point de départ d’un lent déclin les conduisant à une déroute totale en 1945. Or une des grandes différences entre l’Armée allemande et l’Armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale, c’est que la seconde avait compris qu’il lui fallait arrêter de chercher à remporter une bataille décisive pour espérer gagner la guerre, tandis que les nazis se sont accrochés jusqu’au bout à ce mythe qui a fini par les perdre.
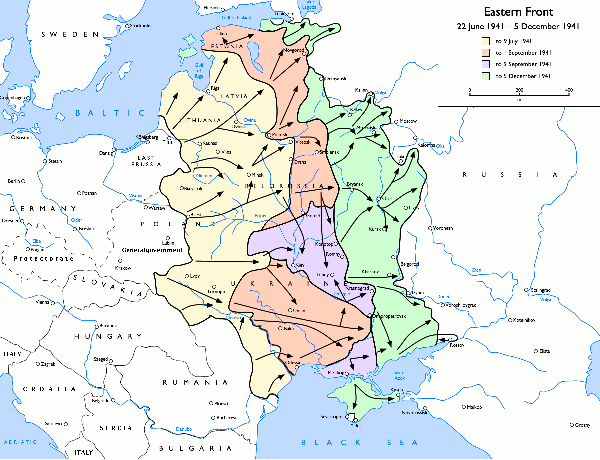
Or il y a un parallèle à faire entre cette histoire et celle de la lutte pour les libertés numériques. Trop souvent, nous avons concentré nos énergies sur des combats législatifs, hypnotisés par l’idée que le décompte des voix conduirait à une sorte « d’ordalie démocratique ». Cela nous a donné plusieurs fois l’illusion d’avoir remporté quelque chose, comme au moment du rejet de l’ACTA, alors que les racines du problème restaient intactes. Mais heureusement en sens inverse, si la victoire n’est jamais acquise en cas de succès législatif, il en est de même pour la défaite. Et rien ne serait plus faux que de penser que le vote de cette semaine sur la directive Copyright constitue la fin de l’histoire, sous prétexte que nous aurions encaissé là une défaite décisive !
Nous avons pas « perdu Internet » !
Certes les articles 11 et 13 du texte, qui instaurent une obligation de filtrage automatisé des plateformes et une taxe sur les liens hypertextes au profit des éditeurs de presse, représentent des monstruosités contre lesquelles il était nécessaire de lutter. Mais il convient à présent d’apprécier exactement la portée de ces mesures, pour réadapter très rapidement notre stratégie en conséquence à partir d’une appréhension claire de la situation. Or cette « vision stratégique d’ensemble » est à mon sens précisément ce qui a manqué tout au long de cette campagne dans le camp des défenseurs des libertés numériques et il est inquiétant de constater que ces erreurs de jugement n’ont pas disparu maintenant que l’heure est venue d’analyser les conséquences du scrutin.
On a pu voir par exemple cette semaine l’eurodéputée du Parti Pirate Julia Reda expliquer sur son blog que ce vote constituait un « coup dur porté à l’internet libre et ouvert » (Today’s decision is a severe blow to the free and open internet). De son côté, Cory Doctorow a écrit un article sur le site de l’EFF, où il affirme que « l’Europe a perdu Internet » (Today, Europe lost the Internet). Sur Next INpact, Marc Rees déplore dans la même veine « une mise au pilori du Web tel que nous le connaissons, un affront à la liberté d’expression. » Ces appréciations font écho au mot d’ordre qui fut celui des défenseurs des libertés en campagne contre les articles 11 et 13 de la Directive : Save Your Internet (Sauvez votre Internet).

Or lorsqu’on lit attentivement ces articles, tels qu’amendés par le vote des eurodéputés, on se rend compte qu’ils ne visent pas pas « l’Internet » ou « le Web » tout entier, mais seulement une catégorie d’acteurs déterminés, à savoir les plateformes centralisées à but lucratif. Ce n’est donc pas « l’Internet libre et ouvert » qui va être frappé par cette directive, mais plutôt exactement ce qui représente son antithèse ! A savoir cette couche d’intermédiaires profondément toxiques qui ont dénaturé au fil du temps les principes sur lesquels Internet et le Web s’appuyaient à l’origine pour nous faire basculer dans la « plateformisation ». Pour se convaincre que ces acteurs n’ont absolument plus rien à voir avec un Internet « libre et ouvert », il est bon de relire ce que Tim Berners-Lee, l’inventeur du web, en disait au mois d’août dernier :
Nous avons démontré que le Web avait échoué au lieu de servir l’humanité, comme il était censé le faire, et qu’il avait échoué en de nombreux endroits. La centralisation croissante du Web, dit-il, a fini par produire – sans volonté délibérée de ceux qui l’ont conçu – un phénomène émergent à grande échelle qui est anti-humain.
Or le grand mensonge sur lesquels s’appuient les GAFAM – principaux responsables de cette centralisation -, c’est de chercher à faire croire qu’ils représentent à eux-seuls l’Internet tout entier, comme si rien ne pouvait plus exister en dehors de leur emprise. En ce sens quand j’entends Cory Doctorow dire que nous « avons perdu Internet » à cause de mesures ciblant les acteurs centralisés lucratifs, je ne peux que frémir. Avec tout le respect que je peux avoir pour ce grand monsieur, ses propos paraissent avoir incorporé la prétention des GAFAM à recouvrir le web et c’est particulièrement grave. Car c’est précisément cela qui constituerait la défaite finale des défenseurs des libertés : se résigner à cet état de fait et ne pas agir sur les marges dont nous disposons encore pour briser cette hégémonie.
Voilà pourquoi il faut aujourd’hui l’affirmer avec force : non, la directive Copyright n’est donc pas une défaite pour l’Internet Libre et Ouvert ! C’est notre vision même du sens de la lutte qu’il faut aujourd’hui urgemment reconfigurer, pour sortir de l’ornière au fond de laquelle nous sommes en train de nous enfermer et qui ne peut nous conduire qu’à de nouvelles défaites plus cuisantes encore que celle-ci.
Sortir d’une conception « formelle » de la liberté d’expression
Sur Next INpact, Marc Rees identifie avec raison le changement le plus profond que ce texte va amener : il remet en question la distinction classique entre hébergeurs et éditeurs, issue de la directive eCommerce de 2000. Jusqu’à présent, les hébergeurs bénéficiaient d’une responsabilité atténuée vis-à-vis des actes commis par leurs utilisateurs. Au lieu de cela, la directive Copyright introduit une nouvelle catégorie d’intermédiaires dits « actifs » qui devront assumer la responsabilité des contenus qu’ils diffusent, même s’ils ne sont pas directement à l’origine de leur mise en ligne. Mais il est important de regarder quels critères la directive utilise pour identifier ce nouveau type d’acteurs :
La définition du prestataire de services de partage de contenus en ligne doit, au sens de la présente directive, englober les prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à stocker, à mettre à la disposition du public ou à diffuser un nombre appréciable de contenus protégés par le droit d’auteur chargés ou rendus publics par leurs utilisateurs, et qui optimisent les contenus et font la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les affichant, en les affectant de balises, en assurant leur conservation et en les séquençant, indépendamment des moyens utilisés à cette fin, et jouent donc un rôle actif.
On voit que le « rôle actif » se déduit de trois éléments : la taille de l’acteur, son but lucratif et la hiérarchisation automatisée de contenus. Ce sont donc bien des plateformes centralisées lucratives, type Facebook ou YouTube, qui devront assumer cette nouvelle responsabilité. Pour y échapper, elles devront conclure des accords de licence pour rémunérer les ayant droits et, à défaut, déployer un filtrage automatisé des contenus a priori. En pratique, elles seront certainement toujours obligées de mettre en place un filtrage, car il est quasiment impossible d’obtenir une licence capable de couvrir l’intégralité des œuvres pouvant être postées.
Nous avons combattu en lui-même le filtrage automatique, car c’était une mesure profondément injuste et disproportionnée. Mais une question mérite d’être posée : au nom de quoi les défenseurs d’un « Internet Libre et Ouvert » devraient-ils s’émouvoir de ce que les plateformes centralisées et lucratives perdent le bénéfice de la quasi-immunité dont elles bénéficiaient jusqu’à présent ? La directive a par ailleurs pris le soin de préciser que les « prestataires sans finalité commerciale, comme les encyclopédies en ligne de type Wikipedia » ainsi que les « plateformes de développement de logiciels Open Source » seraient exclus du champ d’application de l’article 13, ce qui donne des garanties contre d’éventuels dommages collatéraux.
Marc Rees nous explique que cette évolution est dangereuse, parce que l’équilibre fixé par la directive eCommerce constituerait le « socle fondamental du respect de la liberté d’expression » sur Internet. Mais cette vision me paraît relever d’une conception purement « formelle » de la liberté d’expression. Peut-on encore dire que ce qui se passe sur Facebook ou YouTube relève de l’exercice de la liberté d’expression, alors que ces acteurs soumettent leurs utilisateurs à l’emprise d’une gouvernance algorithmique de plus en plus insupportable, que cible précisément la notion de « rôle actif » ?
Il est peut-être temps de tirer réellement les conséquences de la célèbre maxime « Code Is Law » de Lawrence Lessig : le droit n’est qu’une sorte de voile dans l’environnement numérique, car c’est le soubassement technique sur lequel s’appuie les usages qui conditionne réellement l’exercice des libertés. Quoi que dise la directive eCommerce, il n’y a quasiment plus rien qui relève de l’exercice de la liberté d’expression sur les plateformes centralisées lucratives, sinon une grotesque parodie qui salit le nom même de la liberté et nous en fait peu à peu perdre jusqu’au sens !
En le lisant « en creux », l’article 13 dessine au contraire l’espace sur Internet où la liberté d’expression peut encore réellement s’exercer : le réseau des sites personnels, celui des hébergeurs ne jouant pas un rôle actif et – plus important encore – les nouveaux services s’appuyant sur une fédération de serveurs, comme Mastodon ou Peertube.
Se doter (enfin) d’une doctrine économique claire
Allons même plus loin : en introduisant le critère de la lucrativité, l’article 13 donne aux défenseurs des libertés sur Internet l’occasion de revoir leur doctrine économique, qui m’a toujours paru constituer un sérieux talon d’Achille dans leurs positions…
Les eurodéputés ont introduit une autre exception afin que l’article 13 ne s’applique pas aux « micro, petites et moyennes entreprises« . Personnellement, je ne me réjouis pas du tout de cette insertion, car sur Internet, « micro-entreprises » veut souvent dire « start-up » et l’on sait que ces jeunes pousses aux dents longues aiment à se construire sur des modèles extrêmement toxiques de captation des utilisateurs et de prédation des données personnelles. Le critère de la taille n’est pas en lui-même pertinent, car tous les Léviathans du numérique ont commencé par être petits avant de grossir. Ce qu’il importe, c’est justement qu’aucun acteur ne soit plus en mesure d’enfler jusqu’à atteindre une taille hégémonique, et pour cela, c’est bien sur le critère de la lucrativité qu’il faut jouer.
Dans son article sur le site de l’EFF, Cory Doctorow estime que l’Union européenne s’est tirée une balle dans le pied avec cette directive Copyright, car elle aurait imposé des contraintes insurmontables à ses propres entreprises, qui ne pourraient plus espérer désormais rattraper les géants américains ou chinois. Mais ces propos me paraissent reposer sur une vision complètement « enchantée » de la concurrence, comme s’il était encore possible de croire qu’un « marché sain » est en mesure de nous sauver des monstruosités qu’il a lui-même engendrées.
Ce qui va se passer à présent avec l’obligation de filtrage automatisée, c’est que les grandes plateformes centralisées lucratives, type YouTube ou Facebook, vont sans doute devenir des espaces où les utilisateurs éprouveront le poids d’une répression « à la chinoise » avec la nécessité de se soumettre à un contrôle algorithmique avant même de pouvoir poster leurs contenus. Le contraste n’en sera que plus fort avec les espaces restant en dehors du périmètre de l’article 13, que les créateurs et leur public seront d’autant plus incités à rejoindre. Doit-on réellement le déplorer ?
Il faut bien voir en outre que le fait de ne pas poursuivre un but lucratif ne signifie pas que l’on ne puisse plus inscrire son activité dans la sphère économique. C’est exactement ce que fait depuis plus d’un siècle l'économie sociale et solidaire, en renonçant volontairement pour des raisons éthiques à poursuivre un but lucratif ou en limitant statutairement sa lucrativité. Voilà donc l’occasion d’en finir par le mythe selon lequel « l’Internet libre et ouvert » serait compatible avec les principes mêmes du capitalisme. C’est précisément cette illusion qui a enclenché le processus fatal de centralisation et cette dérive ne pourra être combattue qu’en revenant à la racine économique du problème.
On retrouve ici le problème de « l’agnosticisme économique » dont j’ai déjà parlé sur ce blog à propos du fonctionnement même des licences libres. En refusant de discriminer selon les types d’usages économiques, les défenseurs du Libre se sont en réalité privés de la possibilité de développer une réelle doctrine économique. C’est ce même aveuglement aux questions économiques qui conduit à des aberrations de positionnement comme celles que l’on a vu au cours de cette campagne contre la directive Copyright. Comment mobiliser autour du mot d’ordre « Save Your Internet », alors que cet « Internet » que l’on a voulu faire passer pour « le notre » comprend en réalité les principaux représentants du capitalisme de surveillance ? C’est le sens même de nos luttes qui disparaît si nous ne nous donnons pas les moyens d’opérer des distinctions claires parmi les acteurs économiques.
Et maintenant, que faire ?
En juin dernier, c’est-à-dire avant même le premier vote sur la directive, La Quadrature du Net a commencé à développer ce type d’analyses, en suggérant de ne pas s’opposer à l’introduction du critère du « rôle actif » des plateformes pour au contraire le retourner comme une arme dans la lutte contre la centralisation :
Tous ces enjeux connaissent un ennemi commun : la centralisation du Web, qui a enfermé la très grande majorité des internautes dans des règles uniques et rigides, qui n’ont que faire de la qualité, de la sérénité ou de la pertinence de nos échanges, n’existant que pour la plus simple recherche du profit de quelques entreprises.
L’une des principales causes de cette centralisation est le frein que le droit a longtemps posé contre l’apparition de son remède – le développement d’hébergeurs non-centralisés qui, ne se finançant pas par la surveillance et la régulation de masse, ne peuvent pas prendre le risque de lourds procès pour avoir échoué à retirer « promptement » chaque contenu « illicite » qui leur serait signalé. Des hébergeurs qui, souvent, peuvent à peine prendre le risque d’exister.
La condition du développement de tels services est que, enfin, le droit ne leur impose plus des règles qui depuis vingt ans ne sont presque plus pensées que pour quelques géants. Prévoir une nouvelle catégorie intermédiaire dédiée à ces derniers offre l’espoir de libérer l’Internet non-centralisé du cadre absurde dans lequel juges et législateurs l’ont peu à peu enfermé.
Dans sa réaction au vote de mercredi, Julia Reda rappelle qu’il ne s’agit pas de la fin du processus et qu’il reste encore une phase de trilogue avec la Commission et le Conseil, ainsi qu’un dernier vote au Parlement, sans doute au Printemps. Elle estime qu’il resterait encore une carte à jouer, en appelant les citoyens à se mobiliser pour faire pression sur leurs gouvernements en espérant que cela puisse encore conduire au retrait de l’article 13. Mais outre que cette hypothèse paraît hautement improbable étant donné les équilibres politiques, elle me paraît relever d’une certaine forme de désarroi, comme s’il y avait encore lieu de chercher à remporter une « bataille décisive » alors que les paramètres stratégiques du combat ont profondément évolué.
L’enjeu n’est pas de chercher – sans doute vainement – à supprimer l’article 13, mais de réussir à délimiter clairement son périmètre pour s’assurer qu’il ne s’appliquera qu’à des acteurs centralisés lucratifs procédant à une hiérarchisation des contenus. Manœuvrer ainsi ferait peser sur les GAFAM une charge écrasante, tout en préservant un espace pour développer un réseau d’acteurs éthiques non-centralisés et inscrits dans une logique d’économie solidaire. Il n’y a qu’au sein d’une telle sphère que l’on puisse encore espérer œuvrer pour un « Internet Libre et Ouvert ».
Il faut aussi sortir de l’urgence immédiate imposée par cette série de votes pour se replacer dans le temps long. De toutes façons, quelle que soit l’issue des dernières négociations, il restera encore plusieurs années (3, 4, peut-être plus ?) avant que la directive ne soit transposée dans les pays de l’Union. C’est un délai appréciable qui nous laisse encore le temps de travailler au développement de cette sphère d’acteurs alternatifs.
Du coup, si vous voulez concrètement faire quelque chose pour « l’Internet Libre et Ouvert », je ne vous conseillerai pas d’appeler votre député, mais plutôt d’aller faire un don à l’association Framasoft, car ce sont eux qui ont sans doute le mieux compris et anticipé les changements nécessaires à opérer dans notre stratégie. Avec PeerTube, l’alternative fédérée à YouTube qu’ils sont en train de bâtir, ils plantent une graine en laquelle nous pouvons encore placer nos espoirs. Et avec le collectif d’hébergeurs alternatifs CHATONS qu’ils ont fait émerger, ils ont déjà préfiguré ce que pourrait être cette alliance du Libre et de l’Economie Sociale et Solidaire dont nous avons besoin pour rebooter le système sur des bases économiques saines.
« Une bataille perdue est une bataille que l’on croit perdue » – Napoléon.
