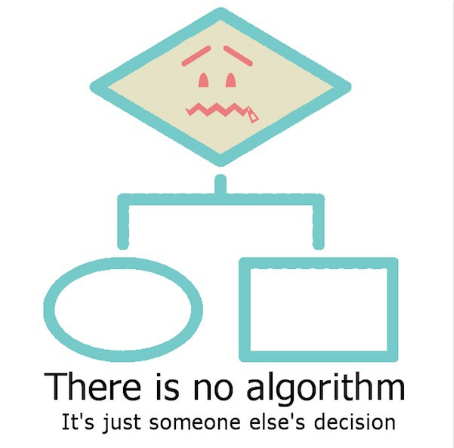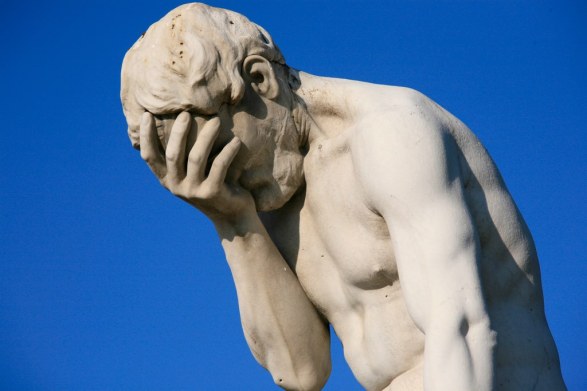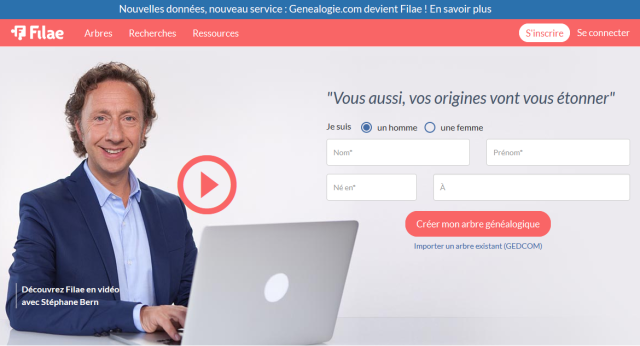Le Conseil d’Etat a rendu la semaine dernière un arrêt important pour trancher un conflit qui durait depuis 10 ans entre une société de photographie et le musée des Beaux Arts de la ville de Tours. Cet établissement refuse en effet depuis 1984 (!!!) d’accorder des autorisations de photographier les pièces de ses collections à d’autres photographes professionnels que ceux qu’il missionne pour réaliser des reproductions des oeuvres figurant sur son site. La société J.L. Josse a considéré que cette politique lui faisait subir une inégalité de traitement et a remis en cause la légalité du règlement intérieur du musée, en s’appuyant notamment sur le fait que les oeuvres qu’il souhaitait photographier appartenaient au domaine public après expiration du droit d’auteur.

Le Conseil d’Etat a balayé cet argument en faisant valoir un argument qui ne manque pas de sel… Il a en effet considéré que les pièces des collections du musée appartenaient à un autre domaine public que celui de la propriété intellectuelle : celui du droit administratif, et plus précisément le régime de la domanialité publique fixé par le Code Général de Propriété des Personnes Publiques (CGPPP). Ce corps de règles déterminent en effet un régime particulier de propriété publique dont bénéficient les administrations sur une partie de leurs biens, en leur imposant des contraintes particulières (inaliénabilité notamment, qui en interdit en principe la vente), mais aussi des pouvoirs de contrôle opposables aux usagers.
Il existe donc deux domaines publics différents dans notre système juridique et le Conseil d’Etat a choisi de faire prévaloir « le sien », à savoir celui de la domanialité publique. Or cette décision va être lourde de conséquences, car elle offre ainsi aux musées un nouvel instrument pour neutraliser les droits d’usage ouverts normalement par le domaine public de la propriété intellectuelle, en justifiant encore un peu plus en France les pratiques de copyfraud. L’issue retenue dans cette affaire est d’autant plus surprenante que le Conseil d’Etat ne prend même pas la peine d’argumenter sa décision alors que, comme on va le voir, son raisonnement s’avère particulièrement bancal et remet en cause des principes importants, tout en véhiculant une image rétrograde de la mission des musées.
La photographie comme « utilisation privative du domaine public mobilier »
Reprenant des principes déjà dégagés en 2012, le Conseil d’Etat explique que « la prise de vues d’oeuvres appartenant aux collections d’un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques« . Un tel raisonnement est surprenant et sa logique paraît franchement discutable.
Le Conseil d’Etat parle ici en effet du domaine public mobilier et non du domaine public immobilier. On aurait pu admettre que l’acte de photographier dans un musée soit analysé comme une forme d’occupation temporaire du domaine public opéré par le photographe professionnel, au sens où celui-ci « occupe » l’espace physique se trouvant devant le tableau ou la sculpture. L’espace des salles d’un musée appartient au domaine public immobilier de la personne publique et, de la même manière que les municipalités peuvent réglementer l’installation de terrasses de café sur les voies publiques, on aurait pu imaginer que les musées étaient en droit de faire de même pour les activités des photographes professionnels. Cette solution aurait pu être intéressante, car elle offrait une voie de conciliation entre des usages différents de l’espace du musée. Si le photographe professionnel demande par exemple à « privatiser » les lieux en empêchant le public d’accéder temporairement à une salle ou en sollicitant le déplacement d’une oeuvre, il paraît légitime que le musée puisse lui refuser ou lui faire payer une redevance pour service rendu, notamment si son personnel est mobilisé.
Mais ce n’est pas le raisonnement que le Conseil d’Etat a suivi. En parlant du « domaine public mobilier », il renvoie directement au droit de propriété que la personne publique possède sur les supports matériels des oeuvres que la société Josse voulait photographier. L’acte de reproduction est étrangement assimilé à une « utilisation privative du bien » que permettrait de contrôler le droit de propriété sur le support. Or le Conseil d’Etat mélange ici deux choses complètement différentes. Ce n’est pas le bien physique que le photographe « utilise » ici : c’est son image qu’il veut ensuite commercialiser à travers la reproduction réalisée. Le Conseil d’Etat adopte une sorte de raisonnement « fétichiste » en faisant comme si l’objet et son image constituaient une seule et même chose…
Or on glisse ici vers la question du droit à l’image des biens, sujet distinct de la domanialité. Jusqu’à une date récente, la jurisprudence (de la Cour de Cassation) nous disait que la propriété d’un bien ne s’étendait pas à son image, sauf si l’usage de celle-ci causait un préjudice anormal à son propriétaire (hypothèse rare, limitée à des cas exceptionnels). En juin dernier, la loi Création est revenue en partie sur ce principe en consacrant un très contestable droit à l’image des biens appartenant aux domaines nationaux (c’est-à-dire plusieurs monuments comme le Louvre, le château de Versailles, le domaine de Chambord, etc.) leur permettant de faire payer les réutilisations commerciales des images des bâtiments.
Nous avions été plusieurs à réagir alors en disant que cette pente suivie par le législateur, déjà en elle-même contestable, pouvait devenir extrêmement dangereuse si elle venait à s’étendre un jour aux collections des institutions culturelles. Or le Conseil d’Etat a fait pire dans son arrêt : il consacre un principe général qui donne au propriétaire public d’un support le pouvoir de contrôler l’image d’une œuvre, même quand c’est un tiers qui la réalise. Il y avait jusqu’alors une sorte de doute sur la « transitivité » du droit de propriété et sa capacité à passer de l’objet à son image. Cette incertitude est à présent dissipée, mais au prix d’un raisonnement complètement bancal !
En effet, le Conseil d’Etat précise dans son arrêt que c’est lorsque la prise de vue est effectuée « à des fins de commercialisation » qu’elle constitue une « utilisation privative du domaine public mobilier« . Or du point de vue de l’acte matériel, le geste du professionnel qui photographie un tableau est substantiellement le même que celui effectué par un simple visiteur et on ne voit pas en quoi il serait davantage « privatif ». La pratique du professionnel ne le devient que si, comme nous l’avons dit plus haut, il installe du matériel particulier dans les salles ou demande à ce qu’elles lui soient temporairement réservées. Mais c’est alors le domaine public immobilier du musée qui fait l’objet d’un usage privatif, et pas le domaine mobilier.
En réalité, c’est la commercialisation que le Conseil d’Etat voulait atteindre, mais ne disposant pas d’autre fondement que la propriété publique sur les supports physiques, il a été contraint de recourir à un raisonnement aux forceps pour en étendre artificiellement la portée…
Le domaine public de la propriété intellectuelle neutralisé
Dans cette affaire, l’aspect le plus important résidait dans un conflit de lois que le Conseil d’Etat devait trancher : entre d’une part le Code de propriété intellectuelle et d’autre part le Code Général de Propriété des Personnes Publiques. La société Josse avait en effet fait valoir que les oeuvres qu’elle voulait photographier appartenaient au domaine public au sens de la propriété intellectuelle et elle soutenait que « la période de soixante-dix ans mentionnée à l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle étant échue, l’exploitation de ces oeuvres [est] libre et gratuite, de sorte que la commune de Tours ne saurait y faire obstacle« . A vrai dire, il était beaucoup plus logique de se situer sur le terrain de la propriété intellectuelle que sur celui de la domanialité publique. Car lorsqu’on photographie un tableau, c’est n’est pas tant le support physique que l’on « utilise » que l’oeuvre qui y est représentée.
Pourtant, le Conseil d’Etat a balayé d’un revers de la main cet argument, en écartant le Code de propriété intellectuelle, sans même prendre la peine de réellement le justifier :
Les dispositions de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’à l’expiration des soixante-dix années suivant l’année civile du décès de l’auteur d’une oeuvre, il n’existe plus, au profit de ses ayants droit, de droit exclusif d’exploiter cette oeuvre, n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’application à des oeuvres relevant du 8° de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques des règles découlant de ce code, et notamment de celles relatives aux conditions de délivrance d’une autorisation devant être regardée comme tendant à l’utilisation privative de ce domaine public mobilier.
La lecture de ce passage péremptoire est assez fantastique, car il y avait au contraire des arguments solides pour justifier l’application du Code de propriété intellectuelle. Celui-ci contient en effet à l’article L. 111-3 un des principes fondamentaux de la matière, dit « principe d’indépendance des propriétés intellectuelle et matérielle » :
La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
Or ici, le Conseil d’Etat méconnaît l’esprit de cette disposition, car il s’appuie sur la propriété de l’objet matériel pour reconstituer, en passant par la domanialité publique, un crypto-droit de propriété incorporelle sur l’oeuvre, là où il ne devrait plus y en avoir. A quoi sert-il que le législateur ait fixé une durée déterminée aux droits patrimoniaux sur une oeuvre si le propriétaire public du support peut faire renaître à sa guise un équivalent au droit de reproduction et de représentation ? Le Conseil d’Etat admet « l’application à des oeuvres relevant du 8° de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques des règles découlant de ce code », or le CGPPP n’a jamais été conçu pour s’appliquer à des oeuvres de l’esprit, mais uniquement aux objets matériels formant les collections des musées visées par cet article.
On est dans une situation où le domaine public a une nouvelle fois pâti de n’être défini que de manière négative dans le Code de propriété intellectuelle. Cette « infériorité structurelle » permet au Conseil d’Etat de le balayer allègrement face au droit de propriété des personnes publiques qui bénéficie d’une consistance légale bien plus affirmée. En 2013, lorsque la députée Isabelle Attard a déposé une proposition de loi pour consacrer une définition positive du domaine public, nous avions pris la précaution d’anticiper ce conflit de lois potentiel avec un article 10 qui prévoyait justement que les dispositions du Code Général de Propriété des Personnes Publiques devaient s’interpréter comme s’appliquant « sans préjudice » des principes posées par le Code de propriété intellectuelle. Le Conseil d’Etat a fait exactement l’inverse dans cet arrêt…
Cette jurisprudence va donc continuer à vider peu à peu de sa substance le domaine public de la propriété intellectuelle. Comme j’ai déjà eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises sur ce blog, la loi Valter adoptée en décembre 2015 a déjà donné aux institutions culturelles le pouvoir de contrôler les reproductions qu’elles réalisent à partir des objets figurant dans leurs collections, en les assimilant (encore une fois artificiellement) à des « données publiques ». A ce verrouillage en aval vient donc s’ajouter à présent un verrouillage en amont qui va permettre au musée d’interdire ou de faire payer la prise de vue par des tiers lorsqu’ils agissent dans un but commercial.
Le domaine public de la propriété intellectuelle devient ainsi de plus en plus « théorique », enseveli peu à peu sous des couches de droits connexes qui neutralisent son effectivité.
Des justifications rétrogrades avalisées sans discussion par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a donc reconstitué au profit des musées un pouvoir d’autoriser ou d’interdire, presque aussi puissant que celui d’un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un pouvoir complètement discrétionnaire, dans la mesure où le Conseil d’Etat a examiné les justifications qui étaient avancées par le musée :
les motifs avancés par la commune pour justifier la décision de refus […] étaient tirés de ce qu’elle entendait conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles sont établies et diffusées des reproductions photographiques des oeuvres exposées dans le musée et de ce qu’une diffusion excessive de telles reproductions pourrait préjudicier à l’attractivité de ce musée et nuire à sa fréquentation par le public.
Le problème, c’est que le Conseil d’Etat s’est contenté de vérifier que ces motifs étaient de nature à justifier l’interdiction, en relevant qu’ils « se rapportent à l’intérêt du domaine public et de son affectation ». C’est extrêmement léger et la discussion aurait dû porter un minimum sur la validité de ces arguments. En effet, il est assez incroyable d’entendre en ce début de 21ème siècle un musée justifier une interdiction de photographie par la crainte que les visiteurs désertent les salles si des reproductions venaient à se diffuser à l’extérieur. Un tel lien de cause à effet n’a jamais été démontré et l’idée que des images d’oeuvres culturelles puissent faire l’objet d’une « diffusion excessive » est proprement hallucinante. Des oeuvres comme la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace ont fait l’objet d’une immense diffusion et ce sont pourtant celles que le public continue à aller voir en priorité lorsqu’il se rend au Louvre…
L’argument est donc déjà en lui-même suspect, mais quand bien même la diffusion des images occasionnerait une baisse de fréquentation des musées, il resterait irrecevable. Car l’essence de la mission des musées n’est pas de remplir leurs salles, mais de diffuser la culture le plus largement possible. L’intérêt général qu’ils servent n’est pas l’intérêt propre de l’établissement, mais celui du public entendu aujourd’hui à l’échelle planétaire. Imposer aux visiteurs de venir sur place pour voir les oeuvres constitue une vision particulièrement rétrograde de la fonction des musées et c’est pourtant celle que le Conseil d’Etat a choisi d’analyser, sans même la discuter.
Notons qu’à l’étranger, plusieurs établissements ont mis en place des politiques radicalement opposées en mettant à disposition du public des reproductions numériques en haute définition des objets de leurs collections sur leur site et en autorisant très largement les réutilisations, y compris dans un cadre commercial. C’est le cas par exemple du Rijksmuseum d’Amsterdam, qui a choisi depuis plusieurs années de placer plus de 500 000 images sous licence CC0, y compris les trésors les plus précieux conservés par l’établissement. Or cette stratégie a accru considérablement la visibilité de l’institution, sans lui occasionner aucune perte de fréquentation, bien au contraire !
Une nouvelle « ligne Maginot » sur la Culture
Cet arrêt du Conseil d’Etat est donc incohérent sur le plan juridique et rétrograde quant à l’image qu’il renvoie des musées, en plus de porter atteinte aux droits du public qui devraient être protégés à travers le domaine public de la propriété intellectuelle. C’est typiquement le genre de décisions qui discréditent le juge administratif en renforçant le soupçon qu’il est avant tout un « juge de l’administration » plutôt qu’un garant des droits fondamentaux, surtout quand on voit la pauvreté et la faiblesse de la motivation du jugement.
La domanialité publique a normalement pour but de faire en sorte que certains biens restent affectés « à l’usage du public » par le biais des services publics pris en charge par les administrations. Ici, elle est au contraire instrumentalisée et atrophiée à travers une lecture « propriétariste » qui donne à l’administration un pouvoir discrétionnaire de trier parmi les usages afin de se réserver un monopole de diffusion que plus rien ne justifie à l’heure du numérique.
Sans compter que cette nouvelle « Ligne Maginot » érigée autour de la Culture sera sans doute inefficace. En effet, les principes posés par le Conseil d’Etat concernent les photographies réalisées dans un but de commercialisation des reproductions. Mais rien n’interdit aux simples visiteurs de continuer à prendre des photos des oeuvres et, lorsque celles-ci appartiennent au domaine public, de les rediffuser largement y compris sur Internet. Par ailleurs, une fois qu’un visiteur a pris une photo, il est parfaitement possible de la placer sous une licence comme la CC0 ou la Public Domain Mark, qui ne restreignent pas les usages commerciaux. Cela permettra de continuer à alimenter des sites comme Wikimedia Commons ou Internet Archive, qui sont aujourd’hui les véritables gardiens des droits du public sur la Culture, là où les institutions culturelles sombrent si souvent dans une vision mercantile et étriquée de leur rôle.
Ce qui est regrettable dans cette histoire, c’est qu’en 2014 le Ministère de la Culture avait fait paraître une charte « Tous Photographes » consacrée aux « bonnes pratiques dans les musées et autres établissements nationaux ». Ce document était porteur d’une vision équilibrée dans la mesure où il incitait les musées à encadrer, mais à ne pas interdire la pratique de la photographie, en allant même jusqu’à prendre en compte la notion de domaine public au sens de la propriété intellectuelle. A l’inverse d’une vision frileuse, la charte recommandait même aux établissements de « mettre à disposition gratuitement sur son site internet des reproductions numériques de ses collections avec mention claire des conditions d’utilisation conformément à la doctrine du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de l’ouverture et du partage des données publiques culturelles. »
Mais il aurait fallu aller plus loin qu’une simple Charte et mettre ces principes dans la loi pour les imposer aux établissements et les placer hors d’atteinte du juge administratif, ce que ni la loi Création, ni la loi numérique n’ont permis de faire, bien au contraire.
***
Il reste à espérer que les directions des musées, et les collectivités dont elles dépendent, sauront mettre en place des politiques d’ouverture plutôt que de se tirer une balle dans le pied, comme le Conseil d’Etat les invite à le faire…
Classé dans:
Bibliothèques, musées et autres établissements culturels,
Domaine public, patrimoine commun Tagged:
conseil d'Etat,
Domaine public,
domanialité publique,
musées,
photographie,
Propriété intellectuelle