Yesterday copyright seemed so far away
mardi 11 septembre 2012 à 16:56 Léna, alias K_rho sur Twitter, thésarde en Intelligence Artificielle et wikimédienne, nous propose un article fascinant sur un dispositif de « Mashup Assisté Par Ordinateur », qui interroge les frontières du droit d’auteur, dans la lignée du billet que j’avais consacré au cas du Photomaton.
Léna, alias K_rho sur Twitter, thésarde en Intelligence Artificielle et wikimédienne, nous propose un article fascinant sur un dispositif de « Mashup Assisté Par Ordinateur », qui interroge les frontières du droit d’auteur, dans la lignée du billet que j’avais consacré au cas du Photomaton.
Merci à elle ! Retrouvez Léna sur son blog : Alpha Kilo Bit.
***
Si la propriété intellectuelle se pose comme un cadre incontournable de la création, il existe en réalité de nombreux points morts qui ne peuvent absolument pas être analysés selon ses règles.
Nous allons parler d’un objet totalement hors cadre créé non pas par d’artistes mais de chercheurs en intelligence artificielle : Gabriele Barbieri, François Pachet, Pierre Roy et Mirko Degli Esposti. Ils ont en effet réussi à mettre au point un système automatique de génération de paroles de chansons basé sur l’analyse et l’exploitation des chansons existantes.
La première partie de leur travail consiste à prendre une chanson existante et de n’en garder que la rythmique et la versification (les fameux deux quatrains suivis de deux tercets du sonnet classique). Cette première base sert de structure à la création de la chanson.
La seconde partie consiste en la création de dictionnaires de rythmes (ensemble des mots de deux, trois, quatre syllabes), de rimes et de champs lexicaux. De manière plus intéressante, ils génèrent aussi des dictionnaires de style, à l’aide d’une analyse statistique de l’ensemble des paroles d’un artiste.
La troisième partie, la plus technique, est un réseau de Markov permettant la génération automatique de phrases, sous contrainte. Les contraintes peuvent être un rythme imposé, une rime, un champ lexical ou un mot.
Enfin, une fois une structure et un style choisi, le réseau de Markov va générer des propositions de vers parmi lesquelles un opérateur humain va choisir. Le dialogue entre l’humain et le réseau peut être visualisé dans une vidéo en anglais générant un remix de Yesterday des Beatles dans le style de Bob Dylan.
La question passionnante est la suivante : qui peut réclamer des droits d’auteur sur la chanson finale ?
On peut déjà écarter Les Beatles, car la structure rythmique de Yesterday n’est pas en elle-même une création originale mais une reprise de structures déjà existantes. Pour Bob Dylan, dont pourtant l’ensemble de l’oeuvre a été exploité, on ne peut pas non plus parler d’oeuvre de l’esprit pour un champ lexical. Concernant les chercheurs, ils ont effectivement produits un outil, mais ils ne peuvent pas plus prétendre à la parternité des chansons produites avec leur système de la même manière que Canon au Nikkon avec les photographies prises avec leur matériel. Reste l’humain faisant le choix des propositions qu’il préfère, mais, pour reprendre les propos de l’un des chercheurs, “il n’y a pas plus de processus créatif lorsqu’un humain choisit parmi les propositions du système que lorsqu’une personne va au cinéma et choisit le film qui lui semble le mieux”.
Au final, on se rend compte que la nouvelle chanson créée est bien une oeuvre, mais collective, un remix basé sur l’ensemble des oeuvres existantes aidé d’un outil automatique et d’un peu de sensibilité et non pas le fruit de la création ex nihilo d’un auteur unique. Comme le disait Joëlle Farchy : “Il se pourrait que la notion d’auteur [...] ne soit qu’une construction sociale et culturelle éphémère de quelques siècles, qui s’évanouisse dans la cyberculture.”
***
Quelques mots de commentaires, par Calimaq
Comme l’indique Léna en introduction, ce type de création soulève des questions troublantes sur les frontières du droit d’auteur, dès lors qu’interviennent dans l’élaboration des oeuvres des processus automatiques. C’était déjà ce qui m’avait intéressé dans le cas du Photomaton, dont on peut se demander s’il ne constitue pas un « automatauteur ».
Ici, on peut effectivement se poser la question de savoir si le texte de cette chanson produit par le dispositif Perec, (pas la mélodie de Yesterday, que l’on entend dans la vidéo et qui est bien protégée par des droits), ne constitue pas un de ces objets qui échappent au droit d’auteur.
Du point de vue des juges français, peut-être que l’intervention de l’opérateur humain pour choisir certaines paroles parmi un ensemble de propositions, même si elle reste minimale, serait tout de même considérée comme exprimant une certaine forme « d’originalité », offrant prise au droit d’auteur. Mais comme le fait remarquer Léna, ce n’est pas certain.
A vrai dire, cette question des frontières du droit d’auteur s’est déjà posée à partir de la première moitié du 20ème siècle, à propos des expérimentations de la musique aléatoire. Ici, ce n’est cependant pas l’aléa qui est provoque l’incertitude juridique, mais le fait que la machine « élabore » le corps même de l’oeuvre, à partir d’un ensemble de contraintes prédéfinies.
Ces cas risquent à l’avenir de se multiplier, avec les progrès de l’intelligence artificielle et les robots, comme vous pouvez en voir un exemple ci-dessous avec ces robots-intruments, capables de composer et d’interpréter des morceaux tous seuls.
Depuis que j’ai écrit l’article sur le Photomaton, j’ai repéré de nouveaux « automatauteurs » potentiels, dont certains soulèvent des questions juridiques assez fascinantes.
Ainsi pendant les Jeux olympiques de Londres, les grandes agences (AFP, Reuters, Getty, etc) avaient déployé de nombreux robots-photographes dans les stades, afin de pouvoir prendre des clichés sous des angles inhabituels.
Il en résulte des clichés parfois très impressionnants sur le plan esthétique, mais qui ne satisfont pas au critère de l’originalité, si l’on en croit la jurisprudence existant déjà à propos des photos sportives prises en rafale. L’originalité ressurgit sans doute au niveau du choix des clichés publiés, dans lequel intervient sûrement des humains, mais le matériau brut échappe au droit d’auteur.
Un autre exemple intéressant est celui des images envoyées depuis la planète Mars par le robot Curiosity.
Sur Exponaute, Magali Lesauvage écrit ceci au sujet de ces photographies de la planète rouge, soulevant à nouveau la question de l’originalité :
Cette photo a été prise par un robot, sans recherche esthétique ni volonté de plaire, mais comme témoignage scientifique. C’est une photo de paysage objective, sans mise en scène ni ordre de composition. Comparable à des photographies de déserts terrestres, elle n’est pas sans beauté, mais n’a pas d’originalité, pas de punctum (cet élément surprenant évoqué par Roland Barthes dans La Chambre claire, et qui fait qu’une image marque l’esprit du spectateur). Point de petit bonhomme vert, d’extraordinaire cité futuriste, ni même d’accident géologique remarquable… Las, l’image est déceptive. Rien ici qui ne soit aussi visible en certains lieux terrestres : Mars ressemble désespérément à la Terre, malgré l’absence d’eau et de vie. Ce qu’elle nous montre, fondamentalement, c’est le vide, le rien.
Ce vide est aussi normalement juridique, car ces clichés pris par un robot ne devraient pas donner prise au copyright. La NASA autorise de toutes façons largement la réutilisation de ses images, comme si elles appartenaient à un quasi-domaine public.
Toujours dans le domaine de la photographie, j’étais tombé sur cet article, qui signalait une nouvelle pratique se développant parmi les joueurs de jeux vidéos : les In-Game Photographies. Elle consiste pour les joueurs à faire des captures d’écran au cours du jeu pour donner à voir des scènes remarquables. Certains (comme ici) en font même une sorte d’art à part entière, mais ces clichés se sont pas sans soulever des questions complexes de droit d’auteur :
While the photography is quite stunning it leaves me wondering… who is the artist? The photographer who froze and altered the shot or the game developers who created the entire scene in the first place? I have several friends who are game developers and are amazing artists that spend months to years developing a game. The photographers that I have seen practicing this have all been very respectful of game developers and credit them as much as possible. I wonder if copyright will ever become an issue for those into in-game photography. What are your thoughts ?
Difficile de répondre, bien que la question renvoie dans une certaine mesure au cas des machinimas, ces cinématiques tournées par des amateurs à partir des moteurs graphiques de jeux vidéo.
Le dernier cas d’automatauteurs que j’ai repéré rejoint les centres d’intérêt de Léna puisqu’il concerne les fameux bots qui contribuent à la mise en forme de Wikipédia. Ils interviennent automatiquement pour formater correctement les citations, pour classer les articles dans des catégories, pour repérer des injures ou des violations de droit d’auteur et bien d’autres choses encore ! La BBC leur a consacré un article récemment dans lequel elle finit par s’interroger sur la nature de la contribution de ces robots et sur le point de savoir s’ils ne pourraient pas remplacer les contributeurs humains :
Can bots replace human writers?
These days bots are typically forbidden from writing their own articles and from other writerly tasks like sub-editing. Here’s why:
- Regional differences confound them: The BBC writes « flavour », for example, while the Associated Press uses the American « flavor »
- English grammar is too nuanced to be automated.
- Bots cannot do research, in the sense of seeking and synthesising information to support a thesis
Les journalistes de la BBC semblent donc considérer que les robots ne pourront jamais remplacer les rédacteurs humains, mais en est-on si sûr ? On apprenait récemment que certains articles boursiers du magazine Forbes étaient écrits par un robot appelé Narrative Science, à partir de données.
Merci encore à Léna pour sa contribution, qui permet de revenir dans S.I.Lex sur ce sujet passionnant !
Et si vous aussi vous connaissez des cas d’automatauteurs, n’hésitez pas à les signaler en commentaire.
Classé dans:Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: Beatles, Bob Dylan, copyright, droit d'auteur, intelligence artificielle, musique, originalité, robots
![]()






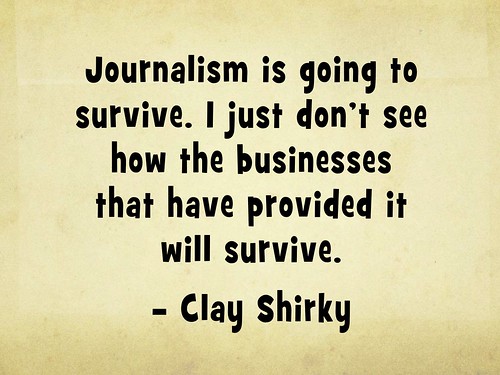






















 Il s’agit en réalité d’une application tierce, appelée
Il s’agit en réalité d’une application tierce, appelée 