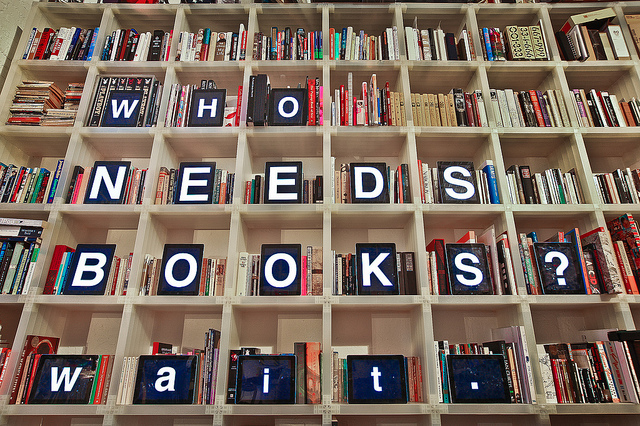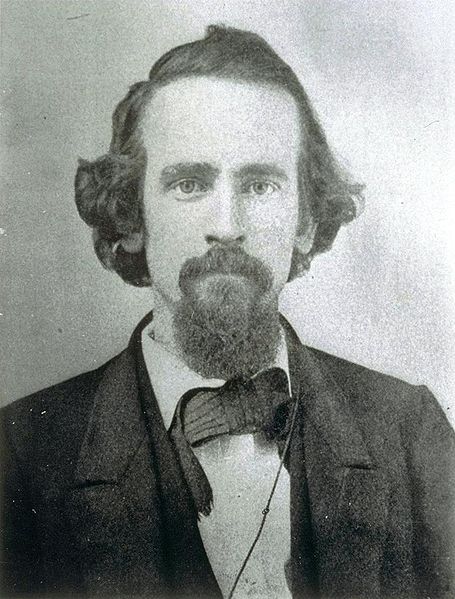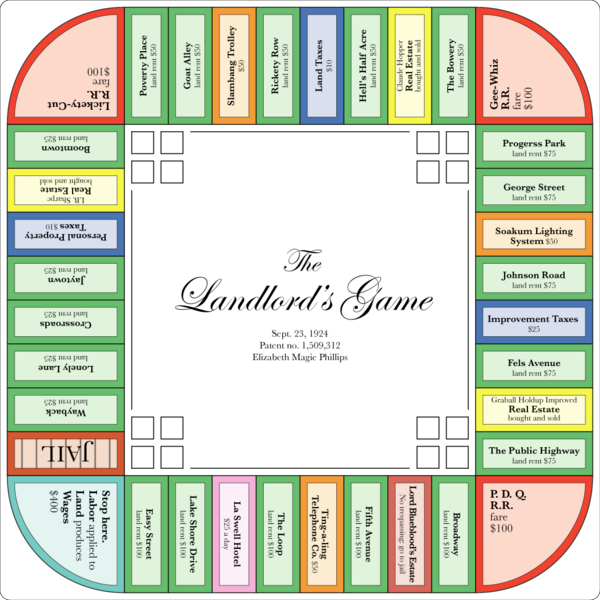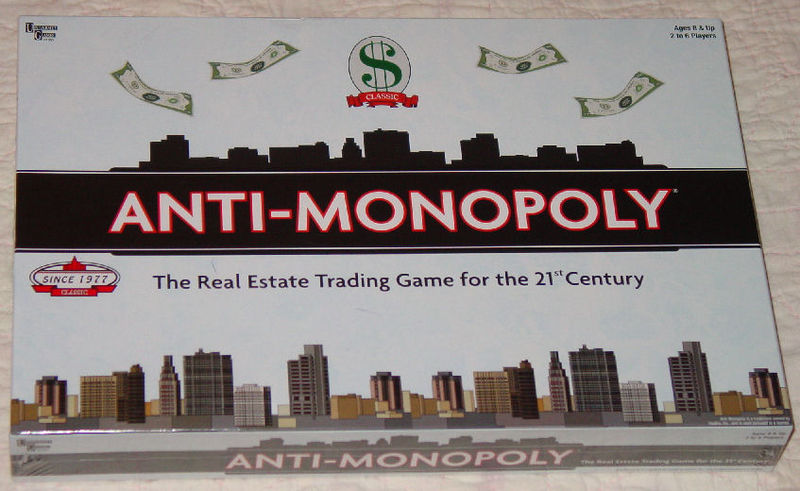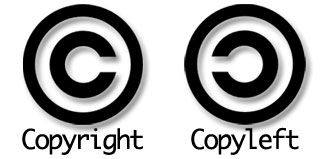Légalisation du partage et livre numérique en bibliothèque : même combat ?
lundi 26 août 2013 à 20:22A priori, la question de la légalisation du partage et celle du livre numérique en bibliothèque peuvent paraître assez éloignées, même si elles concernent toutes les deux l’accès à la culture et à la connaissance. Néanmoins, l’association EBLIDA, représentant les bibliothèques et les centres de documentation au niveau européen, a publié cet été une déclaration relative au livre numérique en bibliothèque qui jette un pont intéressant avec la question du partage.
Intitulé "The Right To E-Read", ce texte s’inscrit dans le cadre d’une campagne lancée depuis l’an dernier par Eblida pour défendre l’accès aux livres numériques dans les bibliothèques publiques en Europe. L’originalité de cette prise de position, destinée à interpeller la Commission européenne, réside dans le fait qu’elle invoque le mécanisme juridique de l’épuisement des droits, comme un fondement possible et souhaitable pour la mise à disposition de livres numériques en bibliothèque. Or c’est sur ce point qu’il y a rapprochement possible avec la question de la légalisation des échanges non-marchands. La Quadrature du Net propose en effet de recourir à l’épuisement des droits pour consacrer la possibilité pour les individus d’échanger des fichiers correspondant à des oeuvres protégées sans but de profit.
Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, la question du "prêt numérique" en bibliothèque se pose depuis plusieurs années, mais c’est à mon sens la première fois que je vois des représentants des bibliothèques en Europe se tourner vers l’épuisement des droits pour défendre leur position. Il me semble que cette stratégie adoptée par Eblida est intéressante, justement par le rapprochement qu’elle permet avec la question de la légalisation du partage.
Pour un droit de lire en numérique en bibliothèque
Pour comprendre exactement de quoi il retourne, je traduis ci-dessous la seconde partie de la déclaration "The Right To E-Read", qui aborde directement le sujet de l’épuisement des droits :
- En raison de l’épuisement du droit de distribution après la première vente, une bibliothèque publique est en mesure d’acheter une oeuvre publiée, comme un livre, chez un libraire et d’utiliser des exemplaires pour les prêter à ses usagers. Cela n’interfère pas avec les droits de l’auteur (ou d’autres titulaires de droits). La bibliothèque peut alors en conséquence décider en accord avec sa politique documentaire quels livres elle souhaite acquérir et prêter.
- D’après leur interprétation du droit d’auteur, les éditeurs affirment que le prêt numérique est un service auquel le principe de l’épuisement des droits ne s’applique pas. Ils pensent que les titulaires de droits sont libres de décider s’ils veulent donner accès à une oeuvre spécifique et selon quelles conditions. Si cette interprétation s’imposait, cela signifierait que ce serait les éditeurs, et plus les bibliothécaires, qui décideraient quelles doivent être les collections numériques dans les bibliothèques.
- Il se produira un tournant majeur, et de notre point de vue inacceptable, si l’on laisse ainsi aux éditeurs la possibilité de décider de la politique documentaire des bibliothèques. Cela signifierait que les bibliothèques ne seraient plus en mesure de garantir un accès libre à la culture et l’information pour les citoyens.
- En juillet 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé que le principe de l’épuisement des droits à propos de l’achat d’un logiciel s’appliquait à la fois au fichier numérique et au support physique. Certains experts juridiques estiment que, d’après ce jugement, l’épuisement des droits serait aussi applicable aux livres numériques. Plusieurs affaires en justice sont pendantes actuellement devant les tribunaux, qui auront valeur de test. Mais il faudra plusieurs années avant que la CJCE rende un jugement.
- Cette incertitude juridique empêche les bibliothèques de développer des services attractifs autour des livres numériques pour leurs publics et au-delà de mettre en place des offres légales dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.
C’est pourquoi Eblida en appelle à la Commission européenne pour mettre en place un cadre juridique clair qui permettrait aux bibliothèques d’acquérir et de prêter en rémunérant de manière appropriée les auteurs et autres titulaires de droits. Comme avec les livres imprimés, une révision du cadre du droit d’auteur permettra aux bibliothèques de continuer à remplir leurs missions au bénéfice des citoyens européens.
Et si le prêt numérique échappait au droit européen ?
A la première lecture, j’avoue avoir eu un peu de mal à suivre Eblida dans son raisonnement. En effet, l’activité de prêt public d’oeuvres protégées est régie en Europe par une directive européenne, adoptée en 1992 pour harmoniser les droits de prêt et de location en Europe. Elle prévoit explicitement que le prêt public relève du droit de distribution dont bénéficie les titulaires de droits, alors que cette question faisait débat jusqu’à son intervention. Cette directive a été transposée en France par le biais d’une loi en 2003, qui a mis en place un système de licence légale pour le prêt des ouvrages physiques en bibliothèque.
A priori, on pourrait donc se dire que le "prêt numérique" des ebooks relève de ce mécanisme et qu’il n’est donc pas en dehors de l’orbite des prérogatives des titulaires de droits, comme le laisse entendre Eblida dans sa déclaration. Mais c’est sans doute aller trop vite dans le raisonnement et le texte d’Eblida permet justement de réinterroger ce qui paraissait comme une évidence.
C’est précisément à cette conclusion qu’est arrivé un rapport du Ministère de l’Éducation et de la Culture publié en mars dernier aux Pays-Bas. Voici ce que le site Actualitté disait à propos de cette étude :
Selon l’IVIR, l’institut pour les lois de l’information, le droit féodal du royaume ne couvre que les copies physiques de livre dans le cadre de la circulation et la reproduction. Par voie de conséquence, les livres numériques sont en l’état interdits de prêt. Ou, pourrait-on dire, invisibles en matière juridique. A moins de se lancer dans de bien fastidieux accords contractuels entre les parties concernées « tels que les auteurs, les éditeurs, les organisations des droits, des distributeurs et des bibliothèques » , a expliqué le ministre de l’éducation, Jet Bussmaker.
Eblida est visiblement d’accord avec la première partie de l’analyse (les livres numériques ne sont pas couverts par la directive de 1992 sur le prêt), mais pas avec la seconde (les livres numériques sont en l’état interdits de prêt). Eblida estime en effet que l’activité de mise à disposition de livres numériques par les bibliothèques pourrait être couvert par le mécanisme de l’épuisement des droits, ce qui la placerait en dehors du champ du droit d’auteur.
Néanmoins, Eblida précise que cette affirmation n’a pas encore été confirmée par la jurisprudence européenne. Elle fait référence à l’importante décision Usedsoft de 2012, par laquelle la CJCE a estimé que la revente de logiciels était possible sur la base de l’épuisement des droits. Mais on ne sait pas encore si un tel raisonnement pourrait être retenu pour des livres numériques. En avril 2013, une Cour fédérale allemande a visiblement estimé que la revente d’occasion d’ebooks n’était pas possible. Mais cela ne nous dit pas quelle serait la position de la CJCE si elle était saisie d’une telle affaire, ni non plus si la mise en disposition en bibliothèque doit être traitée de la même manière que la revente. En Angleterre pendant ce temps, le législateur va visiblement intervenir pour mettre en place un droit de prêt numérique au profit des bibliothèques, ce qui tend aussi à prouver que cette activité est en dehors du périmètre de la directive de 1992 (sinon l’Angleterre ne pourrait pas agir sur ce terrain de son propre chef).
L’épuisement des droits, terrain favorable pour les bibliothèques
Il y aurait en effet un grand avantage pour les bibliothèques à ce que la mise à disposition de livres numériques à leurs usagers relève du mécanisme de l’épuisement des droits. En effet, cela signifierait qu’à l’inverse d’une exception ou d’une licence légale, cette activité sortirait complètement du champ du droit d’auteur. La conséquence en serait qu’une rémunération des titulaires de droits ne serait pas obligatoire (aux États-Unis, le prêt de livres physiques se fait sur la base d’un mécanisme proche de l’épuisement des droits – First Sale Doctrine – et il ne donne lieu à aucune rémunération, si ce n’est l’achat des livres physiques). Et si une rémunération était tout de même envisagée au profit des auteurs et des éditeurs, l’épuisement des droits aurait encore pour avantage qu’elle n’aurait pas à être organisée comme une compensation pour un préjudice subi.
Personnellement, j’aurais donc tendance à penser que tout comme pour la légalisation du partage non-marchand entre individus, l’épuisement des droits constituerait sans doute le terrain le plus favorable pour les bibliothèques, même s’il n’est pas garanti que cette interprétation soit au final retenue.
Si l’on considère au contraire, comme le font les éditeurs, que l’activité de mise à disposition des livres en bibliothèques ne relève pas de l’épuisement des droits, on peut alors faire jouer les mécanismes du droit d’auteur, soit sur une base contractuelle (comme c’est le cas au Québec par exemple), soit sur une base légale (comme va le faire l’Angleterre) pour donner une assise juridique à ces mises à disposition d’oeuvres protégées.
Sortir du piège du "prêt numérique" en bibliothèque
Mais un certain nombre de bibliothécaires considèrent qu’accepter de positionner le livre numérique en bibliothèque sur ce terrain est très dangereux, car cela ne peut conduire qu’à des offres étroitement contrôlées par les éditeurs, tant au niveau des contenus que des prix et des conditions de mise à disposition, avec un recours massif aux DRM pour empêcher la dissémination. Silvère Mercier sur son blog tire la sonnette d’alarme depuis un moment déjà, en essayant de sensibiliser les professionnels français à cette problématique et en leur montrant que d’autres modèles que le prêt de livres numériques "chronodégradables" sont possibles.
En France pourtant, il semble bien que l’on s’achemine vers un système contractuel, dans le cadre du projet PNB développé par Dilicom (PNB pour Prêt Numérique en Bibliothèque). Bénéficiant visiblement du soutien du Ministère de la Culture (à qui il économisera la lourde tâche de devoir faire preuve de courage politique en légiférant), PNB laissera les éditeurs libres de choisir leur modèle de diffusion et on peut parier que beaucoup opteront pour des DRM attachés aux fichiers.
Dans ce contexte, qui va placer les bibliothécaires français face à un choix difficile, il me semble que l’approche prônée par Eblida est infiniment préférable. Le terrain de l’épuisement des droits n’est sans doute pas celui qui sera le plus simple à actionner politiquement, mais il est celui qui respecte le mieux les droits culturels des citoyens, tout en n’excluant pas la mise en place d’une rémunération équitable pour les auteurs et éditeurs. A défaut, mettre le doigt dans le piège des DRM chronodégrables reviendra pour les bibliothèques à participer au mouvement d’érosion des droits des individus vis-à-vis des contenus culturels et à se tirer une balle dans le pied sur le long terme. Beaucoup rêvent de transfomer les bibliothécaires en verrouilleurs d’accès plutôt qu’en donneurs d’accès. La question du livre numérique peut leur donner une occasion en or de réaliser ce dessein…
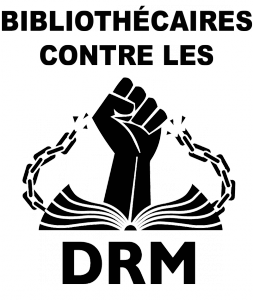
Miser sur l’épuisement des droits, c’est aussi saisir l’opportunité de constituer un front politique élargi, en se joignant aux militants qui agissent pour la légalisation du partage entre individus. Et si cette question est toujours présente en France malgré les conclusions du rapport Lescure, c’est bien au niveau européen qu’il est le plus important d’agir, car c’est à ce niveau qu’une telle réforme peut intervenir.
L’angle d’attaque retenu par Eblida paraît donc extrêmement intéressant et il serait bon que les bibliothécaires français examinent très sérieusement cette option, avant de s’engager sur des terrains minés où il sera très difficile de peser. J’aurais cependant une remarque à faire à propos de la manière dont Eblida présente la question de l’épuisement des droits.
Il est à mon sens crucial de cesser même d’employer la fausse métaphore du "prêt numérique", qui ne peut qu’occasionner des glissements dans le raisonnement et ramener aux DRM. On ne peut réfléchir avec des fichiers numériques (par définition non rivaux) comme on le fait avec des exemplaires physiques. Le "prêt" d’un livre numérique n’a en réalité aucun sens, sauf à vouloir reconstituer artificiellement de la rareté dans l’environnement numérique. Le même raisonnement peut être tenu à propos de la revente d’occasion de fichiers numériques, qui n’a pas plus de sens, comme la Quadrature du Net l’a rappelé dans cette déclaration.
A vrai dire, si le partage entre individus venait à être légalisé, on peut penser que l’essentiel de la fonction de fourniture des œuvres en numérique serait directement assurée par les réseaux décentralisés. Internet deviendrait la Bibliothèque, mais cela ne veut pas dire que les bibliothèques deviendraient inutiles : leur rôle se déplacerait sans doute vers des fonctions de médiation numérique, ainsi que vers la reconfiguration de leurs espaces physiques. C’est déjà d’ailleurs une tendance largement engagée, pour le plus grand bien de la profession, dans beaucoup d’établissements.
***
La Commission européenne a annoncé qu’elle envisageait une réouverture de la directive de 2001 sur le droit d’auteur et des consultations sont engagées à ce sujet, y compris en France. Le moment est donc bien choisi pour Eblida d’attirer l’attention de la Commission européenne sur l’épuisement des droits.
Légalisation du partage et place du livre numérique en bibliothèque ne sont peut-être pas des combats exactement superposables, mais ils pourraient entretenir des liens beaucoup étroits si une compréhension plus claire des enjeux se faisait. Il y aurait grand intérêt à ce que bibliothécaires et militants des libertés numériques agissent de concert sur des bases communes. La déclaration d’Eblida permet dans tous les cas d’engager un débat, dont on espère qu’il se prolongera.
Mise à jour du 27/08/2013 : L’IFLA, l’organisation internationale représentant les bibliothèques, a publié une autre déclaration intitulée "Libraries, e-Lending and the Future of Public Access to Digital Content". Elle critique fortement le recours aux DRM dans le contexte des bibliothèques, au nom de la défense des leurs missions fondamentales.
Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: épuisement des droits, Bibliothèques, Commission européenne, EBLIDA, eBooks, livres numériques, partage