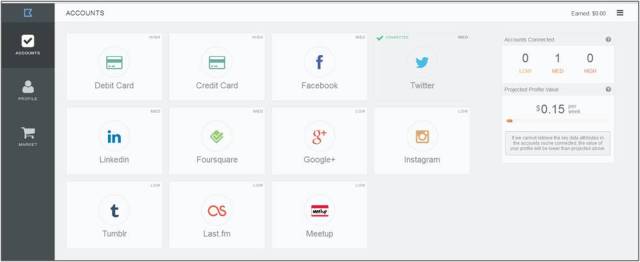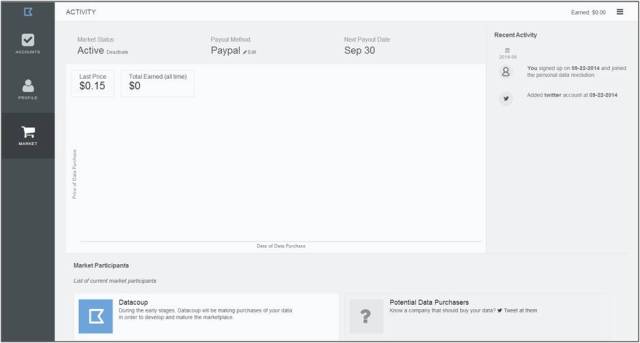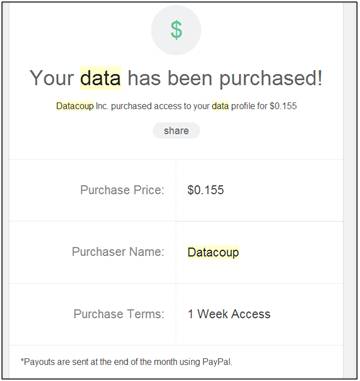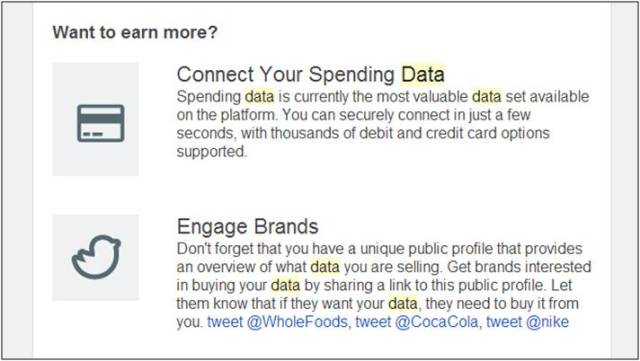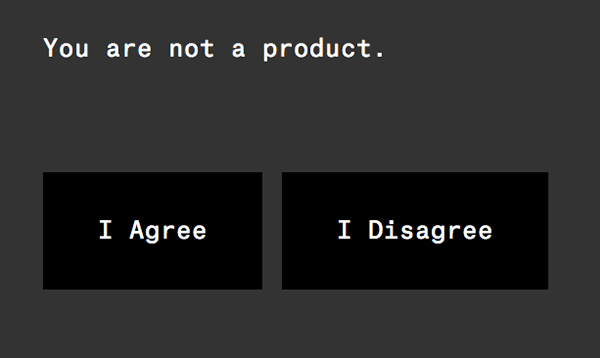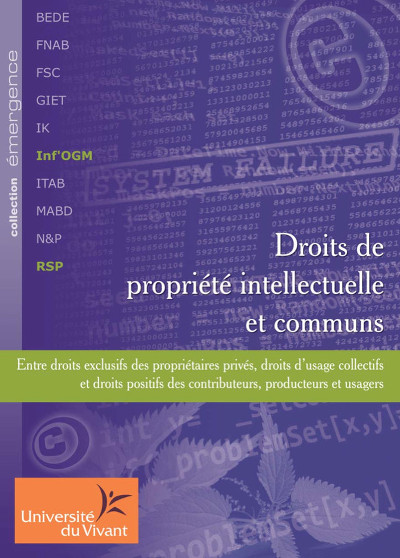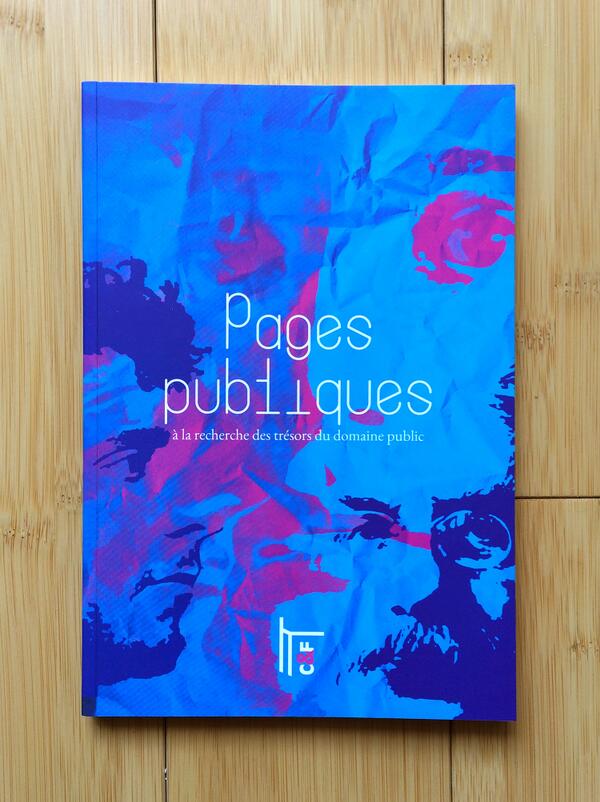Inf’OGM et le Réseau Semences Paysannes viennent de publier une brochure intitulée « Droits de propriété intellectuelle : entre droits exclusifs des propriétaires privés, droits d’usage collectifs, droits positifs des contributeurs, producteurs et usagers« . Cette parution constitue la synthèse d’une rencontre organisée par le Réseau Semences Paysannes, visant à croiser les approches concernant les questions de propriété intellectuelle d’acteurs différents agissant dans les sphères des logiciels, de la culture libre, des semences, des OGM, des médicaments et plus largement des Communs.
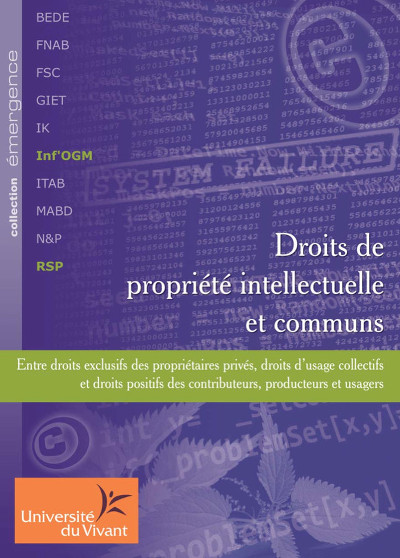
Le sommaire de cette riche brochure peut être téléchargé ici et elle peut être commandée ici sur la plateforme d’Inf’OGM.
On m’avait demandé d’écrire une contribution sur la question du statut juridique du domaine public pour cette brochure, que je poste ci-dessous. Il s’agit d’une synthèse de thèmes que j’ai pu développer à de nombreuses reprises sur S.I.Lex comme le problème du copyfraud ou la nécessité d’une reconnaissance positive par la loi du domaine public.
A la relecture, je me rends compte que je suis resté centré dans ce texte sur le domaine public des « oeuvres », c’est-à-dire celui des créations intellectuelles couvertes par le droit d’auteur. Il me semble qu’il serait très intéressant d’élargir la focale pour essayer de produire une synthèses sur « LES » domaines publics, existant au-delà du droit d’auteur dans le secteurs des brevets, des marques, des semences et de tous les objets suceptibles d’être couverts par des droits de propriété intellectuelle. Il en résulterait certainement des réflexions stimulantes.
Pour compléter le texte ci-dessous, on pourra également se reporter à l’ouvrage « Pages publiques : à la recherche des trésors du domaine public« , paru cette année chez C&F Editions, et qui est entièrement consacré à la question du domaine public, à partir d’un recueil de textes.
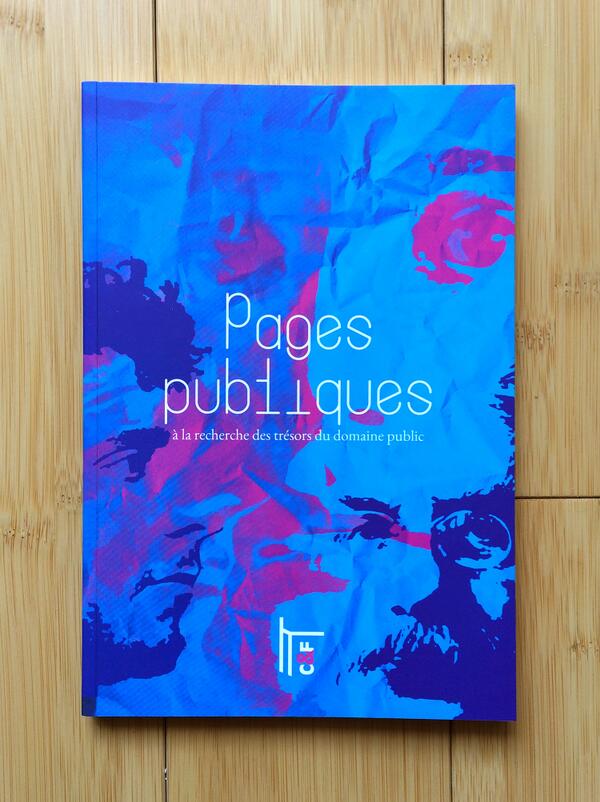
***
Reconnaître, protéger et promouvoir le domaine public pour enrichir les biens communs de la connaissance
Il est habituel de lire que le système de la « propriété intellectuelle » a été conçu de manière équilibrée, entre d’un côté une protection accordée aux titulaires de droits sur les oeuvres afin de les inciter à créer et de l’autre, une possibilité pour le public de les réutiliser. Mais outre le fait que la notion même de « propriété intellectuelle » pose problème, il est clair que le système général a largement dérivé de ses principes d’origine, notamment en raison de l’allongement continuel de la durée de protection du droit d’auteur et de la consécration de nouveaux droits (droits voisins, droit des bases de données)[1].
A l’origine, la notion de « domaine public » jouait un rôle essentiel, car les œuvres étaient protégées seulement pour une période relativement courte (10 ans après la mort de l’auteur dans la première loi française, en 1791), à l’issue de laquelle elles rejoignaient le domaine public. Elles pouvaient alors à nouveau être reproduites et représentées par tous, y compris à des fins commerciales. Aujourd’hui, avec une durée de principe de protection durant 70 ans en principe après la mort de l’auteur, les œuvres peuvent rester soumises au monopole du droit d’auteur pour des durées supérieures à un siècle. Il en résulte que ce qui n’était dans les faits qu’une exception temporaire (la protection par le droit d’auteur) est devenu le principe.
Ce renversement de perspective intervient alors que les avancées technologiques, et notamment la numérisation des connaissances et leur diffusion sur Internet, permettraient enfin à la notion de domaine public de jouer pleinement son rôle. En effet avant la numérisation, l’accès à la plupart des œuvres était limité par la matérialité de leurs supports. Les œuvres du domaine public ne constituaient donc des biens communs qu’en théorie, car dans la pratique, seuls ceux ayant accès aux originaux dans les bibliothèques, archives ou musées pouvaient en disposer effectivement. Avec le passage au format numérique, ces restrictions sont progressivement levées et des communautés en ligne (Wikimedia Commons, Internet Archive, le projet Gutenberg, etc) ont pu se former pour gérer en commun d’importants ensembles d’œuvres numérisées.
Pourtant le numérique ne représente pas seulement une chance pour le domaine public. Il peut aussi s’avérer une menace, notamment lorsque les opérateurs privés comme publics prennent prétexte de l’acte de numérisation pour s’arroger de nouveaux droits sur les versions numériques des œuvres. Ces pratiques, que l’on désigne par le terme de Copyfraud[2] inventé par le juriste américain Jason Mazzone[3], sont de plus en plus répandues et elles menacent d’une autre façon l’existence même du domaine public, déjà plus que fragilisé par l’allongement des droits.
Pour faire en sorte que le domaine public puisse continuer de jouer un rôle majeur à l’heure du numérique, plusieurs initiatives se sont organisées afin de favoriser sa reconnaissance. La création de la Public Domain Mark[4], par exemple, publiée par Creative Commons International, permet un meilleur « étiquetage » des œuvres en ligne afin de certifier leur appartenance au domaine public et de garantir les droits à la réutilisation. Mais au-delà de la simple proposition d’outils sans caractère contraignant, d’autres propositions insistent sur l’importance de modifier les textes juridiques afin d’y introduire une définition positive du domaine public, que ce soit au niveau national, européen ou international.
I Une définition seulement présente « en creux » dans les textes
Les principaux textes relatifs au droit d’auteur (Convention de Berne, directive 2001/29, Code de propriété intellectuelle en France) ne contiennent quasiment aucune référence explicite au domaine public. L’origine de la notion est essentiellement doctrinale : l’existence du domaine public a été déduite du fait que les droits patrimoniaux étaient limités dans le temps. Mais ce mode d’appréhension du domaine public ne lui donne aucun contenu positif et il est directement à l’origine de sa fragilité. En France par exemple, le Code de Propriété Intellectuelle ne contient que deux occurrences du terme « domaine public », dans les articles L. 123-8 et 123-9 relatifs aux prorogations de guerre.
Cette définition négative du domaine public a pour effet de déprécier la notion et de la rendre « invisible » dans le discours de la doctrine juridique dominante. Pratiquement, elle a aussi pour conséquence de rendre plus difficile une action en justice qui pourrait être introduite pour exiger la possibilité d’utiliser une œuvre du domaine public, face à une tentative de réappropriation abusive. Dans leur action, il arrive que les pouvoirs publics « omettent » de mentionner le domaine public, quand bien même il est directement en cause. A titre d’exemple, « la Charte des bonnes pratiques photographiques dans les musées et autres monuments nationaux » publiée par le Ministère de la Culture en juin 2013 ne contient aucune référence à la notion de domaine public, alors même que la question de la photographie des œuvres dans les musées devrait prendre en compte le fait qu’elles appartiennent ou nom au domaine public[5].
Pour essayer de faire réapparaître de manière positive la notion de domaine public, plusieurs stratégies ont été envisagées. Des actions en justice importantes ont par exemple déjà été introduites pour obtenir la consécration et la protection du domaine public par les juges. Ce fut le cas par exemple en 2003 aux Etats-Unis lors de l’affaire Eldred vs Ashcroft pour s’opposer à l’allongement de la durée des droits opérée par le « Mickey Mouse Act »[6]. A nouveau en 2012 , une action a été intentée à propos du traité URAA qui a eu pour effet de faire sortir des œuvres du domaine public aux Etats-Unis[7]. Mais dans les deux cas, le résultat de ces actions devant la Cour Suprême [8]s’est avéré décevant, voire négatif, avec pour conséquence de fragiliser le domaine public au lieu de le renverser. D’autres actions plus ponctuelles sont actuellement en cours, comme par exemple à propos des droits sur la chanson Happy Birthday ou le personnage de Sherlock Holmes, mais là encore, leur résultat risque d’être incertain.
Au lieu de chercher une solution en justice, une autre approche a été tentée dans le cadre du réseau Communia, réuni à l’initiative de la Commission européenne. Communia a en effet publié en 2011 un Manifeste pour le domaine public[9] qui constitue un texte fondamental pour l’affirmation positive du domaine public. Pour la première fois, un texte formulait une série de principes forts pour la reconnaissance et la protection du domaine public, mais il ne dispose pas à lui seul d’une force contraignante.
II Le « Copyfraud » et la fragilisation croissante du domaine public
En raison de cette absence de définition explicite dans les textes, le domaine public est vulnérable aux tentatives de réappropriation, qui jouent comme de nouvelles enclosures posées sur ce qui devrait rester des biens communs, disponibles pour tous. Le juriste américain Jason Mazzone a forgé le concept de Copyfraud[10] (fraude de droit d’auteur) pour essayer d’identifier ces pratiques de réappropriation du domaine public. Il en repère quatre formes : 1) déclarer posséder des droits d’auteur sur du matériel du domaine public, 2) imposer des restrictions d’utilisation allant au-delà de ce que la loi permet, 3) déclarer posséder des droits d’auteur sur la base de possession de copies ou d’archives du matériel, 4) déclarer posséder des droits d’auteur en publiant un travail du domaine public sous un support différent.
Plusieurs de ces pratiques ne sont pas à proprement parler légales et elles pourraient sans doute faire l’objet d’une condamnation en justice. Mais la situation est souvent floue et complexe, à cause de l’imprécision des règles du droit d’auteur. Par exemple en France, un nombre important de musées reconnaissent des droits d’auteur aux photographes qui réalisent des clichés de tableaux appartenant au domaine public. Or la reproduction ainsi produite d’une œuvre en deux dimensions peut difficilement être vue comme originale au sens du droit d’auteur (porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur). Pourtant, les photographes ont pris l’habitude de faire figurer leur copyright sur les reproductions des tableaux et les institutions se font céder ces droits pour contrôler l’usage des œuvres. Aux Etats-Unis, la jurisprudence a posé le principe que les reproductions d’œuvres du domaine public en deux dimensions étaient elles-mêmes dans le domaine public[11]. Mais en France, rien n’est aussi clair et ces pratiques que l’on peut assimiler à du copyfraud perdurent.
La revendication de droits d’auteur n’est pas le seul problème qui fragilise le domaine public. D’autres terrains juridiques peuvent être invoqués pour essayer de reprendre contrôle sur des œuvres du domaine public. C’est le cas en premier lieu du droit des bases de données par exemple. Le producteur d’une base de données peut en effet arguer des investissements réalisés pour produire une base afin d’imposer certaines restrictions à la réutilisation des éléments qu’elle contient. Lorsqu’une bibliothèque numérique contient des œuvres du domaine public numérisées, elle peut par exemple être assimilée à une base de données. Le statut juridique des informations publiques interfère aussi avec la notion de domaine public et peut conduire à faire ressurgir une nouvelle couche de droits. Issu d’une directive européenne[12], le droit des informations publiques permet normalement aux citoyens de demander la réutilisation des informations produites par les administrations. Mais celles-ci peuvent en réalité conditionner cette réutilisation et la soumettre au paiement de redevances. Or un certain nombre d’institutions culturelles estiment que la numérisation d’une œuvre du domaine public produit des « informations publiques » qui relèvent de ce régime, prenant le pas sur les règles de la propriété intellectuelle. La même chose se produit lorsque les institutions culturelles essaient d’appliquer les règles de la domanialité publique aux œuvres du domaine public dont elles ont la garde. La domanialité publique institue un régime de propriété publique, qui contribue en temps normal à protéger le patrimoine. Mais quand on essaie d’appliquer ces règles à un prétendu « patrimoine immatériel », on donne aux musées, archives et bibliothèques la possibilité de poser des restrictions à la réutilisation des œuvres du domaine public.
Au-delà donc du simple copyfraud, il se pose aujourd’hui un problème d’enchevêtrement des règles juridiques, sans que le domaine public se voie reconnaître une proéminence.
III L’introduction d’une définition juridique positive du domaine public
La fragilité dont souffre le domaine public n’est pas une fatalité. Elle pourrait être conjurée par l’introduction d’une définition positive de la notion dans les textes. Evidemment, le meilleur service que l’on pourrait rendre au domaine public serait de diminuer la durée de la protection des droits ou d’instaurer des systèmes d’enregistrement préalable des œuvres. Mais de telles réformes ne sont pas à l’ordre du jour, l’Union européenne ayant choisi par exemple en 2011 d’allonger de 50 à 70 ans la durée de protection des droits voisins des interprètes et des producteurs[13].
Néanmoins, l’idée d’une définition positive du domaine public fait peu à peu son chemin. L’OMPI par exemple dans le cadre du Plan d’action pour le développement[14] a engagé une action spécifique sur le domaine public. La recommandation n° 16 de ce plan préconise de “prendre en considération la préservation du domaine public dans l’élaboration des normes à l’OMPI et [d’] approfondir l’analyse des conséquences et des avantages d’un domaine public riche et accessible”. La recommandation n° 20 vise à “promouvoir les activités d’établissement de normes relatives à la propriété intellectuelle favorisant la consolidation du domaine public dans les États membres de l’OMPI, y compris l’élaboration éventuelle de principes directeurs susceptibles d’aider les États membres intéressés à recenser les objets tombés dans le domaine public sur leurs territoires respectifs ”. Une « étude exploratoire sur le droit d’auteur et les droits connexes et le domaine public » a été produite en ce sens par le professeur Séverine Dussolier et un Positive Agenda for The Public Domain a été élaboré par le réseau Communia[15]. L’OMPI travaille également sur la notion de domaine public volontaire, qui permettrait à un titulaire de renoncer volontairement à ses droits pour faire entrer par anticipation son œuvre dans le domaine public.
Même si la France de son côté est liée par la Convention de Berne et les directives européennes sur le droit d’auteur, une marge de manœuvre substantielle existe pour agir au niveau national sur la question du domaine public[16]. Sans pouvoir revenir sur la durée de principe pour le droit d’auteur ou les droits voisins, il serait possible de simplifier le système en faisant disparaître divers régimes dérogatoires (prorogations de guerre, Morts pour la France, œuvres posthumes), qui compliquent beaucoup le calcul des droits. Par ailleurs, les pratiques de copyfraud pourraient être endiguées en clarifiant une bonne fois pour toute l’articulation entre le domaine public et d’autres droits connexes, comme le droit des bases de données, la domanialité publique ou le droit des informations publiques. Le domaine public volontaire pourrait également être autorisé, en assouplissant les règles relatives à l’inaliénabilité du droit moral, ce que permet la Convention de Berne.
Le rapport Lescure[17], remis en 2013 au Ministère de la Culture, a repris un certain nombre de ces idées, dans sa proposition 74 : «Renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique : établir dans le code de la propriété intellectuelle une définition positive du domaine public ; indiquer que les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes. »
Il est donc possible d’agir en faveur du domaine public, afin de faire en sorte que ce socle indispensable au partage des connaissances continue à jouer un rôle au 21ème siècle.
[1] Guillaume Champeau. L’affaiblissement progressif du domaine public, en un schéma. Numerama, 02/01/2012 : http://www.numerama.com/magazine/21129-l-affaiblissement-progressif-du-domaine-public-en-un-schema.html
[2] Pier-Carl Langlais. L’iverse du piratage, c’est le copyfraud, et on n’en parle pas. Rue89, 14/10/2012 : http://blogs.rue89.com/les-coulisses-de-wikipedia/2012/10/14/linverse-du-piratage-cest-le-copyfraud-et-personne-nen-parle
[3] Jason Mazzone, « Copyfraud », New York University Law Review, vol. 81, no 3, 2006, p. 1026
[4] Public Domain Mark 1.0 http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
[5] Calimaq. Photographie dans les musées : la Charte du Ministère passe sous silence le domaine public. S.I.Lex, 08/09/2013 http://scinfolex.com/2013/09/08/photographie-dans-les-musees-la-charte-du-ministere-passe-sous-silence-le-domaine-public/. A compléter avec ce billet pour les évolutions plus récentes : http://www.savoirscom1.info/2014/07/3402/
[6] Eldred vs Ashcroft, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Eldred_v._Ashcroft
[7] Golan v. Holder, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Golan_v._Holder
[9] Communia, Manifeste pour le domaine public http://www.publicdomainmanifesto.org/french
[10] Jason Mazzone. Copyfraud and other abuses of intellectual property laws. Standford University Press.
[11] Bridgeman Art Library v. Corel Corp. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Bridgeman_Art_Library_v._Corel_Corp.
[12] Europa’s Information Society. Public Sector Informations : http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm
[13] Commission européenne. Droits d’auteur et droit voisin. La durée de protection http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/index_fr.htm
[14] OMPI. Les 45 mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action de l’OMPI pour le développement : http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
[15] Communia. Communia Positive Agenda for The Public Domain : http://www.communia-association.org/2012/12/05/communia-positive-agenda-for-the-public-domain/
[16] Calimaq. I Have A Dream : une loi pour le domaine public en France. S.I.Lex, 27/10/2012 : http://scinfolex.com/2012/10/27/i-have-a-dream-une-loi-pour-le-domaine-public-en-france/
[17] Mission « Acte II de l’exception culturelle ». Ministère de la Culture et de la Communication http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/index.htm#/
Classé dans:
Domaine public, patrimoine commun Tagged:
Domaine public,
droit d'auteur,
Propriété intellectuelle 







 L’approche retenue par cette journée était intéressante, car elle consistait à se pencher sur les changements juridiques qu’occasionne le passage au numérique sur la notion de « biens ». Les biens constituent une catégorie juridique fondamentale, autour de laquelle s’articule le droit des biens, que l’on oppose traditionnellement au droit des contrats.
L’approche retenue par cette journée était intéressante, car elle consistait à se pencher sur les changements juridiques qu’occasionne le passage au numérique sur la notion de « biens ». Les biens constituent une catégorie juridique fondamentale, autour de laquelle s’articule le droit des biens, que l’on oppose traditionnellement au droit des contrats.
![]()