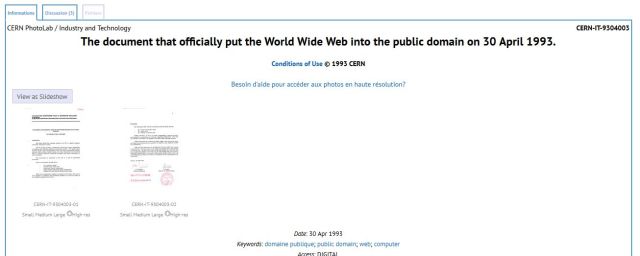Peut-on vraiment mettre en partage des brevets (et comment) ?
mercredi 7 janvier 2015 à 15:07On apprend cette semaine qu’afin de populariser les voitures à hydrogène, la firme Toyota a décidé de « partager gratuitement les technologies qu’elle a brevetées dans le secteur de la pile à combustible« . L’article des Echos qui relate cette nouvelle précise que » le groupe va autoriser tous les constructeurs, ou industriels intéressés par le développement d’une société de l’hydrogène, à utiliser sans licence l’ensemble de ses 5.680 brevets concernant les piles à combustible« .

Cette décision fait écho à celle du constructeur Tesla Motors qui avait fait sensation en juin dernier en annonçant publiquement qu’il renonçait à exercer ses brevets pour favoriser le développement des voitures électriques. Nul doute d’ailleurs que la décision de Toyota est liée à celle de Tesla et qu’elle traduit le fait qu’une course est lancée pour établir le prochain standard dans le domaine des voitures électriques. Mais là où l’on peut se réjouir, c’est que cette compétition s’enclenche sur la base d’une ouverture des droits de propriété intellectuelle et non par le biais d’une « guerre des brevets« , comme on l’a vu faire rage ces dernières années dans le domaine des smartphones et des tablettes. Et l’on commence à voir se dessiner à travers ces nouvelles stratégies de firmes commerciales, la possibilité de bâtir une « économie ouverte« , fonctionnant sur d’autres bases que le capitalisme cognitif dominant.
Pas de moyens pour partager clairement des brevets ?
Néanmoins, lorsque l’on regarde de plus près, la question s’avère en réalité beaucoup plus complexe. Il n’existe pas réellement en matière de brevets d’équivalent des licences libres pour le droit d’auteur, qui permettrait à un titulaire de droits de mettre en partage une de ses inventions. Lorsque Tesla cet été a pris ce virage, certains commentateurs avaient d’ailleurs fait remarquer que l’assimilation de sa démarche à de « l’Open Source » était sans doute abusive. Le billet publié par Elon Musk, le PDG de Tesla, pour annoncer cette décision s’intitulait « Tous nos brevets vous appartiennent », mais lorsqu’on lit bien le texte, on s’aperçoit que la firme ne renonce pas à ses titres de propriété intellectuelle. Musk dit :
Tesla will not initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wants to use our technology.
Cela signifie que Tesla n’engagera pas de procès envers ceux qui réutilisent ses technologies, mais qu’elle continue à se réserver cette possibilité contre ceux qui n’agiraient pas « de bonne foi« . On pense ici bien sûr aux fameux « Patent Trolls« , ces firmes accumulant des brevets, même les plus fantaisistes, pour menacer ensuite d’autres entreprises de procès et leur extorquer des ententes à l’amiable contre rémunération. Tesla semble donc ici se ménager une sécurité pour agir contre de telles entités, particulièrement nuisibles aux Etats-Unis.

Mais le problème, c’est que la décision de Tesla d’ouvrir ses brevets ne repose que sur une déclaration unilatérale et n’est pas formalisée sous la forme d’une licence, comme cela peut être le cas pour la GNU-GPL ou les Creatives Commons avec des logiciels ou des oeuvres de l’esprit soumises au droit d’auteur. La question se pose alors de savoir s’il est vraiment possible de mettre en partage des brevets et quelle forme pourrait prendre juridiquement une telle décision d’ouverture.
A vrai dire, l’élargissement de la logique des licences libres au-delà du droit d’auteur dans le champ de la propriété industrielle est toujours complexe à penser. J’avais essayé par exemple de montrer que des Creative Commons du droit des marques n’étaient pas complètement impossible à envisager pour créer des « Open Trademarks« . Mais il existe un certain nombre d’obstacles qui rendent l’entreprise plus compliqué que pour le droit d’auteur, beaucoup plus facile à « retourner ».
Le domaine public, sinon rien ?
Pour les brevets, les exemples que l’on cite le plus souvent renvoient en réalité à des personnes qui ont renoncé à déposer un brevet sur leur invention. C’est le cas par exemple de Tim Berners-Lee pour les technologies du web ou plus récemment du médecin Didier Pittet à propos de la lotion hydro-alcoolique pour se laver les mains, qui sauve des millions de vie chaque année. Dans ce cas, l’inventeur publie sa découverte avant de déposer un brevet, ce qui l’empêche de le faire ensuite et bloque aussi normalement la possibilité pour des tiers de le faire. Il y a alors véritablement renonciation à exercer un titre de propriété sur la création intellectuelle qui reste dans le domaine public. Mais est-ce à dire que le seul moyen valable pour mettre en partage des brevets consiste à ne jamais en déposer et à se tenir écarté de la propriété intellectuelle ? Les exemples de Tesla et à présent de Toyota montrent que l’on n’est pourtant pas dans ce paradigme du domaine public, tout en étant du côté de la mise en partage.
En même temps, on sent bien le besoin d’un instrument formalisé pour véritablement « ouvrir » des brevets dans un esprit qui soit compatible avec celui du logiciel libre et de l’Open Source, notamment pour éviter de « fausses ouvertures » et garantir des libertés au profit des réutilisateurs. En octobre dernier par exemple, le CNRS en France a annoncé qu’il allait à présent « faciliter l’accès à ses brevets« . Mais on constate en lisant dans le détail ses intentions qu’il n’est réellement pas dans une démarche d’ouverture semblable à celle de Tesla ou de Toyota :
C’est ce verrou qu’entend faire sauter l’organisme public, septième déposant à l’échelle nationale, aujourd’hui à la tête d’un trésor de guerre constitué de 4.535 familles de brevets (pour 1.438 licences actives). Plutôt que d’exiger systématiquement la propriété ou la copropriété de l’invention et le paiement d’une somme en cash avant de concéder une licence, le CNRS veut dorénavant faciliter au maximum la vie de ses chercheurs-entrepreneurs. Que ce soit en mobilisant son réseau de grandes entreprises partenaires (Safran, Saint-Gobain, Solvay, Suez Environnement, Thales…), ou en prenant lui-même une participation dans la start-up en devenir.
Comment dès lors formaliser une ouverture dans le secteur des brevets ?
La Defensive Patent Licence, une proposition pour organiser le partage des brevets
Pourrait-on envisager des licences fonctionnant à l’image des licences libres pour les logiciels sur la base d’un principe non pas d’exclusion, comme c’est le cas avec les brevets actuels, mais d’inclusion des utilisateurs ? C’est précisément ce qu’est en train d’essayer de faire depuis la fin de l’année dernière un projet américain avec la Defensive Patent Licence (DPL), initié par des chercheurs en droit de l’Université de Berkeley aux Etats-Unis et soutenu par l’association de défense des libertés numériques EFF.
Les principes de fonctionnement de cette licence sont intéressants, car ils diffèrent des licences ancrées dans le droit d’auteur comme la GNU-GPL, tout en partageant leur esprit. Je traduis ci-dessous le texte de présentation de la licence pour en donner une idée :
La plupart des brevets et des licences de brevets sont conçus pour empêcher l’accès du public à la connaissance et la liberté de partager et d’améliorer des inventions brevetées. A l’inverse, la DPL a pour objectif de protéger la liberté de partager et d’améliorer des inventions brevetées, au sein d’une communauté de personnes partageant les mêmes intentions. Elle est aussi conçue pour aider à établir de robustes preuves d’antériorité afin d’empêcher des tentatives ultérieures de breveter les mêmes inventions d’une manière qui restreignent l’accès et la liberté.
Pour rejoindre cette communauté, toutes les personnes ou sociétés désirant le faire doivent garantir à tous le bénéfice de la même liberté au sein de la communauté DPL, à propos de tous leurs brevets (et de tous les brevets futurs qu’ils pourraient obtenir). Cependant, vous n’avez pas besoin de détenir des brevets pour faire partie de la communauté DPL. Vous devez simplement prendre le même engagement et ensuite vous y tenir au cas où vous obteniez un brevet à l’avenir.
Le résultat de cette communauté de partage de brevets est un réseau de brevets qui garantit à chaque membre une licence à coût zéro pour tous les brevets du réseau, tout en laissant ces brevets toujours utilisables contre quiconque ayant choisi de ne pas rejoindre la communauté DPL de partage de brevets.
A la différence des licences ancrées dans le droit d’auteur comme la GNU-GPL, la DPL requiert que la personne ou l’organisation ouvre TOUS ses brevets pour recevoir la possibilité d’utiliser gratuitement les brevets des autres utilisateurs de la DPL. Ceci résulte des différences entre les brevets et le droit d’auteur et de la façon dont les brevets peuvent menacer l’accès à la connaissance et la liberté autrement que le droit d’auteur. En exigeant cela, la DPL exprime un engagement explicite de non-agression au sein d’une communauté de personnes déposant des brevets pour se défendre elles-mêmes, mais ne veulent pas utiliser ses brevets agressivement contre le public.
Au départ, cette communauté de partage des brevets sera sans doute petite, et la rejoindre n’aura que peu d’impact sur les revenus qu’un titulaire de brevets peut obtenir de licences commerciales. Mais à mesure que la communauté grossira, il deviendra de plus en plus attractif de la rejoindre, même pour de grandes sociétés détenant beaucoup de brevets. Le bénéfice pour chaque membre de la communauté grandira au fur et à mesure que davantage de titulaires de brevets la rejoindront pour partager gratuitement leurs brevets avec d’autres membres.
Ce dispositif, qui prolonge ce qui existe déjà au sein de ce l’on appelle les « Pools de brevets« , est intéressant à plus d’un titre. Par rapport à une licence « libre » de logiciel, on voit qu’il maintient un droit d’exclure à géométrie variable. En effet, les brevets ne deviennent réutilisables librement que parmi les membres de l’alliance défensive formée par les utilisateurs de la DPL. Mais les individus ou entreprises ne rejoignant pas cette communauté demeurent exclus. J’y vois la marque d’une exigence de réciprocité qui rapproche la DPL des licences réciproques, comme la Peer Production Licence (PPL), n’ouvrant à une entité le bénéfice de l’usage gratuit d’une ressource partagée que dans la mesure où elle contribue en retour aux Communs. En ce sens, la DPL prolongerait dans le champ de la propriété industrielle ce que la PPL essaie d’enclencher dans celui du droit d’auteur.
Par ailleurs, je trouve aussi intéressante l’idée de ne pas ouvrir complètement l’usage des brevets pour chercher à créer progressivement une masse critique capable d’avoir une incidence sur l’écosystème global, en incitant de plus en plus de porteur de brevets à rejoindre l’alliance. On retrouve aussi l’idée qu’il est important de pouvoir protéger la ressource partagée du retour des enclosures (ici les Patent Trolls), ce qui est la marque des biens communs.
Évidemment, on pourrait objecter que le plus simple est de ne pas déposer du tout de brevet pour laisser les inventions dans le domaine public. Mais que faire du stock énorme des brevets déjà existants, qui vont continuer à être applicables pendant des années ? Et comment faire en sorte que ce soit progressivement une part significative de l’écosystème qui bascule dans l’ouverture, et pas seulement quelques personnalités isolées ? Bref : comment organiser concrètement une transition vers une économie basée sur la connaissance ouverte ?
On imagine que si Tesla ou Toyota choisissaient de rejoindre la communauté de la Defensive Patent Licence, celle-ci commencerait à prendre un essor important et les libertés des utilisateurs seraient mieux garanties. Et pourquoi une entité publique comme le CNRS n’utiliserait-elle pas non plus un tel instrument, de même que les Universités ?
Des licences pour ouvrir les brevets, mauvaise idée ?
Certains parmi la communauté du Libre estiment cependant que cette idée de la mise en partage des brevets est nocive et que l’on ne peut pas reproduire dans le champ des brevets le retournement accompli pour le droit d’auteur. C’est le cas par exemple de Gérald Sédrati-Dinet, engagé dans le combat contre les brevets logiciels, qui avait laissé ce commentaire sous le billet que j’avais consacré à Tesla :
(…) je serais plus réservé sur le fait que Tesla ait « ouvert » ses brevets. Pas simplement sur la concrétisation juridique de cette ouverture, que tu expliques très bien dans ta réponse au commentaire d’Homlett. Mais avant tout parce que « le seul bon brevet est un brevet mort » (Stallman). L’ « ouverture » de quelques brevets particuliers ne change rien au problème des brevets logiciels, car il en reste des millions, qui entravent tout développement logiciel. Et le fait que Tesla ait déposé en premier lieu ces brevets participe du gonflement de cette bulle, peu importe qu’ils soient maintenant « ouverts ».
Il est impossible de parler de « bien commun » à propos des brevets logiciels. L’accumulation de brevets est plutôt un « mal commun ». Chaque brevet logiciel déposé renforce les effets de maquis. L’initiative « Defensive Patent Licence » est en ce sens contre-productive.
C’est très différent du droit d’auteur, où on peut en effet parler d’enrichissement des biens communs, lorsque des œuvres sont librement partagées. Les brevets n’ont rien à voir avec cela, ce qui constitue le bien commun se trouve ici dans les connaissances scientifiques revendiquées et appropriées par le biais des brevets.
Ce qui est dit ici est incontestable pour les brevets logiciels, mais est-ce le cas pour tout le champ de la propriété industrielle ? La Defensive Patent Licence n’aurait-elle aucun intérêt si des initiatives comme celle de Tesla ou de Toyota venaient à prendre de l’ampleur, pour accompagner le passage vers une économie ouverte ? Je n’en suis pas si sûr.
***
En définitive, ce débat renvoie à un débat plus général qui agite la pensée autour des Communs. La lutte pour le développement des Communs doit-elle se faire contre la propriété, en rejetant complètement sa logique (ce qui dans le champ des brevets revient à laisser les inventions dans le domaine public) ou doit-elle se faire au sein même de la propriété, en réaménageant ses principes de fonctionnement ?
On lira à ce sujet avec intérêt le dernier numéro de la revue en ligne « Les possibles », avec un dossier consacré aux Biens communs qui illustre bien ces tensions, et notamment cet article de Benjamin Coriat où il dit des choses à propos de la licence GNU-GPL, en lien avec l’idée d’un « domaine public protégé », qui me paraissent mutatis mutandis transposables à la Defensive Patent Licence :
Par cet extraordinaire tour de force, Stallman avec la licence GPL (General Public License) a, en y associant le copyleft, non seulement créé un domaine public inviolable, mais aussi un domaine public qui en permanence s’auto-enrichit. Le tout, non en niant le droit de propriété, mais en l’investissant pour le subvertir. Stallman est à l’origine de cette fantastique innovation sociale : par le moyen de contrats privés (des licences d’autorisation, les fameuses licences GPL), garantis par une institution créée pour cela (la Free Software Fondation), il crée du domaine public protégé, du domaine public où aucun free rider ne peut désormais opérer pour spolier les créateurs, ce que l’absence de droits (avant la mise des logiciels sous licence GPL) autorisait.
Mise à jour du 20/02/2015 : Elon Musk a fait de nouvelles déclarations pour préciser que les brevets de Tesla Motors étaient « réellement ouverts », c’est-à-dire réutilisables par quiconque sans avoir à conclure une licence.
Classé dans:A propos des biens communs, Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: économie ouverte, brevets, Defensive Patent Licence, enclosures, licences libres, propriété industrielle, tesla, toyota