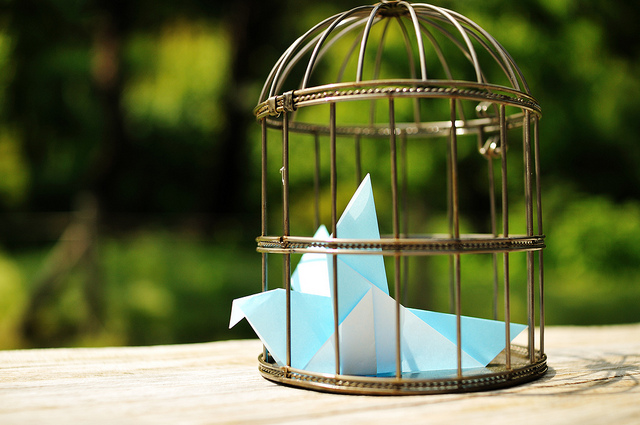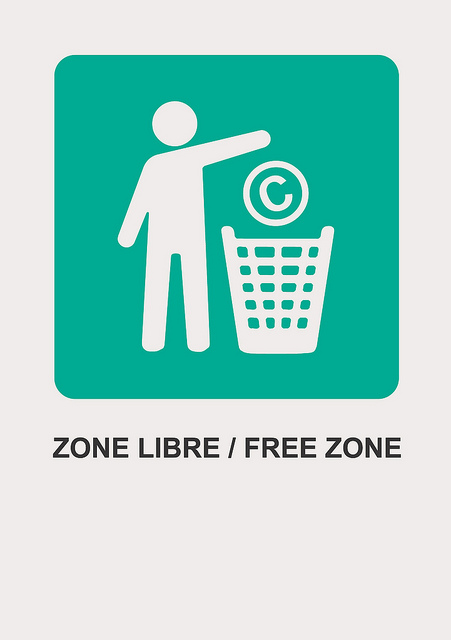Rémunérer les amateurs pour valoriser les externalités positives
mercredi 6 février 2013 à 23:39Il y a quelques jours, Rue89 a publié un entretien avec Bernard Stiegler, directeur de l’IRI (Institut de Recherche et d’Innovation), intitulé « Nous entrons dans l’ère du travail contributif« . Ce texte est particulièrement intéressant dans la manière dont il jette des ponts entre les transformations du monde du travail, sous l’effet du développement des pratiques collaboratives ; le modèle de l’Open Source et des logiciels libres appliqués à d’autres secteurs de l’économie ; la place croissante des travailleurs indépendants et le rôle concomitant des espaces de co-working et d’innovation (FabLabs, HackerSpaces, etc) ou encore la mutation des simples consommateurs en contributeurs actifs.
L’interview contient un passage particulièrement intéressant concernant la place des amateurs dans cette nouvelle économie du travail contributif et l’idée qu’il conviendrait de les rémunérer :
C’est le règne des amateurs ?
Oui. Le contributeur de demain n’est pas un bricoleur du dimanche. C’est un amateur, au vieux sens du terme. C’est quelqu’un qui est d’abord motivé par ses centres d’intérêt plutôt que par des raisons économiques.
Il peut d’ailleurs développer une expertise plus grande que ceux qui sont motivés par des raisons économiques.
C’est un changement radical, comment le mettre en œuvre ?
C’est un nouveau modèle du travail. Je parle de « déprolétarisation ». On n’apporte pas seulement sa force de travail, mais du savoir. C’est une plus-value énorme.
[...]
Mais ces contributeurs, faut-il les rémunérer ? Si oui, comment ?
Oui, il faut les rémunérer. Je ne dirais pas exactement qu’il faut rémunérer les amateurs sur le modèle des intermittents, mais qu’il y a des solutions dont celle-ci.
Concernant le montant de la rémunération, il pourrait y avoir une formule avec une part salariale et une part sous la forme d’un intéressement contributif. On peut imaginer des trucs comme ça. Tout cela relève d’une valorisation de ce que l’on appelle les externalités positives.
Et Bernard Stiegler plus loin de conclure :
Nous vivons actuellement dans une phase de transition, où tout l’enjeu est, en France, pour le gouvernement actuel, d’arriver à dessiner un chemin critique pour notre société : un chemin où l’on invente une véritable croissance fondée sur le développement des savoirs, et où l’on dépasse le modèle consumériste.
Cette proposition de rémunération des amateurs rejoint plusieurs de mes préoccupations centrales et notamment mon intérêt pour le modèle de la contribution créative, développé par Philippe Aigrain et intégré dans les « Éléments pour une réforme du droit d’auteur et des politiques culturelles liées » de la Quadrature du Net.
Ouvrir et transformer les entreprises
Bernard Stiegler mélange à mon sens deux choses différentes dans ses propos. Des travailleurs contributeurs participants à l’activité d’une entreprise et des individus contributeurs créant en ligne des contenus assimilables à des oeuvres de l’esprit au sens de la propriété intellectuelle. La séparation entre les deux peut être assez poreuse, dans nos sociétés où nous devenons de plus en plus des travailleurs « intellectuels » (c’est chose flagrante dans le secteur du logiciel). Mais des circuits différenciés de rémunération peuvent être envisagés.
Bernard Stiegler écarte, à juste titre, le modèle des intermittents du spectacle pour rémunérer les amateurs-contributeurs. Ce mode de financement, assimilable à une forme de « fonctionnarisation » des créateurs traverse une crise profonde et il paraît difficile en ces temps de crise budgétaire de l’Etat d’étendre le système aux amateurs.
Pour ce qui est du travail collaboratif en entreprise, j’avais pris l’exemple dans un précédent billet de l’entreprise canadienne Sensorica, qui fonctionne déjà de manière décentralisée et ouverte sur la base de contributions :
SENSORICA n’a pas d’employés, mais des contributeurs, qui peuvent apporter selon leurs possibilités de leur temps, de leurs compétences ou de leur argent. Pour rétribuer financièrement les participants, la start-up utilise un système particulier qu’elle a créé et mis en place, dit Open Value Network.
Ce système consiste en une plateforme qui permet de garder trace des différentes contributions réalisées par les participants aux projets de SENSORICA. Un dispositif de notation permet aux pairs d’évaluer les contributions de chacun de manière à leur attribuer une certaine valeur. Cette valeur ajoutée des contributions confère à chacun un score et lorsqu’une réalisation de SENSORICA atteint le marché et génère des revenus, ceux-ci sont répartis entre les membres en fonction de ces évaluations.
Cela va donc plus loin que ce que Bernard Stiegler envisage (rémunération via une part salariale et une part sous la forme d’un intéressement contributif), parce que la propriété même de l’entreprise est partagée, ce qui en fait un bien commun à part entière. A ce sujet, il faut lire les vues de Michel Bauwens sur la Peer-to-Peer Economy et l’émergence de nouvelles structures de production, basées sur la « coopération radicale » et la gestion en commun des ressources. On rejoint aussi le concept d’ »économie de la pollinisation » développé par Yann Moulier-Boutang.
Rémunérer les créateurs en ligne
Mais il est clair qu’une large part du « travail contributif » dont parle Bernard Stiegler ne s’exerce pas aujourd’hui dans le cadre d’entreprises, mais est effectué par les individus sur leur temps « libre », par le biais de la création et de la mise en ligne de contenus assimilables à des oeuvres de l’esprit, qu’il s’agisse de textes, de photos, de vidéos, etc. Cette création s’effectue de manière décentralisée, à partir des sites personnels des individus ou via des plateformes de partage de contenus, type YouTube ou Facebook, exercant un puissant effet de recentralisation.
Le poids de ces « User Generated Content » dans la valeur globale d’Internet est énorme, mais il est globalement rejeté dans l’ombre dans la mesure où ils sont essentiellement produit pas des amateurs, alors que les schémas mentaux traditionnels n’accordent de valeur aux contenus culturels que s’ils sont produits par des professionnels. Il est à ce sujet assez inquiétant de voir que la Commission européenne vient de lancer des travaux sur les User Generated Content, sur des bases complètement biaisées qui ne peuvent que maintenir cette césure artificielle entre les contenus amateurs et professionnels.
C’est le grand mérite des « Éléments pour la réforme du droit d’auteur et des politiques culturelles liées » de dépasser la distinction professionnels/amateurs et d’envisager rémunérer également rémunérer ces derniers pour les « récompenser » d’avoir posté des contenus en ligne.
Cette rémunération passerait par des systèmes de financement mutualisés qui pourraient prendre trois formes :
- La mutualisation coopérative volontaire : ce sont les systèmes de crowdfunding que nous connaissons déjà, de type KickStarter, Ulule, KissKissBankBank, qui commencent déjà à produire des effets importants pour la production des contenus en dehors des circuits traditionnels ;
- La mutualisation organisée par la loi : il s’agit là de la contribution créative, qui consiste à prélever un surcoût sur les abonnements internet des foyers connectés pour rémunérer les contenus en fonction de leur taux de partage en ligne. Elle s’accompagne d’une légalisation du partage non-marchand et présente pour principale différence par rapport à des propositions de type licence globale de s’appliquer aussi bien aux contenus culturels produits par des professionnels qu’à ceux créés par des amateurs. Toute personne postant volontairement des contenus en ligne pourrait prétendre en toucher une part.
- Le revenu de base (ou revenue de vie, revenu d’existence, etc) : consistant à accorder à tous les citoyens un revenu inconditionnel durant toute leur existence sans contrepartie. C’est sans doute la mesure qui prendrait le mieux en compte l’émergence de cette nouvelle économie de la contribution et la nécessité de valoriser ces externalités positives que nous sommes tous amenés à générer.
Faire évoluer la conception de la valeur
Lors de notre audition par la mission Lescure en septembre dernier pour le collectif SavoirsCom1, nous avions beaucoup insisté, Silvère Mercier et moi, sur la nécessité de prendre en compte les productions amateurs dans la problématique du financement de la création. Ce que nous avions dit, c’est que dans une économie de l’abondance, le fait de ne pas reconnaître de valeur aux contenus produits par les amateurs conduit à ce que cette valeur soit captée par des plateformes de type YouTube, Facebook ou autre, qui se les « approprient » par le biais de leurs conditions générales d’utilisation (CGU). C’est devenu une source majeure de monétisation et une affaire comme celle qui a frappé Instagram récemment a montré toutes les tensions que pouvaient générer ce bras de fer pour l’appropriation des contenus amateurs.
D’autres évènements survenus récemment n’ont fait que confirmer l’importance de faire sortir les contenus amateurs de l’angle mort dans lequel ils sont encore plongés. L’affaire de la Lex Google a été particulièrement emblématique de ce point de vue. L’enjeu pour la presse française dans ce dossier n’était pas seulement économique ; il était aussi d’ordre symbolique. Il s’agissait pour ces professionnels issus de l’univers du papier de conforter leur statut vis-à-vis de nouveaux entrants comme les pure player de l’information. De ce point de vue, l’accord signé entre la presse et Google les conforte majoritairement dans cette « légitimité ».
Mais il existait un enjeu plus large, qui aurait pu consister justement à faire apparaître la valeur des contenus produits par les blogueurs-amateurs et leur rôle dans la diffusion de l’information en ligne. J’avais de ce point de vue avancé, qu’aussi bien pour les professionnels que les amateurs, une solution de type contribution créative aurait été largement préférable à ce financement de la part de Google, qui renforce encore la main mise du moteur de recherche sur l’écosystème de l’information en ligne.
Bluetouff sur son blog va encore plus loin et estime que si Google paye la presse française, alors la presse devrait également payer les internautes, car eux aussi donnent de la valeur aux articles en les partageant !
Et si la presse rémunérait sa vraie source de valeur… comme Google le fait pour elle ?
Google n’est pas le seul à générer du trafic. Les internautes qui partagent des informations sur Facebook et sur Twitter … voilà l’origine première de la valeur des sites des presse aujourd’hui, car ce sont eux qui permettent à la presse d’accroitre le plus considérablement leurs revenus publicitaires. Est-ce pour autant que la presse va décider de reverser une partie de ses revenu publicitaires aux internautes qui partagent le plus leur information ? Ceci serait pourtant légitime…
On en arrive alors à l’idée d’un « travail invisible », accompli par les internaites et c’est une des notions-clé du récent rapport Colin & Collin sur la fiscalité du numérique. Ce rapport contient en effet en filigrane l’idée que les individus, par les données qu’ils produisent du fait de leurs activités sur Internet, accomplissent un « travail gratuit », source de valeur, qui devrait être pris en compte dans le régime fiscal des géants du web que sont des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou Apple. L’idée concomitante d’un taxe sur l’exploitation des données personnelles me paraissait aussi intéressante, malgré ses difficultés d’application concrète. Je lui reprocherai surtout de ne pas faire suffisamment la distinction entre les simples données produites par les individus (données personnelles) et les contenus assimilables à des oeuvres, qui ne sont pas à mon sens à ranger dans la même catégorie.
Mais le rapport Colin & Collin repose sur une philosophie qui ne me paraît pas si éloignée de celle qui est à l’oeuvre dans la contribution créative, à savoir la nécessité de reconnaître la valeur de la contribution des myriades d’amateurs dans le système de l’économie numérique et celle de peser pour éviter une trop grande centralisation des échanges sur des plateformes qui finissent par capter l’essentiel de la valeur produite.
Cette valeur, il est juste qu’elle revienne sous une forme ou une autre aux individus qui ont contribué à la faire émerger. Le détour par la fiscalité ferait qu’une partie de cette valeur serait redirigée vers l’Etat. Mais la mise en place de financements mutualisés aboutirait à un retour plus direct de la valeur vers les individus qui l’ont créée. Les deux formules ne sont cependant pas nécessairement à opposer, mais elles peuvent jouer un rôle complémentaire de rééquilibrage du système.
Contrairement à ce que l’on pense trop souvent, la contribution créative n’est pas seulement une réponse apportée au problème du piratage des oeuvres. Elle vise également à faire évoluer le système économique global lui faire prendre en compte les caractéristiques essentielles de la révolution numérique et en premier lieu, l’explosion du nombre de créateurs et « l’empowerment » culturel qui en résulte. « Développer une véritable croissance liée aux développements des savoirs » comme l’appelle Bernard Stiegler de ses voeux, nécessite de mettre en capacité les individus de s’investir dans les pratiques créatives et cela passe par une forme de rémunération des amateurs.
Les propositions de Bernard Stiegler sont stimulantes, mais ce qui leur manque peut-être, c’est de s’appuyer sur la théorie des biens communs, qui paraît mieux à même de lier tous ces éléments en un tout cohérent.
Classé dans:Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: amateurs, contribution créative, création, entreprise, fiscalité, Lex Google, Philippe aigrain, presse, revenu de base