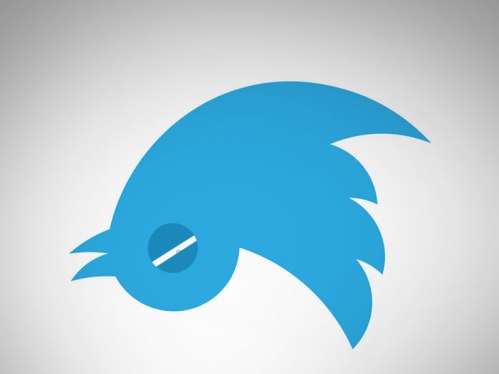Les CGU des plateformes, bientôt transformées en parodie de conventions collectives ?
lundi 3 septembre 2018 à 08:09En février dernier dans un article écrit avec Laura Aufrère intitulé « Pour une protection sociale des données personnelles« , nous avions envisagé que les CGU (Conditions Générales d’Utilisation) des plateformes – aujourd’hui unilatéralement édictées par ces entreprises sans possibilité de négociation – puissent être repensées sous la forme de conventions collectives afin de redonner du pouvoir aux utilisateurs. Nous nous placions à ce moment dans la perspective de la protection des données personnelles et de la vie privée, pour laquelle nous pensions intéressant d’aller puiser de l’inspiration du côté des institutions du droit du travail pour faire émerger un « droit social des données ».

Il se trouve que la Loi sur l’avenir professionnel, dite Pénicaud 2, adoptée par le Parlement en juin dernier et actuellement examinée par le Conseil Constitutionnel, semble s’être engagée dans ce rapprochement entre CGU et conventions collectives… mais en mode parodique !
L’objectif visé par ce texte n’est pas la protection des données personnelles, mais la situation des travailleurs indépendants dans leur relations avec les plateformes, type Uber ou Deliveroo. Selon la Ministre du Travail, la majorité serait parvenue à trouver un compromis satisfaisant, en « sécurisant le modèle des plateformes » tout en apportant de nouvelles garanties aux individus. Dans les faits, le texte prévoit seulement une possibilité (et non une obligation) pour les plateformes d’édicter une « Charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de [leur] responsabilité sociale ».
L’article 40A de la loi détaille le contenu de ces « Chartes sociales » et le voici ci-dessous in extenso :
1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) À améliorer les conditions de travail ;
« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;
« 8° (nouveau) Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
Paternalisme numérique
Le périmètre de cette Charte correspond bien à ce qui figure normalement dans une convention collective (« les conditions d’emploi, de formation professionnelle, de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales« ), mais avec des différences notables dans les mécanismes de mise en oeuvre ! Tout d’abord, ces chartes seront prises plateforme par plateforme et non au niveau d’un secteur donné, comme celui de l’économie dite « collaborative » (ce qui aurait d’ailleurs pu être une option intéressante). Il s’agit donc davantage de l’équivalent d’accord d’entreprises que de conventions collectives. Mais surtout, leur adoption reste purement facultative, ce qui rapproche ces chartes de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), définie comme suit par la Commission européenne :
l’intégration volontaire des préoccupations sociales des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes.
Or comme l’explique Alain Supiot, juriste spécialisé en droit du travail et professeur au Collège de France, « la RSE est au néo-libéralisme ce que le paternalisme fut au libéralisme« . Il fait allusion par-là au paternalisme industriel de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, lorsque les patrons des grandes entreprises procuraient de manière « charitable » une certaine forme de protection à leurs ouvriers en termes de logement, de soins ou d’éducation. Le caractère facultatif des chartes sociales de la loi Pénicaud 2 relève d’une logique similaire et peut se rattacher à ce que j’ai déjà pu appeler sur ce blog une évolution vers un « Providentialisme de plateformes » qui se dessine à mesure que se délite l’État social.
On pourrait néanmoins penser que ces chartes aient le potentiel de devenir un support pour des luttes sociales d’un nouveau genre, outillant les travailleurs indépendants des plateformes dans leur revendication à l’amélioration de leurs droits. Mais l’analogie avec les conventions collectives trouve ici aussi sa limite, car l’expérience a montré que même si la loi permet à ces travailleurs de se syndiquer, il leur est difficile de s’organiser collectivement pour induire un rapport de forces à leur avantage. On l’a bien vu cet été lors du week-end de la finale de la Coupe du Monde de football, lorsque les livreurs à vélo ont tenté d’organiser une grève face à Deliveroo, en demandant aux clients de se montrer solidaires en cessant les commandes. Le résultat fut mitigé, car face à la gouvernance algorithmique, c’est la possibilité même d’engager le conflit qui se dérobe.
En réalité, l’idée qui sous-tend ces chartes sociales facultatives est que ce n’est plus au conflit social de servir de moteur à la définition des droits, mais à la concurrence sur le marché d’assurer cette fonction. La loi fait le pari que les plateformes amélioreront d’elles-mêmes les conditions de travail et les garanties associées, de manière à attirer et fidéliser les travailleurs. Outre que cela revient à transformer les droits sociaux en simples « avantages concurrentiels », il est improbable vu l’état du marché du travail en France que le jeu de la concurrence pousse les plateformes à s’engager dans une telle course au « mieux disant social ». Avec la progression de la précarité, ce sont en réalité les travailleurs qui se retrouvent mis en concurrence les uns avec les autres, sans compter que l’effet-réseau tend à faire de ces marchés des monopoles.
Les plateformes ne peuvent que tirer avantage de cette situation et elles risquent surtout de s’emparer de ces Chartes, comme le font déjà la plupart des grandes entreprises avec la RSE, à des fins d’affichage et de communication. Un reportage récemment diffusé par Arte à propos de Starbucks a montré comment cette firme est parvenue à se donner un vernis de respectabilité en fournissant à ses employés certains avantages en termes de couverture sociale et de formation, tout en conservant par ailleurs un comportement prédateur et des conditions de travail extrêmement dures.
Cachez cette subordination que le juge ne saurait voir
Mais il y a plus grave que ces risques de « Social Washing », car comme le font remarquer plusieurs commentateurs (ainsi que les syndicats), ces chartes sociales relèvent en réalité d’une forme de « trompe-l’oeil », puisque l’essentiel de ce que prévoit l’article 40A de la loi figurait déjà dans les CGU des plateformes. C’est ce qu’explique bien l’avocat Jérémie Giniaux-Kats dans un article sur le site « Village de la justice » :
(…) les mentions obligatoires aujourd’hui prévues pour la charte envisagée sont des engagements dont la substance peut être très légère ou quasiment égale à celle du contenu typique de Conditions Générales d’Utilisation actuelles.
La charte envisagée n’a donc rien d’un nouvel outil mais constitue davantage un nouveau vocable pour un support préexistant.
Selon lui, le point le plus important de ce texte serait ailleurs, puisque sa principale « innovation » résiderait dans le fait que la loi exclut que les garanties apportées par les plateformes via ces Chartes puissent être utilisées comme indices pour caractériser un lien de subordination :
L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
L’enjeu est d’importance, car plusieurs actions en justice – jusqu’à présent infructueuses en France – ont déjà été tentées pour faire requalifier les travailleurs indépendants des plateformes en salariés et l’URSSAF a essayé également d’exiger d’Uber le paiement de cotisations sociales en s’appuyant sur le lien de subordination qui le lierait aux personnes travaillant pour lui.
Ces Chartes facultatives risquent donc de servir à « blanchir » l’état de dépendance économique dans lesquels les travailleurs des plateformes sont placés en hypothéquant leurs chances de requalification par la justice en salariés. C’est pourtant toute une partie de la doctrine juridique qui pousse pour que ces « nouveaux visages de la subordination« , comme les avait identifiés Alain Supiot dès le début des années 2000, soient pris en compte pour redéfinir les frontières du salariat.
Se résigner à la « zone grise » ?
L’ironie veut qu’au même moment, la ville de New York emprunte de son côté un tout autre chemin en imposant à Uber le respect d’une rémunération minimale pour les chauffeurs de VTC. Plutôt que les ambiguïtés de l’auto-régulation, la Grande Pomme a choisi la voie de la réglementation impérative, pour ne pas laisser les mécanismes du marché déterminer seuls la condition sociale des travailleurs indépendants.
Mais on est en droit de se demander si cette approche, en apparence plus ferme, constitue la bonne manière de lutter contre l’ubérisation. Certes, le passage par la réglementation évite que les plateformes ne « jouent les providences », alors que c’est ce que le gouvernement français les incitent à faire au nom du « bien commun ». Certains, comme Nicolas Colin dans son dernier livre « Hedge : A Greater Safety Net for The Entreprenarial Age« , appellent au contraire l’Etat à intervenir pour combler la « zone grise » de l’emploi en définissant par la loi un nouvel ensemble de droits sociaux au bénéfice des travailleurs indépendants :
À l’époque fordiste, le travail salarié était un « paquet » (bundle) avec de nombreux avantages sociaux. En revanche, les travailleurs indépendants, auxquels ont recours régulièrement les plateformes, n’ont souvent pas les moyens d’action, la protection sociale et les salaires décents qui étaient autrefois le lot des travailleurs des industries manufacturières fordistes.
L’avenir des plateformes de travail dépend de notre capacité collective à garantir un nouveau « forfait social » aux travailleurs indépendants. Si nous réussissons, le travail sur les plateformes se développera et deviendra une norme sur le marché du travail. Si nous échouons, ces promesses ne seront jamais tenues et nous en paierons le prix sous la forme de moins de travail et de moins de développement économique.
Si cette approche « interventionniste » est indéniablement préférable au paternalisme dont est imprégnée la loi Pénicaud 2, elle a néanmoins l’inconvénient de reproduire ce qui fut une des grandes limites du modèle de protection sociale issu du compromis fordiste. Faut-il en effet simplement se contenter de « réparer » ou de « compenser » les dégâts humains provoqués par un mode de production sans chercher à le remettre en cause, au risque même de le conforter en le rendant plus acceptable socialement.
Il faut à cet égard garder en tête les avertissements que lançaient déjà André Gorz au début des années 90 lorsqu’il disait que la montée des inégalités allait susciter chez ceux qui parviendraient à conserver un emploi salarié le besoin de « nouveaux valets » destinés à travailler dans des conditions précaires pour leur rendre des services domestiques :
L’inégalité sociale et économique entre ceux qui rendent les services personnels et ceux qui les achètent est devenue le moteur du développement de l’emploi, qui est fondé sur une dualisation accentuée de la société, sur une sorte de « sud-africanisation », comme si le modèle colonial prenait pied au cœur même des métropoles.
Nous voyons ainsi se reconstituer à l’ère postindustrielle des conditions qui prévalaient il y a cent cinquante ans, aux débuts de l’ère industrielle, à une époque où le niveau de consommation était dix fois plus faible, où n’existaient encore ni le suffrage universel ni la scolarisation obligatoire. A cette époque-là aussi, alors que l’économie de marché se libérait de toute entrave, un sixième de la population en était réduite à s’embaucher comme serviteurs et gens de maison chez les riches, et un quart subsistait tant bien que mal grâce à des petits boulots.
La différence est que là où dans les années 90 ce besoin de « nouveaux serviteurs » se traduisait par le développement d’emplois précaires, mais encore salariés, il débouche aujourd’hui sur la montée d’un précariat ubérisé sous la forme de ces « faux indépendants » livrés à la para-subordination des plateformes. En attachant des droits sociaux à cette « zone grise », on prend le risque qu’elle fasse tâche d’huile en englobant de plus en plus de travailleurs chassés de l’emploi, jusqu’à ce qu’elle finisse par devenir la norme.
***
Pour autant, n’y aurait-il pas intérêt à ce que les CGU des plateformes soient repensées comme des conventions collectives sans en devenir de pathétiques parodies ? Certainement, mais pas dans n’importe quelles conditions. Si l’on veut sortir de cette spirale que la loi Pénicaud 2 amplifie davantage qu’elle ne la combat, c’est une action beaucoup plus structurelle qu’il faudrait entreprendre, comme qui est expérimenté par le mouvement du Coopérativisme de plateformes. Dans cette logique, les travailleurs gardent le contrôle des plateformes tout en s’employant auprès de coopératives leur garantissant un statut de salariés. C’est ce que tente par exemple Coopcycle en France pour offrir une alternative à des acteurs comme Deliveroo ou Uber Eats et il existe des projets similaires dans d’autres secteurs, comme on peut le voir avec l’initiative « Plateformes en Communs« . Ce sont ces formes, à la croisée des Communs et de l’économie solidaire, qui peuvent faire protection sociale, là où aucun « filet de sécurité » ne compensera jamais les dégâts humains et sociaux provoqués par les plateformes à la Uber et Deliveroo.