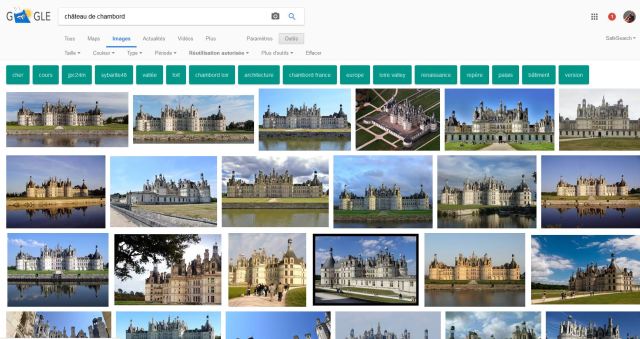La loi République numérique a-t-elle aboli le droit d’auteur des agents publics ?
jeudi 8 mars 2018 à 21:14La loi République numérique fait partie de ces textes surprenants, dont les effets ne se révèlent complètement qu’au fil du temps, à mesure que les interprétations se développent. On l’avait déjà constaté en décembre dernier, lorsqu’il a été établi que cette loi avait pour effet de faire passer par défaut en Open Source les logiciels produits par les administrations. Mais d’autres surprises nous attendent peut-être encore, et non des moindres !

C’est ce qui est apparu la semaine dernière, lors d’un événement organisé par Creative Commons France pour le lancement officiel de la traduction en français de la version 4.0 de ces licences, auquel j’ai été convié. Une juriste de la mission Etalab figurait parmi les intervenants et elle a été soumise à un feu roulant de questions, notamment à propos de la possibilité pour les administrations d’utiliser les licences Creative Commons pour diffuser leurs productions.
Ses réponses ont confirmé quelque chose de très négatif, car il semble bien que le recours aux Creative Commons soit désormais en principe interdit (ou du moins compliqué…) pour les administrations, à cause du décret d’application de la loi fixant les licences qu’elles peuvent valablement utiliser. Mais paradoxalement, l’interprétation de la loi République numérique retenue par Etalab est aussi susceptible de nous apporter une excellente nouvelle, car le texte va peut-être nous débarrasser d’une des aberrations les plus criantes du système actuel, à savoir le droit d’auteur des agents publics.
Quelques éléments d’explication s’imposent pour montrer comment on peut arriver à une telle conclusion, laquelle mérite encore sans doute approfondissements et discussions, car certaines des prémisses du raisonnement semblent assez fragiles…
Mais qui sait ! ;-)
Les administrations interdites d’utiliser les licences Creative Commons ?
On savait déjà que les administrations allaient avoir des difficultés à utiliser les licence Creative Commons pour diffuser leurs données en Open Data. C’est ce qui résulte du décret d’application de la loi République numérique, adopté en avril dernier, qui liste les licences auxquelles les administrations peuvent recourir pour mettre à disposition des informations publiques.
Le texte ne prévoit en effet que deux options : la Licence Ouverte/Open Licence et l’ODbL (Open Database Licence).
L’administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu’elle détient aux licences suivantes :
1° La licence ouverte de réutilisation d’informations publiques ;
2° “ L’Open Database License .
Les Creative Commons ne font donc pas partie de cette shortlist, ce qui est assez incompréhensible, si l’on y réfléchit quelques instants. Car en effet, c’est précisément une des nouveautés de la version 4.0 que les CC prennent désormais en compte le droit sui generis des bases de données, ce qui en fait des instruments tout à fait adaptés pour la diffusion de données en Open Data. La Licence Ouverte est l’équivalent d’une licence Creative Commons CC-BY (Attribution) et l’ODbL l’équivalent d’une CC-BY-SA (Attribution – Partage dans les mêmes conditions). Il aurait donc été logique que le décret les mentionne également, d’autant plus que les CC sont les licences les plus largement connues au monde, au point d’être devenues un véritable standard sur le plan international.
Pour être exact, l’usage des Creative Commons par les administration n’est pas complètement impossible, mais il faut que celles-ci fassent une demande motivée auprès de la DINSIC et se plient à une procédure spéciale d’homologation fixée par le décret :
L’administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l’article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État une demande d’homologation de la licence qu’elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l’objet de la demande.
Sachant que la demande doit se faire jeu de données par jeu de données, l’obstacle procédural est donc loin d’être anodin et cela constituera un frein considérable à l’utilisation des Creative Commons en matière d’Open Data, ce que l’on peut fortement regretter.
Une limitation qui s’applique aussi aux documents administratifs ?
Mais il y a peut-être encore plus grave, comme l’a montré une des discussions qui a eu lieu lors de cet événement de la semaine dernière. Une personne travaillant dans une administration s’est exprimée depuis l’assistance pour raconter qu’elle avait voulu faire paraître un rapport sous Creative Commons, mais qu’elle a été bloquée par son ministère de tutelle qui lui a demandé de le passer en Licence Ouverte, visiblement suite à des remarques adressées par Etalab.
Cette demande est a priori difficilement compréhensible, mais elle a bien été confirmée par la juriste d’Etalab. Ce qui est étonnant, c’est qu’un rapport n’est pas un jeu de données, mais une oeuvre de l’esprit soumise en tant que telle au droit d’auteur. Or le décret qui bloque le recours aux Creative Commons porte sur les «licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques». Comment Etalab peut-il assimiler des oeuvres à des informations ? Juridiquement, il y a une différence dans la nature même de ces deux objets qui ne relèvent pas du même terrain.
Mais le raisonnement suivi est, semble-t-il, le suivant. Le rapport en question n’est pas uniquement une oeuvre : c’est aussi un «document administratif». Or le Code des relations entre le public et l’administration (ancienne loi CADA) articule étroitement les données et les documents, dans la mesure où il saisit les informations publiques en tant qu’elles sont contenues dans des documents administratifs. C’est ce qui ressort bien de l’article de loi définissant le droit à la réutilisation des informations publiques :
Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations […] peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
C’est donc cette approche « documentaire » des textes qui produirait ici une sorte d’effet récursif : le décret relatif aux licences a beau ne parler que d’informations publiques, il s’appliquerait aussi aux documents eux-mêmes parce que ceux-ci contiennent des informations publiques.
Les conséquences d’une telle interprétation seraient pourtant très négatives, car il existe déjà un certain nombre d’administrations qui diffusent des oeuvres produites dans le cadre de leurs activités sous licence Creative Commons. Elles s’en trouveraient à présent empêchées et si l’on se réfère au décret, seule la Licence Ouverte serait désormais utilisable par les administrations, car l’ODbL est un outil fait pour les bases de données et non pour les oeuvres.
Le droit d’auteur des agents publics neutralisé ?
Cette exclusion des licences Creative Commons n’est pas une bonne nouvelle, mais comme dit le proverbe « A toute chose, malheur est bon », car le raisonnement suivi par Etalab va peut-être aussi avoir une conséquence positive, en nous débarrassant du droit d’auteur des agents publics, ou pour être plus exact, en le neutralisant dans la plupart de ses effets.
Initialement, on a pensé que le principe d’ouverture par défaut consacré par la loi République numérique valait seulement pour les données produites par les administrations. Mais en décembre dernier, on a déjà pu constater que la portée de la loi était en réalité plus large, car les logiciels développés par les administrations sont aussi concernés, alors qu’il s’agit « d’oeuvres » et non de « données ». Il en est ainsi parce que la loi qualifie explicitement les logiciels de « documents administratifs communicables » et par un jeu de renvoi entre articles de loi, cela inclut mécaniquement les logiciels dans le périmètre d’application du principe d’ouverture par défaut.
Mais visiblement, les choses ne vont pas s’arrêter là. Si l’on suit Etalab, le décret sur les licences s’applique aussi à des objets comme des rapports, qui sont des oeuvres de l’esprit. Cela voudrait donc dire que les oeuvres produites par les administrations dans le cadre de leur mission de service public vont elles aussi être soumises – dans une mesure à déterminer – au principe d’ouverture par défaut, avec à la clé une obligation pour les administrations de les publier spontanément et de les rendre librement réutilisables. Retenir une telle interprétation aurait un effet considérable, car cela signifie que les textes, photos, enregistrements, vidéos, et plus largement tous les objets assimilables à des oeuvres de l’esprit produits par des agents publics, passeraient potentiellement en bloc sous l’équivalent d’une Licence Ouverte (simple obligation de citer la source, sans autre limite à la réutilisation).
Il existe pourtant en France un droit d’auteur des agents publics qui a été formalisé par la loi DADVSI en 2006. Les agents qui créent des oeuvres dans le cadre de leur mission de service public sont bien réputés disposer d’un droit d’auteur, mais celui-ci est automatiquement transféré à leur administration de tutelle, à l’exception du droit de paternité (respect du nom de l’auteur). Tous les droits patrimoniaux (reproduction, représentation) et même les autres aspects du droit moral (droit de divulgation, droit à l’intégrité) sont exercés directement par l’administration. Ces mécanismes n’ont pour l’instant pas vraiment joué dans le sens de l’ouverture, car les administrations pouvaient choisir d’exercer les droits transférés par leurs agents comme des droits exclusifs pour s’opposer à la réutilisation des oeuvres produites par leurs agents, et même la monnayer.
Or si l’on doit à présent saisir ces créations comme des « documents administratifs » soumis au principe de libre réutilisation, tout va changer, car ils seraient aussi inclus dans le principe de gratuité interdisant de leur appliquer des redevances. On aboutirait en fait à un résultat très proche de celui qui prévaut aux États-Unis pour les productions des agences fédérales qui appartiennent dès l’origine au domaine public et sont librement réutilisables.
Limites du raisonnement et incertitudes…
L’interprétation proposée par Etalab est donc très séduisante par la puissance de ses effets potentiels, mais j’avoue qu’elle m’étonne, car est-il vraiment si simple d’appliquer aux oeuvres des agents publics des règles conçues à la base pour les informations publiques ?
Le Code des relations entre l’administration et le public prévoit des dispositions pour articuler la réutilisation des documents administratifs avec les questions de propriété intellectuelle :
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent titre, les informations contenues dans des documents […] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Cela s’applique par exemple à des documents correspondant à des oeuvres qui pourraient être détenues par des administrations, mais qui auraient été créées par des personnes extérieures, n’ayant pas la qualité d’agent public. On peut aussi penser à certaines catégories d’agents publics comme les chercheurs, qui conservent l’intégralité de leurs droits sur les oeuvres qu’ils produisent (cours, articles, livres, ressources pédagogiques, etc.) et qui restent bien des « tiers » vis-à-vis de l’administration du point de vue de la propriété intellectuelle.
Mais comme on l’a vu, les droits d’auteur des agents publics « classiques » sont transférés automatiquement à l’administration qui les exercent en propre. La question revient donc à savoir si l’administration peut faire valoir ces droits d’auteur pour s’opposer à la libre réutilisation de documents administratifs. La loi République numérique contient des dispositions pour clarifier la manière dont le principe d’ouverture par défaut se combine avec la propriété intellectuelle des administrations. On trouve notamment un article qui interdit aux administrations d’utiliser leur droit de producteur de base de données pour faire obstacle à la réutilisation d’informations publiques :
Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits [de producteur de base de données], ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient […]
Or on ne trouve (hélas…) rien de tel à propos du droit d’auteur des agents publics, ce qui me fait penser que l’interprétation d’Etalab est un peu hardie et qu’on ne peut être certain que le législateur a entendu neutraliser le droit d’auteur des agents publics comme il l’a explicitement fait pour le droit des bases de données.
Mais même si l’on admet que les documents administratifs correspondant à des oeuvres réalisées par des agents publics relève à présent du principe d’ouverture par défaut, quelle en serait exactement la portée ?
En effet, c’est l’article 6 de la loi qui fixe le périmètre du principe d’ouverture par défaut et il ne lui donne pas exactement le même périmètre en ce qui concerne les documents administratifs et les données :
[…] lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations […] publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
Au titre du 1° et du 2°, les documents ayant fait l’objet d’une demande de communication satisfaite par l’administration et les documents listés dans les Répertoires d’Informations Publiques (RIP) seraient donc bien concernés, même s’il s’agit d’oeuvres de l’esprit créées par des agents publics. Mais l’Open Data par défaut est en réalité défini par les 3° et 4°, or ces alinéas parlent de « bases de données » et de « données », et non de « documents »…
Peut-être que le 4° est tout de même applicable aux « oeuvres », si l’on considère que celles-ci incorporent toujours des données, entendues comme des informations. Ce sera par exemple nécessairement le cas pour un rapport, les pages d’un site internet ou l’enregistrement d’une conférence, et même une simple photographie possède en réalité toujours une certaine dimension « informative ». Mais le 4° comporte deux limitations, puisqu’il faut 1) que les données soient « mises à jour de façon régulière » (et comment cela s’applique-t-il à une oeuvre ?) et 2) que la publication présente un « intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». Cette succession d’adjectifs est certes très large (qu’est-ce qui n’a pas un intérêt social ?), mais elle introduit un flou qui pourra générer des incertitudes pour déterminer dans quelle mesure les oeuvres des administrations tombent dans le principe d’ouverture par défaut…
***
En conclusion, j’avoue que je reste assez dubitatif et il paraît nécessaire à ce stade qu’Etalab apporte des clarifications sur sa doctrine.
D’un côté, je trouve absurde et dommageable que les administrations soient empêchées d’utiliser les licences Creative Commons, que ce soit pour diffuser des jeux de données ou des oeuvres. Le décret d’application de la Loi République numérique devrait être modifié pour leur donner cette possibilité sans passer par une ubuesque procédure d’homologation. Celle-ci pourrait avoir du sens pour des licences « maison » que les administrations voudraient bricoler, mais elle n’en a aucun pour un instrument aussi éprouvé et répandu que les Creative Commons.
Par ailleurs, il est aussi important de savoir comment la loi République numérique s’articule exactement avec le droit d’auteur des agents publics. Personnellement, j’applaudirai des deux mains si les créations des agents publics deviennent par principe librement réutilisables, mais encore faut-il que l’on sache avec précision comment l’Open Data par défaut est susceptible de se prolonger en Open Content…