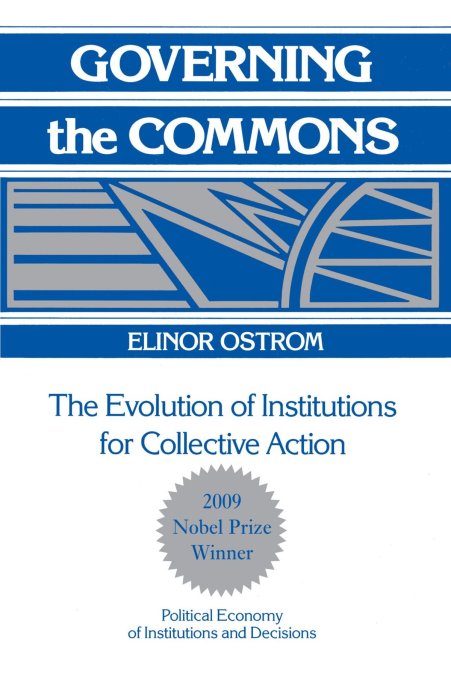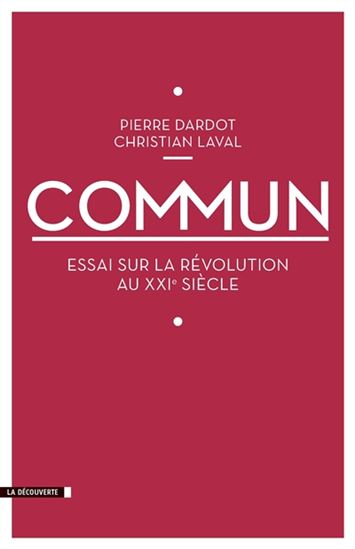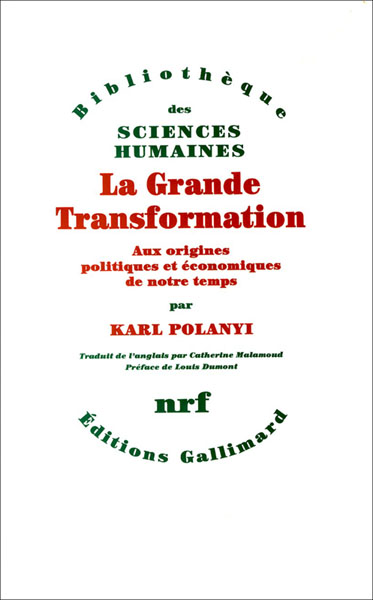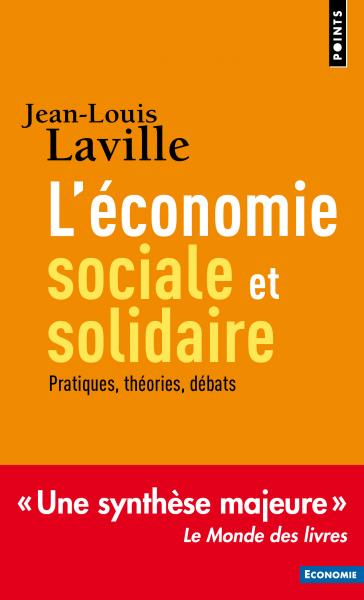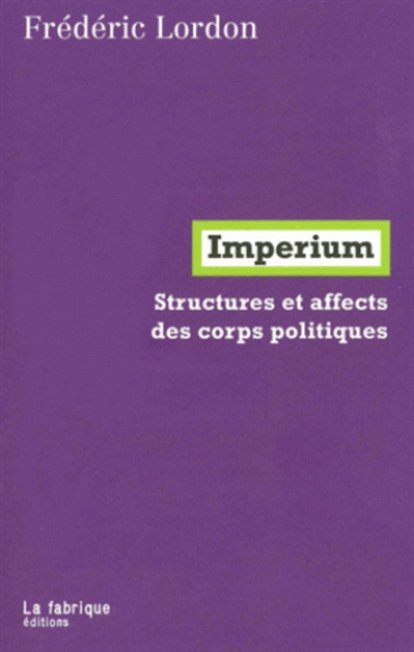J’ai profité de l’été pour publier une série de billets dont j’avais repoussé la rédaction trop longtemps. Parmi eux, celui que je poste aujourd’hui me tenait particulièrement à coeur, car cela fait plusieurs mois que je voulais écrire un commentaire du livre Maintenant, publié par le Comité invisible en avril dernier aux éditions La Fabrique.

Ce n’est pas une entreprise facile, car comme les précédents ouvrages du Comité invisible (L’insurrection qui vient et A nos amis), ce livre est incroyablement dense et il demande plusieurs lectures approfondies pour en déplier tous les aspects. Certains passages sont vraiment lumineux, comme ceux qui analysent l’épisode de Nuit Debout avec une critique particulièrement juste de « l’assembléisme » et du « mimétisme parlementariste » dans lequel le mouvement s’est englué. La question du travail fait également l’objet de développements remarquables, avec des ouvertures sur « l’économie collaborative » dépeinte comme la nouvelle frontière du capitalisme par l’extension de la mesure à laquelle elle nous soumet ou la manière dont l’exploitation des données personnelles par les GAFAM nous transforme en « capital humain ». Sur des questions complexes comme celle du revenu de base, le livre donne aussi beaucoup à réfléchir. Une phrase comme celle-ci : « Il n’y a qu’à une population parfaitement sous contrôle que l’on peut songer d’offrir un revenu universel » vaut sans doute à elle seule davantage que bien des articles critiques que j’ai pu lire sur la question… L’ouvrage revient aussi longuement sur le conflit social de 2016 autour de la loi Travail, en essayant de montrer en quoi il a constitué une rupture, tant du côté du pouvoir et de la police (contexte de l’état d’urgence, remise en cause du droit à manifester, application de la tactique des « nasses ») que des manifestants eux-mêmes (avec notamment l’apparition d’un « cortège de tête », particulièrement valorisé par le Comité invisible, qui a réussi à fédérer plus largement que les traditionnels « autonomes » en subvertissant le sens même des manifestations).
Sur tous ces points – et bien d’autres – le livre est indéniablement précieux. Mais c’est pourtant une profonde sensation de malaise qui m’a étreint lorsque je l’ai refermé. Car si en apparence l’ouvrage – comme A nos amis le faisait déjà – met constamment en avant le concept « d’amitié » (en affichant l’objectif de « frayer des chemins » ou « d’organiser des rencontres » entre des « mondes amis fragmentés »), il constitue avant tout une expression particulièrement acerbe d’inimitiés, frappant à peu près toutes les composantes du mouvement social. Communistes, syndicalistes, négristes, écologistes, féministes, municipalistes, acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, militants de la Transition : tout le monde y passe successivement, dans un esprit d’excommunication – j’emploie le mot à dessein – traquant la moindre compromission avec le système économique et politique comme motif de disqualification définitive. Ironiquement, les auteurs critiquent la tendance (hélas bien réelle…) des cercles militants à s’entre-déchirer (« Chaque groupuscule s’imagine gratter quelques parts du marché de la radicalité à ses rivaux les plus proches en les calomniant autant qu’il est possible.« ), mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le Comité Invisible tombe aussi complètement dans ce travers avec ce livre. Or le mouvement des Communs n’échappe pas à ce petit jeu de massacre et c’est ce qui me pousse à écrire sur Maintenant, parce qu’il me semble que de telles attaques appellent une réponse que je n’ai pour l’instant lue nulle part.
Bien sûr, ce n’est pas tant le principe même de ces critiques qui posent problème, que l’angle sous lequel elles sont assénées et l’intention qui les anime. Il me semble en particulier que les prémisses théoriques et philosophiques sur lesquelles le Comité invisible appuie son raisonnement – notamment son analyse des phénomènes collectifs – sont défaillantes et susceptibles d’emmener les acteurs du mouvement social sur des chemins qui ne mènent nulle part. Étant donné l’influence que leurs ouvrages exercent (j’ai bien eu l’occasion de le constater en participant à Nuit Debout…), je pense important de démonter les principaux arguments du livre en montrant en quoi ils sont en contradiction avec les fondements de la pensée des Communs. Comprendre pourquoi le Comité invisible éprouve à ce point le besoin de s’en prendre – entre autres – aux Communs est chose utile, car c’est aussi une manière de mieux comprendre ce que sont les Communs, en cernant au passage les raisons de leur incompatibilité avec une certaine mouvance anarcho-libertaire. C’est en tout cas à titre personnel le principal bénéfice que j’ai retiré de la lecture du livre (« know your ennemy », comme dit la chanson…). Je terminerai aussi en relevant certaines contradictions affectant la démarche même du Comité invisible, qui me paraissent confiner à l’imposture intellectuelle (si tant est que l’on accorde un peu d’importance à la cohérence entre les paroles et les actes…).
Dans A nos amis déjà…
A vrai dire, la critique des Communs n’a pas commencé chez le Comité invisible avec Maintenant. On trouve en effet déjà dans A nos amis un chapitre intitulé « Omnia sunt communia » traitant du sujet sur une vingtaine de pages. Il y est question notamment des mouvements d’occupation des places publiques en Egypte, en Espagne et en Turquie, qui se sont tous en effet revendiqués, à divers degrés, à la fois des Communs et de la Commune.

Dans A nos amis, Le Comité invisible exprime son attachement à cette dernière et sa méfiance envers les premiers :
Des économistes se sont attachés à développer ces dernières années une nouvelle théorie des «communs». Les «communs», ce serait l’ensemble de ces choses que le marché a le plus grand mal à évaluer, mais sans quoi il ne fonctionnerait pas : l’environnement, la santé mentale et physique, les océans, l’éducation, la culture, les Grands Lacs, etc., mais aussi les grandes infrastructures (les autoroutes, Internet, les réseaux téléphoniques ou d’assainissement, etc.). Selon
ces économistes à la fois inquiets de l’état de la planète et soucieux d’un meilleur fonctionnement du marché, il faudrait inventer pour ces «communs» une nouvelle forme de «gouvernance» qui ne reposerait pas exclusivement sur lui.
Governing the Commons est le titre du récent best-seller d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’Économie en 2009, qui a défini huit principes pour «gérer les communs». Comprenant qu’il y avait une place à prendre dans une « administration des communs encore toute à inventer, Negri et consorts ont fait leur cette théorie au fond parfaitement libérale. Ils ont même étendu la notion de commun à la totalité de ce que produit le capitalisme, arguant de ce que cela émanait en dernier ressort de la coopération productive entre les humains, qui n’auraient plus qu’à se l’approprier au travers d’une insolite «démocratie du commun».
Les éternels militants, toujours à court d’idées, se sont empressés de leur emboîter le pas. Ils se retrouvent maintenant à revendiquer «la santé, le logement, la migration, le travail de care, l’éducation, les conditions de travail dans l’industrie textile» comme autant de «communs» qu’il faudrait s’approprier.
En lisant ce passage, on constate que ce qui pose problème au Comité invisible, c’est d’abord le fait que la théorie des Communs soit ancrée dans le champ de l’économie (Elinor Ostrom a bien reçu le prix Nobel d’économie, même si en réalité ses travaux sont à la croisée de plusieurs disciplines : la science politique, le droit, l’histoire, etc.). Et oui, l’ouvrage majeur d’Elinor Ostrom s’intitule « Governing The Commons », que l’on a traduit en français par « La gouvernance des Communs », mais qui aurait tout aussi bien pu s’appeler « Le gouvernement des Communs ». Car ce qu’Ostrom analyse, ce sont les phénomènes de pouvoir – appelons un chat un chat – à l’oeuvre au sein des groupes assurant la gestion de ressources mises en commun, c’est-à-dire la manière dont ils arrivent à instaurer des règles et à les faire appliquer par des processus de décision collective. Ostrom explique – c’est le sens des fameux huit principes de conception des Communs (design principles) brocardés par le Comité invisible – qu’à défaut d’être capables d’instaurer efficacement cette gouvernance, les groupes ne parviennent en général pas à assurer la préservation des ressources dans le temps, qui finissent surexploitées, saccagées ou accaparées.
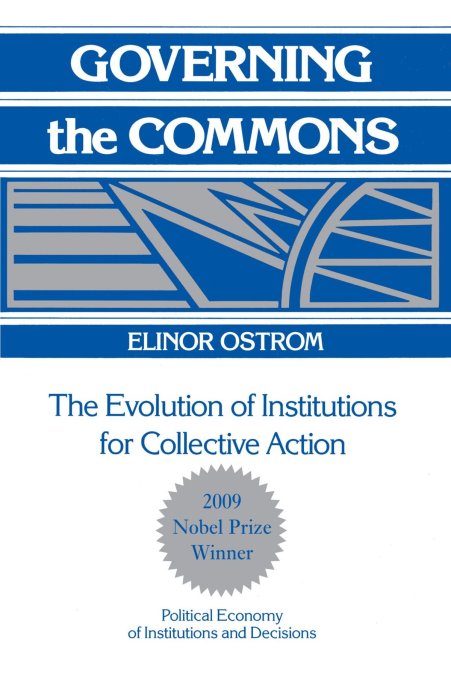
Elle insiste par contre sur un point, passé sous silence par le Comité invisible alors qu’il est essentiel : celui de l’importance, en tant que facteur de réussite, de l’auto-organisation et de l’auto-détermination des groupes qui gèrent des Communs, (les mots « self-organization » et « self-governance » reviennent ainsi constamment dans l’ouvrage). Elle constate en effet dans ses observations que, dans les hypothèses où des autorités extérieures ne laissent pas suffisamment d’autonomie aux communautés pour établir des règles adaptées à chaque situation particulière, la gestion en commun échoue quasi systématiquement. Et symétriquement, au sein même des communautés, elle constate que les modèles hiérarchiques sont moins efficaces et que le succès des groupes est conditionné au fait que l’ensemble des membres puissent prendre part aux délibérations concernant les règles à établir et leur mise en oeuvre. Il y aurait d’ailleurs ici un point de rencontre possible avec la tradition anarcho-libertaire dans laquelle s’inscrit le Comité invisible, notamment via la question de l’auto-gestion. Mais leur positionnement est en réalité si extrême que le simple emploi de termes comme « économie », « gouvernance », « gestion » ou « administration » suffit à leurs yeux à disqualifier la démarche.
Aux Communs, ils préfèrent opposer la Commune, en tant que lieu de vie et de liens, en tant qu’espace à habiter et manifestation de la propension des groupes à s’organiser :
Les communes contemporaines ne revendiquent pas l’accès ni la prise en charge d’un quelconque «commun», elles mettent en place immédiatement une forme de vie commune, c’est-à-dire qu’elles élaborent un rapport commun à ce qu’elles ne peuvent s’approprier, à commencer par le monde.
Le problème, c’est que cette soit-disante distinction entre les Communs et la Commune reste baignée dans le plus grand flou. Beaucoup des acteurs qui ont participé aux mouvements d’occupation des places se sont revendiqués explicitement du mouvement des Communs, tout autant qu’ils se référaient à l’exemple historique de la Commune, sans y voir de contradictions. Par ailleurs, au titre de ma propre expérience au sein de Nuit Debout, j’ai pu constater que la gestion des aspects matériels liés à l’occupation de la place de la République s’était opérée sous la forme d’une articulation de plusieurs Communs, très « ostromiens », pris en charge par les commissions logistiques du Mouvement (voir notamment ici). C’est aussi ce qu’exprime Pascal Nicolas-Le Strat dans son ouvrage « Le travail du Commun« , où l’on voit bien qu’opposer Communs et Commune à propos des mouvements d’occupation ne fait guère de sens :
[…] tous les récits d’occupation racontent immanquablement la capacité des gens à inventer une gestion démocratique de la vie quotidienne et leur capacité à construire en commun les « communs » indispensables au développement d’une communauté de vie (pour les repas, pour l’hygiène, pour la communication, pour le débat, pour la co-formation…). De ce point de vue, les occupations sont un parfait synonyme du « commun oppositionnel ». Elles s’accompagnent d’une réappropriation des conditions de vie et rehaussent l’expérience de l’autonomie. Nul besoin d’école pour apprendre, nul besoin de médias pour communiquer, nul besoin de restaurant pour se nourrir, nul besoin d’institution culturelle pour créer.
Au final, on comprend assez mal dans A nos amis les raisons profondes de cette hostilité du Comité invisible vis-à-vis des Communs, mais Maintenant a le mérite de clarifier par où passent ces lignes de fracture.
Destituer le monde ?
Le principal point d’achoppement tient à la perception du rôle des institutions, que le Comité Invisible condamne radicalement, notamment dans un chapitre intitulé « Destituons le monde ». Les auteurs y critiquent la tendance des mouvements militants à vouloir créer des institutions alternatives à celles qui existent déjà, en appelant au contraire à faire de la destitution l’horizon de toutes les luttes. Rien ne déplaît plus, par exemple, au Comité invisible que les mouvements municipalistes, issus du mouvement des Indignés en Espagne qui ont pris par les urnes les municipalités de Madrid et de Barcelone, sur la base de programmes faisant d’ailleurs une place aux Communs (voir ici).
Le Comité invisible n’a pas de mots assez forts pour condamner toute forme de compromission avec la logique institutionnelle et ce passage en particulier, me paraît intéressant à relever :
La grande malice de l’idée d’institution est de prétendre qu’elle nous affranchirait du règne des passions, des aléas incontrôlables de l’existence, qu’elle serait un au-delà des passions quand elle n’est que l’une d’elles, et certainement l’une des plus morbides. L’institution se veut un remède aux hommes, à qui on ne peut décidément pas faire confiance, peuple ou dirigeant, voisin, frère ou inconnu. Ce qui la gouverne, c’est toujours la même fadaise de l’humanité pécheresse, sujette au désir, à l’égoïsme, à la concupiscence, qui doit se garder d’aimer quoi que ce soit en ce monde et de céder à ses penchants tous uniformément vicieux. Ce n’est pas de sa faute si un économiste comme Frédéric Lordon ne peut se figurer une révolution qui ne soit une nouvelle institution. Car c’est toute la science économique, en pas seulement son courant « institutionnaliste », qui se ramène en dernier ressort à du Saint Augustin. Au travers de son nom et de son langage, ce que promet l’institution, c’est qu’une chose en ce bas-monde aura transcendé le temps, se sera soustrait au cours imprévisible du devenir, aura établi un peu d’éternité palpable, un sens univoque, affranchi des liens humains et des situations – une stabilisation du réel définitive comme la mort.
On relèvera la petite pique adressée à Frédéric Lordon (sur laquelle nous reviendrons plus loin, car il est extrêmement intéressant de confronter ce qui est dit dans Maintenant au livre Imperium : structures et affects des corps politiques). Mais arrêtons-nous pour l’instant à l’attaque contre l’économie institutionnaliste, car c’est précisément le courant auquel se rattache Elinor Ostrom, notamment à travers sa branche américaine fondée par John Roger Commons au début du 20ème siècle. Cette école se distingue de l’économie néo-classique par l’importance qu’elle attache à l’analyse du rôle des institutions dans les comportements économiques.
Or cette approche marque profondément les travaux d’Elinor Ostrom pour qui les Communs sont avant toute chose des institutions (son livre Governing the Commons est d’ailleurs sous-titré en anglais : « The Evolution of Institutions for Collective Action« ) et c’est cela qui rend sa pensée foncièrement incompatible avec celle du Comité invisible. Pour Ostrom, les Communs ne sont ni des ressources, ni même des communautés, mais ce qu’elle appelle des arrangements institutionnels, liés aux règles collectivement mises en place par des groupes pour la gestion des ressources partagées, ainsi que les dispositifs assurant leur effectivité. Cette nature institutionnelle des Communs ressort bien dans cette définition proposée par la chercheuse néerlandaise Tine de Moor :
Un bien commun est un modèle de gouvernance qui facilite la coopération entre des personnes qui bénéficient d’un avantage en travaillant ensemble, par la création d’une économie d’échelle (modeste). Quand il est question de biens communs, il faut tenir compte des trois aspects suivants ; un groupe d’utilisateurs, généralement des « prosommateurs », des gens qui sont donc à la fois producteurs et consommateur. Ils prennent des décisions collectives concernant l’utilisation de ressources. Les ressources sont collectives également, en ce sens que leur utilisation dépend de la décision du groupe ; être membre du groupe vous confère des droits d’utilisation. Bien que l’utilisation collective d’une ressource puisse être intéressante, tant économiquement que socialement, la coopération n’est pas forcément directe. Lorsque des personnes travaillent et utilisent des ressources ensemble, un dilemme social peut survenir qui force les membres individuels du groupe à arbitrer entre leur avantage individuel à court terme et les avantages collectifs à long terme. Les « communiers » élaborent des règles visant à faciliter l’interaction entre le groupe d’utilisateurs et la ressource collective, ainsi que pour surmonter ce type de dilemmes sociaux.
C’est ainsi qu’émerge une nouvelle institution pour l’action collective. Sa conception et son fonctionnement sont sensiblement différents du marché et de l’État pris comme modèles de gouvernance dans la mesure où l’institution en question est basée sur l’auto-gouvernance, c’est-à-dire l’auto-régulation, l’auto-sanction et l’auto-gestion.
Les Communs sont donc « des institutions pour l’action collective » et il est clair qu’on ne peut les accueillir de manière bienveillante lorsqu’on se donne pour objectif de « destituer le monde »… Notons d’ailleurs que, pour faire écho au passage précité de Maintenant, l’institution que constitue le Commun dans l’approche d’Elinor Ostrom a bien pour but de réguler « les passions« , « les désirs« , « l’égoïsme » ou les « penchants » des individus qui la composent. Ostrom étudie en effet des ressources naturelles rivales (pâturages, sources d’eau, réserves de poissons, forêts, etc.) qui sont sensibles aux prélèvements opérés par les individus y ayant accès. La finalité des arrangements institutionnels est donc de mettre en place des règles qui viennent contenir la tendance des individus à ce que Frédéric Lordon appelle la « pronation », c’est-à-dire le désir de s’approprier et de prendre pour soi. Pour y arriver, les Communs établissent des règles, mais aussi se donnent les moyens d’en vérifier l’observation par les individus, y compris par le biais de systèmes de sanctions pouvant frapper les contrevenants.
Les Communs ont donc bien une nature institutionnelle et certains vont même plus loin dans cette direction, en expliquant que la dynamique du Commun relève toute entière d’une « praxis instituante ». C’est l’apport notamment de Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage « Commun : essai sur la révolution au XXIème siècle« , ici résumé par Paul Sereni dans une recension :
S’appuyant sur les concepts formés par Castoriadis d’imagination sociale, d’imaginaire social et d’auto-institution, le texte cherche à montrer que le commun est le résultat d’une institution autonome de choses et de relations par l’activité d’un sujet collectif. Cette activité est naturellement une activité de création ou d’invention radicale, et cette dimension est nommée « praxis instituante» […] Si elle est dite « instituante » (et non pas institutionnelle ou institutionnalisante), c’est précisément parce que cette praxis invente des institutions nouvelles (au lieu d’entrer dans des cadres déjà formés, d’adapter les institutions existantes à un donné nouveau ou de les modifier à la marge).
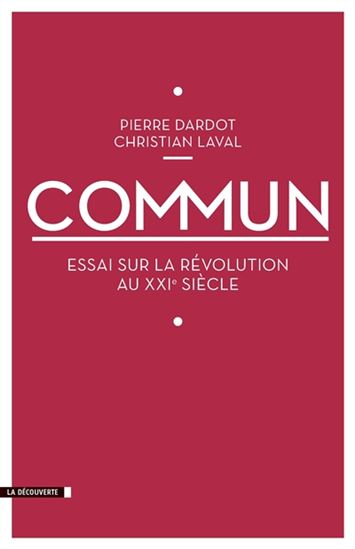
Pas plus que pour Ostrom, il ne s’agit donc pour Dardot et Laval de se passer des institutions, mais au contraire de faire en sorte que la société se réapproprie le processus de création des institutions, et c’est dans ce projet qu’ils identifient le potentiel révolutionnaire des Communs (voir ici):
La révolution dont parle Castoriadis, c’est la réinstitution de la société par elle-même, c’est donc l’acte démocratique par excellence. La révolution est trahie dès qu’un parti, des experts, des pouvoirs économiques se substituent à la capacité politique de la société, à la praxis instituante de ses membres. La question de la révolution est donc de savoir quelles institutions la société doit et peut se donner pour entretenir cette capacité politique et cette praxis instituante.
Cela ne veut cependant pas dire que le concept de destitution développé dans Maintenant ne soit pas intéressant pour penser les Communs. Dans son ouvrage précité « Le travail du Commun », Pascal Nicolas-Le Strat y a par exemple recours pour montrer que la dynamique des Communs s’inscrit en réalité toujours dans une dialectique entre destitution et institution. Ceux qui veulent se réapproprier des Communs se trouvent en général aux prises avec des institutions, publiques ou privées, qui en ont confisqué la gestion et qu’ils doivent donc commencer par « destituer », parfois en allant jusqu’à se mettre dans l’illégalité. Mais ce mouvement est inséparable de la construction en parallèle d’un Commun sous la forme d’une nouvelle institution. C’est ce que l’auteur appelle la « portée destituante/instituante du Commun » :
Qu’est-ce que ces mouvements opposent aux institutions dominantes ? Fondamentalement, bien sûr, leur rage, leur espoir, leurs revendications. Mais, de façon tout aussi substantielle, ces engagés / enragés dressent face aux institutions établies leur puissance d’autonomie, leur capacité à « faire autrement », sur un mode collectif et transversal, en déjouant toute autorité verticale, et en apportant la preuve, en acte, par une pédagogie du faire, qu’ils peuvent se rapporter égalitairement les uns aux autres, « comme s’ils étaient déjà libres » pour reprendre la belle formule de David Graeber qui donne son titre à son livre. Je nomme « commun oppositionnel » cette conception substantielle du rapport critique qui puise pareillement dans des affects « négatifs » (s’opposer) et dans des affects « positifs » (communaliser), qui les conjugue pour, simultanément, dans le même mouvement critique, destituer les normes d’activité dominantes et en instituer de nouvelles.

On pourrait donner des dizaines d’exemples de cette dialectique destituante/instituante à l’oeuvre dans les Communs, mais il y en a un sur lequel je voudrais insister, parce que je trouve qu’il montre bien l’erreur foncière d’analyse commise par le Comité invisible : c’est celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD est typiquement ce que Maintenant encense à plusieurs endroits – à juste titre – comme une entreprise réussie de destitution de l’État sur une portion du territoire. Mais j’ai eu l’occasion cette année de faire plusieurs séjours à Notre-Dame-des-Landes et une chose qui est immédiatement palpable lorsqu’on discute avec les occupants, c’est que la ZAD est le lieu d’un intense travail instituant. Les occupants (pourtant souvent très proches idéologiquement du Comité invisible) ont développé un ensemble de structures de coordination, leur permettant de débattre collectivement et d’organiser l’occupation du territoire (voir par exemple ce dossier de la confédération paysanne). Outre les multiples « collectifs » sur lesquels s’appuient la vie sur la ZAD avec chacun leurs propres règles de fonctionnement, les occupants ont par exemple mis en place un comité chargé d’arbitrer les situations de conflits (geste tout à fait « ostromien », correspondant au point n°6 de ses huits principes…). Par ailleurs, la ZAD n’est pas refermée sur elle-même et elle est en réalité organisée selon un principe de « gouvernance polycentrique » sur lequel Ostrom a beaucoup insisté à la fin de sa vie. C’est ce qu’incarnent des associations comme COPAIN, l’ACIPA ou l’ADECA fédérant l’action de plusieurs dizaines de groupes – aux intérêts parfois divergents- mais tous en lutte contre le projet d’aéroport. On notera aussi que maintenant que les perspectives d’une victoire paraissent se dessiner, les occupants imaginent la manière dont ils pourraient rendre pérennes l’occupation et invoquent à ce titre explicitement les Communs comme forme possible d’une exploitation collective des terres. On peut se reporter à ce sujet au texte « De la Zad aux communaux« , dans lequel les occupants expriment l’idée qu’ils ont déjà construit des Communs sur la ZAD :
Les communs, cʼest toutes les infrastructures de lʼautonomie dont a su se doter le mouvement au fil des années et qui sʼinventent au jour le jour dans ce bocage. Ces outils sont multiples et ont pour objet de sʼorganiser collectivement pour répondre à nos besoins :
– se nourrir (cultures collectives sur les terres occupées, formes de mise en partage des machines agricoles communes, tentatives de distribution non marchandes des denrées autoproduites sur la zone mais aussi des invendus des supermarchés, etc.).
– sʼinformer et communiquer (radio klaxon, zadnadir, zadnews, photocopilleuses communes, etc.),
– se défendre (formes de mises en partages de matériel médical et dʼapprentissage collectif de gestes de soins, de stratégies de défense face à la police et à la justice, caisse antirépression, diffusion de pratiques et de matériaux pour lʼaffrontement, tractopelle commun, etc.).
Allons même plus loin pour clôre cette partie : si le mouvement de lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a pu durer aussi longtemps dans le temps et se trouve en mesure de l’emporter aujourd’hui, c’est parce qu’il est parvenu à mettre en place des arrangements institutionnels – au sens ostromien – et à se doter d’un ensemble d’infrastructures sous la forme de Communs. Sans cela, l’acte initial de destitution souligné par le Comité invisible aurait sans doute été incapable de produire de tels effets…
Sortir de l’économie ?
Si la question des institutions est une des raisons de l’hostilité du Comité invisible vis-à-vis des Communs, une autre est celle du rapport à l’économie. Là aussi, le point de vue exprimé dans Maintenant est radical, puisqu’il s’agit pour les auteurs ni plus, ni moins de sortir de l’économie :
L’économie n’est pas seulement ce dont nous devons sortir pour cesser d’être des crevards. C’est ce dont il faut sortir pour vivre, tout simplement, pour être présent au monde. Chaque chose, chaque être, chaque lieu est incommensurable en tant qu’il est là. On pourra mesurer une chose tant qu’on voudra, sous toutes ses coutures et dans toutes ses dimensions, son existence sensible échappe éternellement à toute mesure […]
Ce rejet radical de l’économie fait que le Comité invisible condamne avec mépris le mouvement de l’Économie Sociale et Solidaire (en faisant au passage à nouveau le lien avec les Communs) :
Il y a une foule de gens, de nos jours, qui tentent d’échapper au règne de l’économie. Ils deviennent boulangers plutôt que consultants. Ils se mettent au chômage dès qu’ils peuvent. Ils montent des coopératives, des SCOP, des SCIC. Ils s’essaient à « travailler autrement ». Mais l’économie est si bien faite qu’elle a désormais tout un secteur, celui de « l’économie sociale et solidaire », qui turbine grâce à l’énergie de ceux qui la fuient. Un secteur qui a droit à un Ministère particulier et qui pèse 10% du PIB français. On a disposé toutes sortes de filets, de discours, de structures juridiques, pour recueillir les fuyards. Ils s’adonnent le plus sincèrement du monde à ce qu’ils rêvent de faire, mais leur activité est recodée socialement, et ce codage finit par s’imposer à ce qu’ils font. On prend en charge collectivement la source de son hameau, et un jour on se retrouve à « gérer les communs ».
Pour le Comité invisible, l’ESS est typiquement une voie sans issue, si ce n’est même un remède pire que le mal, car à leurs yeux : « Il n’y a pas d’autre économie, il n’y a qu’un autre rapport à l’économie« .
On perçoit bien ici un autre point d’achoppement majeur avec la pensée des Communs. Car contrairement à une confusion souvent faite, les Communs ne visent à supprimer ni le marché, ni l’État, mais à trouver le moyen de les soumettre à une logique autre que celle du système néo-libéral. Ce n’est donc pas un hasard si Elinor Ostrom a obtenu le prix Nobel d’économie, car même si son point de vue est particulièrement hétérodoxe, son propos était bien d’ordre économique. Parmi les penseurs des Communs, on peut aussi citer Michel Bauwens qui, depuis des années, théorise la forme que pourrait prendre une « Economie des communs« , articulée avec ce qu’il appelle un « Etat-partenaire ». Cette évolution passe à ses yeux justement par un renforcement des liens avec l’Economie Sociale et Solidaire, à travers ce que Bauwens nomme le « Coopérativisme ouvert« .

Dans Maintenant, le Comité invisible appelle à déserter ou à saboter les structures économiques, mais certainement pas à les réinvestir d’un autre sens, comme se proposent de le faire l’ESS et le mouvement des Communs.
Or cet appel à la désertion de l’économie constitue à mes yeux un non-sens et c’est même à terme un mot d’ordre dangereux. Les Communs ont toujours été articulés – d’une manière ou d’une autre – avec le système économique et c’est précisément ce qui fait leur intérêt. Quand Elinor Ostrom étudie des communautés de pêcheurs qui se partagent une ressource halieutique (les pêcheries de homards du Maine), ce sont des acteurs qui vont vendre leurs prises sur le marché, mais qui conviennent entre eux de règles communes pour éviter la surpêche et préserver la ressource dans le temps. Quand elle étudie des systèmes d’irrigation en Californie (l’exemple des aquifères), ce sont là aussi des agriculteurs qui ont besoin de puiser cette eau pour arroser des cultures dont ils vont vendre ensuite le produit sur le marché, mais qui sont capables de mettre en place collectivement un système de gouvernance évitant l’assèchement des nappes. Ce que montrent les Communs, c’est donc que des acteurs économiques peuvent arriver à se comporter d’une manière autonome par rapport à la logique du marché (maximisation des profits), alors même qu’ils sont interfacés avec lui.
Cette question nous reconnecte avec les travaux d’un autre penseur important – l’historien Karl Polanyi – qui dans son livre majeur « La Grande Transformation » s’est intéressé au démantèlement des Communs et à l’avènement du capitalisme moderne. Il montre notamment très bien comment au tournant du 18ème au 19ème siècle, une rupture vers ce qu’il appelle « la société de marché » est survenue lorsque ce dernier est arrivé à devenir un système auto-régulé indépendant des autres dimensions de la société. Des systèmes économiques ont existé à toutes les périodes de l’histoire – y compris d’ailleurs sous la forme de marchés dès lors que les monnaies sont apparues – mais ceux-ci avaient la particularité d’être encastrés dans la société, qui parvenait à les contenir. L’existence sous l’Ancien Régime des Communs fonciers et des droits d’usage collectifs sur les terres agricoles était d’ailleurs une manifestation de cet encastrement de l’économie au sein du social, qui limitait en pratique la portée du droit de propriété. Et c’est précisément ce qui s’est inversé avec l’avènement du capitalisme au moment de la révolution industrielle : la société s’est alors retrouvée encastrée dans le marché et soumise à sa logique, lorsque la terre, le travail et la monnaie ont été érigés de force en marchandises.
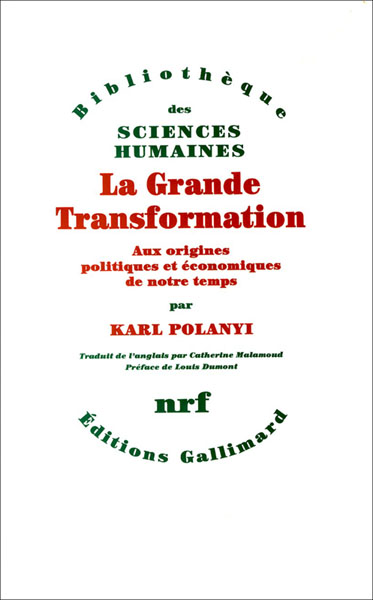
Cette notion « d’encastrement » est à mon sens essentielle et elle montre bien en quoi ce mot d’ordre d’une « sortie de l’économie » est fallacieux (on verra plus loin que le Comité invisible est d’ailleurs bien incapable de se l’appliquer à lui-même…). L’enjeu n’est pas de rompre radicalement avec l’économie, mais de faire en sorte de la soumettre à nouveau au contrôle de la société, et c’est précisément un des objectifs que poursuit – avec d’autres – le mouvement des Communs. Certes, nous sommes bien d’accord que ce n’est pas l’ESS à elle seule qui va abattre le capitalisme mondial, le système ayant depuis longtemps montré sa redoutable capacité à absorber et à retourner les alternatives qui essaient de prendre corps en son sein. Mais il n’en reste pas moins que l’ESS participe d’un mouvement de résistance qui permet d’éviter l’encastrement complet du social par l’économie de marché, sans lequel la situation serait infiniment plus préoccupante. Il faut lire d’ailleurs à ce sujet un auteur comme Jean-Louis Laville, et notamment sa dernière synthèse parue au Seuil sur l’Économie Sociale et Solidaire, dans laquelle il montre bien que, notamment dans sa composante « associationniste », le sens de l’économie solidaire a toujours été avant tout politique et qu’il a permis, partout dans le monde, à des populations extrêmement fragilisées – pauvres, femmes, minorités ethniques, etc. – de pouvoir revendiquer, conquérir et exercer des droits économiques et politiques.
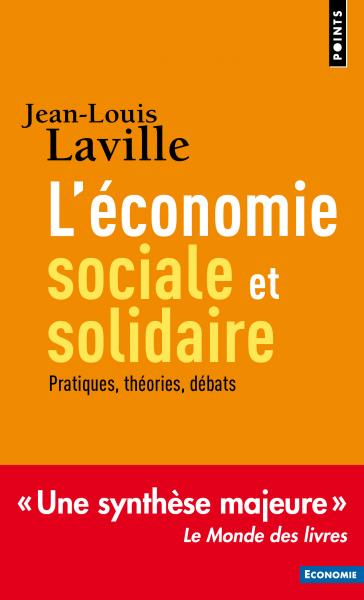
Je trouve extrêmement grave que le Comité Invisible se permette de balayer avec un tel mépris cet apport de l’ESS à la lutte sociale. L’ironie, c’est que sous couvert de radicalité, leur vision de l’économie me paraît en réalité constituer une forme intériorisée de l’idéologie néo-libérale : comme le marché a réussi peu à peu – on ne peut le nier – à encastrer quasi-intégralement la société dans sa logique, le Comité invisible ne voit pas d’autre solution que de déserter complètement le champ de l’économie, sans voir que ce processus est réversible. Leur propos tend à « essentialiser » l’économie de marché et à « dé-historiciser » sa construction, ce qui est exactement le dessein de l’idéologie libérale depuis Adam Smith, qui veut nous faire croire à la « naturalité » des lois du marché et du comportement de l’homo economicus. Dire que par définition, l’économie constitue un rapport au monde condamnable qu’il faudrait fuir n’est en définitive qu’une image renversée de cette construction idéologique libérale à laquelle ils se soumettent, et absolument pas une manière d’en « sortir ».
Contre cette vision, Karl Polanyi a d’ailleurs proposé une autre conception de l’économie, à mon sens infiniment plus féconde que la réduction manichéenne à laquelle se livre Comité invisible. Il oppose en effet à la conception « formelle » de l’économie (« l’économie en tant que logique de l’action rationnelle et de la prise de décision, comme un choix rationnel entre des usages distincts de ressources ou moyens limités« ) une conception « substantive » définie comme suit :
La seconde, le sens substantif, par opposition, ne présuppose ni la prise de décision rationnelle ni des conditions de rareté. Elle désigne simplement l’étude des choix humains qui leur permettent de vivre dans leur environnement social et naturel. Une stratégie de prospérité pour une société est vue comme une adaptation à son environnement et ses conditions matérielles, un processus qui peut impliquer ou non la maximisation de l’utilisation de ses ressources. Le sens substantif du terme « économie » est vu dans le sens plus large d’« économiser » ou d’« approvisionner ».
L’économie est simplement la façon par laquelle une société satisfait ses besoins matériels et immatériels (statut social, rites, croyances, etc.).
C’est cette « économie substantive » que visent à la fois les Communs et l’ESS, et la raison pour laquelle il importe de renforcer les synergies entre ces deux sphères (voir à ce sujet le dernier numéro de la RECMA).
Je prendrai pour finir cette partie un autre exemple, à nouveau tiré de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui m’a personnellement aidé à comprendre l’erreur de perspective du Comité invisible sur les questions économiques. Parmi les institutions remarquables mises en place par les ZADistes, il y a celle du « Non-Marché ». Il s’agit d’un rassemblement qui se tient chaque semaine où ceux qui produisent des denrées alimentaires sur la ZAD (pain, fruits et légumes, lait, fromages, etc.) viennent les proposer aux autres occupants avec un système de « prix libre », c’est-à-dire sans fixer de prix a priori, mais en laissant chacun donner ce qu’il veut/peut en échange, que ce soit sous forme monétaire ou non. Voilà ce qu’en disait un article publié au début de l’année sur Médiapart , qui montre le rôle important que ces échanges ont pour le fonctionnement de la ZAD :
Tous les vendredis, les produits de la ZAD sont mis à disposition des habitant-es et des riverain-es à prix libre – chacun laisse l’argent qu’il veut ou peut, ou rien du tout, pendant le non-marché. Les caisses de ce marché non marchand – le seul endroit de la ZAD où tout le monde est à l’heure, entend-on parfois – abondent « Sème ta Zad ». Cette structure collective, créée pour discuter de l’usage des terres reprises par le mouvement, sert à coordonner les projets agricoles.
L’argent récolté est destiné à la lutte collective, et non à la vie quotidienne des habitant-es. Environ 20 000 euros y rentrent et sortent chaque année, selon une personne qui s’en occupe. Ils financent les achats de farine, gasoil, foin, pièces de rechange du matériel. La ZAD vit grâce aux gros événements – caisses de soutien à prix libre, tracto-vélo, info Tour, bar lors des grands événements – ainsi qu’aux dons, qui affluent sur le compte de l’association Vivre sans aéroport.
Cette institution du « Non-Marché » porte particulièrement bien son nom. Ce n’est en effet pas une place de marché étant donné que les échanges n’y sont pas régulés par un système de prix fixés par la loi de l’offre et de la demande. Mais on voit bien qu’il ne s’agit ici en aucun cas de « sortir de l’économie », si tant est que l’on veut bien donner un sens « substantiviste » à cette notion. Le Non-Marché fonctionne en réalité comme une forme de coopérative, certes « sortie » de l’économie marchande, mais gardant un pied dans l’économie monétaire et en faisant une large place à ce que Karl Polanyi appelle « la réciprocité » (les logiques de dons et de contre-dons) pour réguler les échanges. C’est typiquement la subtilité de ces formes d’arrangements institutionnels qu’une pensée sommaire se donnant comme mot d’ordre de « sortir de l’économie » ne peut plus appréhender, sinon que par le mépris.
Comment « faire communauté » ?
Ces « tâches aveugles » dans l’analyse du Comité invisible, on les retrouve également dans leur manière de concevoir les phénomènes collectifs, et c’est à mon sens la plus grave faiblesse du livre. D’une certaine manière, les auteurs partagent sur ce point les ambiguïtés traditionnelles de l’anarchisme. La pensée libertaire est en effet longtemps restée tributaire d’une conception « associationniste » des groupes où les individus s’assemblent et se séparent par l’effet de leur libre volonté. Mais tous les travaux de la sociologie, au moins depuis Durkheim, montrent que les groupes humains ont une emprise sur leurs membres qui n’est pas réductible au simple jeu des volontés individuelles. On « appartient » à des groupes sous l’influence de forces qui nous dépassent et si l’individu peut se libérer de ses attaches pour en cultiver de nouvelles, ce n’est jamais aussi simple que la rupture consciente d’un contrat.
Sans doute à cause de ses influences « spinozistes », le Comité invisible ne s’inscrit pourtant pas dans cette veine « associationniste », qu’ils combattent au contraire résolument dans le livre. C’est ce qui leur fait mettre l’accent sur la question des « liens » et de « l’amitié », termes qui désignent sous leur plume ce pouvoir des groupes de faire entrer les individus dans des rapports non-réversibles à leur guise. Ils appellent cela « la vie« , assimilée à une nouvelle forme de « communisme » conçu comme « le fait vécu de la fraternité » en action. C’est cette attirance pour les communautés « réelles » qui leur fait rejeter avec virulence dans la dernière partie du livre (« Pour la suite du Monde« ) la tendance des militants à se constituer en collectifs :
Les collectifs en tout genre – de citoyens, d’habitants, de travail, de quartier, d’activistes, d’associations, d’artistes sont l’avenir du social. On adhère là aussi comme individu, sur une bas égalitaire, autour d’un intérêt, et on est libre de les quitter quand on veut. Si bien qu’ils partagent avec le social sa texture molle et ectoplasmique […] L’égalité et l’horizontalité postulées rendent au fond toute singularité affirmée scandaleuse ou insignifiante, et font d’une jalousie diffuse sa tonalité affective fondamentale […] Plus la société se désagrégera, plus grandira l’attraction des collectifs. Ils en figureront une fausse sortie. Cet attrape-nigaud fonctionne d’autant mieux que l’individu atomisé éprouve durement l’aberration et la misère de son existence.
Ce faisant, le Comité invisible se retrouve pourtant sur une corde raide, car s’ils rejettent le « libre associationnisme » des collectifs, nous avons vu qu’ils condamnent aussi radicalement les institutions, qui sont pourtant ce qui fait que les groupes humains « tiennent ensemble » et durent dans le temps. Du coup, le Comité invisible met en avant un exemple qui revient constamment dans l’ouvrage comme la forme à leurs yeux désirable de l’action collective : le cortège de tête des manifestations auquel ils identifient ce qu’ils appellent la communauté.
Il n’y a jamais la communauté comme entité, mais comme expérience. C’est celle de la continuité entre des êtres et avec le monde. Dans l’amour, dans l’amitié, nous faisons l’expérience de cette continuité […] Dans cette émeute où nous nous tenons ensemble au plan que nous nous sommes fixés, où les chants des camarades nous donnent du courage, où un street medic tire d’affaire un inconnu blessé à la tête, je fais l’expérience de cette continuité.
En réalité, quiconque a déjà participé à ces situations de danger éprouvé en commun sait bien que l’on y fait l’expérience d’un phénomène particulier : celui de la capacité d’un groupe à s’auto-affecter spontanément, en suscitant des solidarités extrêmement puissantes et de la coordination, sans avoir besoin de direction centralisée. En cela, le Comité invisible voit la possibilité de l’existence d’une verticalité – à l’opposé de l’horizontalité informe des collectifs- qui puisse émerger d’elle-même, sans besoin de recourir à des formes d’autorité liée à des institutions.
C’est à ce stade qu’il est intéressant de faire réintervenir dans cette discussion Frédéric Lordon, et notamment les développements de son livre Imperium. Structures et affects des corps politiques. Car cette capacité des groupes humains à s’auto-affecter est précisément ce que Spinoza appelle « imperium » dans son Traité politique : « Ce droit que définit la puissance de la multitude, on l’appelle généralement imperium« . Dans l’ouvrage, Lordon montre que c’est sous l’effet de cette « puissance de la multitude » que les groupes coagulent en des communautés dont la cohésion dépasse l’exercice de volontés librement associées. Il nomme cet effet « auto-transcendance du social » ou « transcendance immanente », laquelle donne aux groupes la dimension de la verticalité où s’exprime le pouvoir.
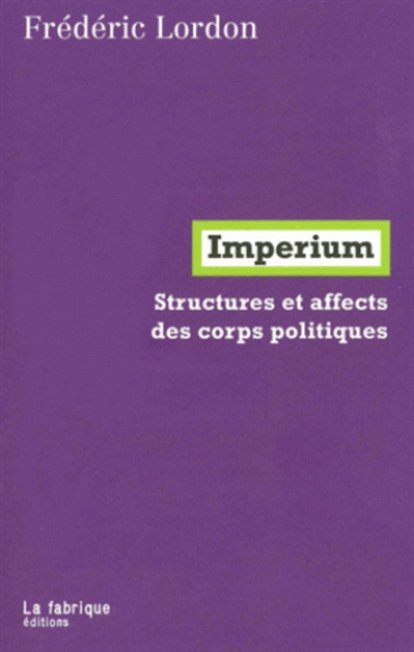
Ces effets peuvent être tout à fait passagers, comme ce qui se produit dans le cortège de tête d’une manifestation, sous l’effet du danger ressenti en commun et des nécessités tactiques de l’action. Mais Lordon explique aussi que c’est l’imperium qui est à l’origine de la naissance des institutions sociales, des plus simples comme les plus élaborées, jusqu’aux Etats qui en constituent aujourd’hui la forme la plus aboutie. Le pouvoir de la multitude de s’auto-affecter passe par la production de formes symboliques qui finissent par se stabiliser sous la forme d’institutions assurant la cohésion du groupe. Et c’est là que la pensée du Comité invisible me paraît extrêmement pauvre quant à son appréhension des phénomènes collectifs. Ce qu’ils portent aux nues avec les cortèges de tête des manifestations constitue en fait le niveau 0 de la dynamique produisant les institutions, qu’ils rejettent par ailleurs si fortement sans voir que ces phénomènes ont en réalité exactement la même nature. Ce que montre Frédéric Lordon dans son livre, c’est que ces mécaniques d’auto-transcendance sont absolument inévitables dès lors que les groupes humains deviennent assez importants pour les déclencher sous l’effet du nombre. Cela signifie donc qu’à moins de rester dans les petits collectifs réversibles (que le Comité invisible conspue…), tous les groupes devront immanquablement se confronter avec cette puissance de la multitude, qui est la matrice de toutes les institutions.
Or, typiquement, c’est aussi cette puissance de la multitude qui rassemble les communautés autour de la gestion des Communs. Ce n’est pas directement sous cet angle qu’Elinor Ostrom aborde la question, mais il est évident que ce qu’elle nomme « auto-organisation » (self-organization) renvoie à ce pouvoir des groupes de s’auto-affecter pour produire des institutions et elle accorde aussi dans ses écrits beaucoup d’importance à la question du passage à l’échelle (scaling) renvoyant à la taille des groupes. Lordon prévient cependant que les communautés qui font ce travail instituant sont particulièrement susceptibles d’être affectées par des phénomènes de capture. Celle-ci peut survenir de l’extérieur, notamment de la part de l’État, institution des institutions, qui a acquis une place tellement centrale dans la vie collective qu’il a la capacité de soumettre à sa propre logique hiérarchique la plupart des institutions indépendantes qui pourraient germer en son sein. Par ailleurs, les groupes risquent aussi de subir des phénomènes de « capture interne », par lesquels une partie des membres – voire un individu – arrivent à capter à leur profit cette puissance de la multitude et à « détourner » le pouvoir d’auto-organisation. Ce sont là des « pathologies » de la gouvernance des Communs que l’on connaît bien et qui signent souvent l’arrêt de mort de l’esprit communautaire des projets.
Et ceci nous permet de reboucler avec la partie de ce billet consacrée aux institutions. Si l’on suit Dardot et Laval, l’enjeu des Communs consiste à mettre en oeuvre une « réinstitution de la société par elle-même ». Il s’agit donc de regarder en face la nature institutionnelle de ces phénomènes (ce que refuse de faire le Comité invisible), tout en étant – avec Lordon – extrêmement conscient des risques de capture qui peuvent toujours survenir et compromettre cette dynamique. C’est à mon sens au prix de cette lucidité que l’on pourra espérer enclencher un véritable processus révolutionnaire, et certainement pas en se cachant la tête dans le sable comme le fait le Comité invisible, en attendant qu’advienne une mystérieuse « situation » qui aurait magiquement la vertu de propager à toute la société les phénomènes passagers d’auto-coordination qui se produisent dans les cortèges de tête des manif’ !
C’est là justement tout l’intérêt des Communs, à condition qu’ils se conçoivent comme des « laboratoires de pratique institutionnelle », ce que ne peut que condamner le Comité invisible sur la base de leurs préjugés théoriques.
Ce qu’ils disent et ce qu’ils font…
J’en termine par ce qui m’a, en vérité, décidé à écrire ce billet : une profonde impression d’imposture intellectuelle qui se manifeste quand on compare ce que prône le Comité invisible et la manière dont ils agissent en pratique. Depuis Marshall McLuhan, on sait effet qu’il faut accorder autant d’importance au medium qu’au message. Or comment le Comité invisible s’y prend-t-il pour délivrer son message appelant à la « sortie de l’économie » ? Réponse : en vendant 9 euros un livre dont le contenu n’est pas accessible en ligne, mis à part quelques extraits, et qui reste sous « copyright : tous droits réservés », interdisant en théorie toute forme de partage en s’abritant derrière l’institution du droit d’auteur…
Vendre un livre appelant à « sortir de l’économie » est à vrai dire à peu près aussi dénué de sens que si des antispécistes diffusaient un message animaliste par le biais d’ouvrages reliés en vélin pleine peau… On me rétorquera peut-être que La Fabrique n’est pas un éditeur comme les autres ; que vendre le livre sous format papier était le meilleur moyen de toucher le grand public ; que 9 euros n’est pas un prix très élevé ; que le Comité invisible a publié de larges passages du bouquin en accès libre sur le site de Lundi Matin ; que le premier livre du comité invisible (L’insurrection qui vient) a été mis en ligne en accès gratuit par la Fabrique, etc. A tous ces arguments, je répondrai : certes, mais tout ceci ne constitue somme toute encore que des compromis avec l’économie, alors que la posture du Comité invisible consiste à discréditer systématiquement tous ceux qui assument un tel compromis, comme c’est le cas pour les Communs et l’ESS. Tenir ce genre de propos est à vrai dire périlleux, car c’est s’interdire toute forme de compromis, sous peine de tomber immédiatement dans une forme de contradiction performative décrédibilisant complètement le message.
Sachant par ailleurs que le compromis peut prendre chez le Comité invisible des formes absolument ridicules… Sur la photo ci-dessous prise à la FNAC des Halles, on peut voir Maintenant au rayon « Nouveautés », trônant à côté du controversé ouvrage Décadence de Michel Onfray… C’est en m’arrêtant sidéré devant cet improbable télescopage, dictée par la plus pure des logiques mercantiles, que je me suis juré d’écrire ce billet !

Le pire, c’est qu’il aurait été fort simple pour le Comité invisible et son éditeur de « sortir de l’économie » : il aurait suffi pour cela de publier le texte en ligne sous licence libre. Les licences libres sont typiquement des outils qui permettent de « démarchandiser » des ressources numériques, comme le sont par exemple Linux ou Wikipédia, tout en laissant ouverte la possibilité de vendre les supports matériels que sont les livres papier. Avec la notoriété acquise avec le temps par le Comité invisible, il est évident que ce troisième ouvrage, très attendu après les remous de l’année 2016, se serait de toutes façons fort bien vendu, même s’il avait été en accès gratuit par ailleurs. Les auteurs auraient certes encore été dans le compromis avec l’économie, mais pas au prix d’une perte totale de cohérence, comme c’est le cas aujourd’hui.
Car il faut bien arriver à cette conclusion : le Comité invisible n’a pas été capable de s’appliquer à lui-même les principes qu’il prône dans son propre livre. Ce qui peut signifier deux choses : 1) soit ce qu’ils proposent est impossible à réaliser ; 2) soit ils se fichent profondément de nous. Et la seconde hypothèse est hélas sérieusement à envisager, car voici ce que l’on peut lire à la page 104 du livre dans la partie consacrée justement à la question de la « sortie de l’économie » :
Faire payer les connards est de bonne guerre. Qui aime ne compte pas. Là où l’argent vaut quelque chose, la parole ne vaut rien. Là où la parole vaut, l’argent ne vaut rien. Sortir de l’économie, c’est donc être à même de distinguer nettement entre les partages possibles, déployer depuis là où l’on est tout un art des distances.
Hum… Le lecteur qui aura déboursé 9 euros pour pouvoir lire ces lignes pourra donc en déduire qu’il est considéré comme un connard et que l’argent a encore aux yeux des auteurs suffisamment d’importance pour que leur parole ne vaille rien… La vérité, c’est que pour être cohérent avec son propos, il aurait fallu que le Comité invisible commence par faire de son livre un Commun, mais c’était difficile en partant des préjugés qui sont les leurs.
Le pire, c’est que l’ouvrage contient aussi une pseudo-justification qui expliquerait le choix de ne pas faire paraître le livre en version numérique. En plus des institutions et de l’économie, il faut en effet savoir que le Comité invisible condamne aussi radicalement les écrans, qu’il accuse d’engluer la population en l’empêchant de saisir l’instant présent :
Toutes les raisons sont réunies [de faire une révolution], mais ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Et les corps sont devant les écrans.
Que dire là encore, sinon que comme pour l’économie, cela revient à essentialiser le numérique comme intrinsèquement malfaisant et à l’abandonner tout entier à l’ennemi, alors qu’il s’agit à l’évidence aujourd’hui d’un des terrains majeurs de la lutte à conduire ? Sur cette question, on préférera lire Alain Damasio, qui sur le site Lundi Matin appelle au contraire à réinvestir le numérique comme objet de résistance, en faisant parfaitement le lien avec le logiciel libre et les Communs :
[…] liberté d’éducation, de production, de travailler ou non, liberté des savoirs, propriétés ouvertes et annulées, existences connectées et déconnectées, justice autogérée, Communs partout […]
L’émancipation partira de la terre et de la chair, mais elle sortira aussi du numérique. Et elle impliquera de se réapproprier toute cette chaîne logistique digitale aujourd’hui intégralement privatisée et aliénée : aussi bien les câbles et la fibre que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les routeurs, tout autant que les centres de données (datacenters) qui sont les ultramodernes forteresses de nos solitudes connectées.
Et en aval des « fournisseurs d’accès » (tout un poème), penser la totalité de nos pratiques en matériel libre, comme en logiciel libre : ordinateur et téléphone libre, électronique libre, caméra libre, baladeur, console, imprimante 3D libre. Tout un écosystème technique qu’on puisse se fabriquer, se bricoler, se partager, mettre en commun et qui échappe à l’empire du traçage gafesque.
L’enjeu des serveurs est particulièrement fort, tout comme la possibilité d’imaginer des centres de données autonomes, des zadacenters autogérés, nichés dans nos ZAD, et alimentés en énergie renouvelable. Cela pourrait déboucher non plus sur un darknet, mais un rednet ou un greenet — lieu d’expression et d’échange indépendant des monstres siliconnés.
Voilà un terreau fertile pour la convergence des luttes, ce mot d’ordre qui fut si important pendant Nuit Debout, et qui est exactement à l’opposé de ce que veulent nos étranges « amis » du Comité invisible…
***
Je terminerai ce billet avec une phrase de Maintenant que je trouve assez croustillante au vu de tout ce qui précède :
Nous n’avons pas de programme, de solutions à vendre. Destituer, en latin, c’est aussi décevoir. Toutes les attentes sont à décevoir.
Certes, le Comité invisible propose peu de solutions concrètes, mais il a quand même… un livre à vendre ! Et comme j’ai essayé de le montrer, le lecteur exigeant trouvera effectivement bien des motifs de déception au fil de la lecture.
Pour le reste, lisez Elinor Ostrom ; lisez Michel Bauwens ; lisez Dardot et Laval ; lisez Karl Polanyi ; lisez Jean-Louis Laville ; lisez Frédéric Lordon ; lisez Spinoza.
Lisez-les comme il vous plaît, en papier ou devant des écrans.
Scannez les bouquins et partagez avec le monde entier les fichiers.
Investissez-vous de toutes vos forces dans les Communs et dans l’ESS.
Et faites attention aux zozos qui prétendraient vous en dissuader, au prix de 9 euros TTC et d’une mortelle contradiction…
Classé dans:
A propos des biens communs Tagged:
économie,
Comité invisible,
communautés,
communs,
Elinor Ostrom,
institution,
Karl Polanyi,
Maintenant,
Notre-Dame-Des Landes,
ZAD