I Have A Dream : une loi pour le domaine public en France !
samedi 27 octobre 2012 à 13:28Cela plusieurs fois que j’évoque le sujet dans S.I.Lex ces derniers temps, mais voici une première tentative pour déterminer ce que pourrait être une loi pour le domaine public en France.
L’idée d’un tel texte m’est venue lorsque j’ai appris que le Ministère de la Culture projetait de faire voter une loi sur le Patrimoine en 2013. Il m’a semblé qu’il était indispensable de saisir cette occasion pour militer pour l’adoption d’une loi qui porterait à la fois sur le Patrimoine Et sur le Domaine public.
Un tel projet vise deux objectifs complémentaires : l’un défensif et l’autre offensif.
Défensif, car il est urgent de protéger le domaine public à l’heure du numérique. Il a connu une lente érosion au fil du XXème siècle, du fait de l’allongement continuel de la durée des droits et de la mise en place des droits voisins. Mais avec la numérisation, il est également menacé par de nombreux stratagèmes mis en place pour faire renaître des couches de droits divers et variés (copyfraud). Alors que la numérisation devrait être l’occasion de diffuser largement le domaine public, en accord avec sa nature, les institutions culturelles (bibliothèques, musées, archives) qui assurent la numérisation portent dans leur immense majorité atteinte à son intégrité. La mise en place de partenariats public-privé pour la numérisation du Patrimoine est aussi une source grave d’atteintes potentielles, à cause des exclusivités consenties par les établissements publics aux firmes privées.
Pour ces raisons, si l’on veut que le domaine public ait encore un sens au XXIème siècle, il est essentiel de le consacrer et de le protéger par la loi. On ne peut plus laisser une question aussi essentielle relever du ressort des seuls établissements culturels et des collectivités dont ils dépendent, qui sont souvent mal armés pour aborder la question et engagés dans des logiques de dégagement de ressources propres qui peuvent les pousser à marchandiser le domaine public. Le domaine public doit être le même pour tous les citoyens en France, car derrière cette notion, c’est la liberté fondamentale d’accès à la Culture et le droit de créer à partir des oeuvres du passé qui sont en jeu.
L’autre objectif d’une telle loi serait de reprendre l’initiative et de passer à l’offensive sur de nouvelles bases en matière de réforme du droit d’auteur. Pour l’instant, c’est à partir de la question du piratage/partage des oeuvres en ligne que cette réforme est le plus souvent abordée, dans le climat de tension que l’on connaît. Des propositions structurées sont pourtant sur la table, autour de la reconnaissance du partage non-marchand, mais il est possible d’ouvrir un second front au sujet du domaine public, qui remplira un rôle complémentaire.
Il est bien entendu cependant que cette proposition vise le Parlement français et non le niveau européen. Cela a pour conséquence que l’on ne peut agir sur l’un des aspects essentiels qui concerne la réduction de la durée du droit d’auteur et des droits voisins. Une telle réforme, primordiale pour le domaine public, ne peut être mise en oeuvre que par les institutions européennes, car ce sont des directives qui fixent la durée des droits. Vous verrez cependant que cela n’empêche pas d’agir sur ce chapitre dans la loi française, mais seulement à la marge.
Les propositions qui suivent sont inspirées de plusieurs sources : le Manifeste pour le domaine public de Communia (texte essentiel), les Éléments pour la réforme du droit d’auteur de la Quadrature du Net, le rapport Open Glam pour l’ouverture des données et des contenus culturels ou le rapport du Comité des Sages européens sur les partenariats public-privé. On trouvera également des suggestions intéressantes dans le rapport récemment publié par la Fondation Terra Nova, qui consacre toute une partie à la question du domaine public à l’heure du numérique.
Je propose ici une liste d’une vingtaine de points de réforme législative. Il s’agit d’un premier essai et certains nécessitent encore d’être affinés, mais je voulais donner une vue d’ensemble du projet. Le projet est articulé autour de sept objectifs différents :
I) Consacrer explicitement la notion de domaine public dans le Code de Propriété Intellectuelle français
- 1. Préciser la définition de l’œuvre de l’esprit en consacrant dans la loi les critères d’originalité et de mise en forme
- 2. Inscrire explicitement la notion de domaine public à l’article relatif à la durée des droits.
II) Simplifier le régime du domaine public et unifier la durée des droits
- 3. Supprimer les prorogations pour années de guerre
- 4. Supprimer la prorogation de 30 ans bénéficiant aux auteurs « Morts pour la France »
- 5. Supprimer le régime particulier des oeuvres posthumes
- 6. Simplifier l’application internationale du droit d’auteur
III) Limiter le champ d’application du droit d’auteur
- 7. Supprimer la protection spécifique des titres d’oeuvres
- 8. Introduire en droit français la distinction oeuvres utiles/oeuvres artistiques
- 9. Limiter le droit moral à la vie de l’auteur
- 10. Préserver le domaine public incorporé dans des oeuvres composites
- 11. Garder le domaine public réutilisable en cas de simples rééditions d’oeuvres
- 12. Instaurer un « test en trois étapes à l’envers » pour prévenir les atteintes futures au domaine public
4) Empêcher les atteintes à l’intégrité du domaine public
- 13. Les reproduction fidèles d’oeuvres en deux dimensions appartenant au domaine public doivent aussi être dans le domaine public
- 14. Empêcher la neutralisation du domaine public par le droit des bases de données
- 15. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative aux informations publiques
- 16. Empêcher les interférences entre le domaine public au sens de la propriété intellectuelle et le domaine public au sens de la domanialité publique
- 17. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des clauses contractuelles
- 18. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des DRM
- 19. Empêcher que les reproductions d’oeuvres du domaine public soient interdites dans les emprises des institutions culturelles
5) Encadrer strictement les partenariats public-privé de numérisation
- 20. Limiter les exclusivités concédées aux partenaires privés et introduire les préconisations comité des sages européens dans la loi du 17 juillet 1978
6) Élargir le domaine public par le versement d’oeuvres récentes
- 21. Faciliter le versement volontaire au domaine public des oeuvres par leurs auteurs
- 22. Faire entrer dans le domaine public les oeuvres produites par des agents publics dans l’exercice de leur mission de service public
7) Créer des mécanismes pour rendre effectif le domaine public
- 23. Instaurer des sanctions en cas d’atteinte à l’intégrité du domaine public
- 24. Donner compétence à la CADA pour rendre des avis sur la réutilisation des oeuvres du domaine public
- 25. Créer un Registre national du domaine public
- 26. Faire en sorte que les métadonnées correspondants à des oeuvres du domaine public soient elles-aussi automatiquement dans le domaine public
Je terminerais par des questions sur la portée d’un tel projet de loi, car le domaine public peut être conçu d’une manière plus ou moins extensive.
Tous ces points sont soumis à la discussion. Je n’ai bien entendu pas réponse à tout et je lance un appel à l’intelligence collective pour aboutir à la meilleure mise en forme juridique. N’hésitez pas à laisser des commentaires sous le billet pour critiquer certains points ou proposer des éléments supplémentaires.
J’ai un rêve ! Que la France, pays de Beaumarchais et du droit d’auteur, devienne aussi le premier à adopter une loi pour le domaine public !
***
I Consacrer explicitement la notion de domaine public dans le Code de Propriété Intellectuelle français
L’expression même de « domaine public » ne figure dans aucun texte de loi. Il s’agit en réalité d’une simple construction doctrinale que les juristes ont dégagé au fil du temps. Le domaine public ne dispose en l’état actuel que d’une définition négative, tirée du fait que les droits patrimoniaux sont limités dans le temps. Cette absence de définition expresse est une source de fragilité pour le domaine public et l’idée ici est de lui donner une définition positive pour le renforcer, en agissant sur différents articles.
1° Préciser la définition de l’oeuvre de l’esprit en consacrant dans la loi les critères d’originalité et de mise en forme
Le domaine public n’est pas seulement constitué des œuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux sont arrivés à expiration. Y figurent également les créations qui n’accèdent jamais à la protection, faute de rentrer dans la catégorie des œuvres de l’esprit, telles que définies à l’article L.111-1 du Code. Les juges considèrent que les créations doivent remplir deux critères pour constituer des œuvres de l’esprit : être originales et bénéficier d’une mise en forme.
Pour consacrer explicitement la notion de domaine public, on peut agir sur l’article 111-1 en précisant explicitement les deux critères sus-mentionnés et en indiquant que les créations qui ne les remplissent pas appartiennent au domaine public.
Article L. 111-1 :
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Modifications proposées :
Constitue une œuvre de l’esprit, la création originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d’une mise en forme.
Une création ne satisfaisant pas à l’un de ces critères appartient au domaine public.
Il est important de consacrer explicitement le critère de l’originalité, car certains titulaires de droits comme les photographes demandent en ce moment sa suppression. Cela aurait pour effet que toutes les créations, même les plus banales, seraient protégées par le droit d’auteur et le domaine public se verrait diminué d’autant.
2° Inscrire explicitement la notion de domaine public à l’article relatif à la durée des droits.
Article L123-1
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Modifications proposées :
Au terme de ce délai, l’oeuvre appartient au domaine public.
Simple, mais le dicton a raison, cela va toujours mieux en le disant ! Vous verrez par la suite que l’on a besoin que le domaine public soit mentionné dans le Code pour que la notion puisse produire des effets plus précis ailleurs.
II Simplifier le régime du domaine public et unifier la durée des droits
Un des problèmes qui affectent le domaine public et nuit à l’effectivité de la notion réside dans la difficulté à calculer la durée des droits. La loi française est en effet remplie d’exceptions au principe « vie de l’auteur plus 70 ans ». Il pourrait être simple d’agir à ce niveau pour supprimer ces complications et unifier le mode de calcul de la durée des droits au maximum.
3° Supprimer les prorogations pour années de guerre
Article L123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l’année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Article L123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l’article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Ces prorogations compliquent énormément le calcul de la durée des droits. Elles ont déjà été passablement neutralisées par la Cour de Cassation, mais elles subsistent dans le domaine de la musique. La proposition consiste ici simplement à supprimer ces deux articles.
4° Suppression de la prorogation de 30 ans bénéficiant aux auteurs « Morts pour la France »
Article L123-10
Les droits mentionnés à l’article précédent sont prorogés, en outre, d’une durée de trente ans lorsque l’auteur, le compositeur ou l’artiste est mort pour la France, ainsi qu’il résulte de l’acte de décès.
Au cas où l’acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans
Là-aussi, ce bonus de 30 ans accordé aux auteurs « Morts pour la France » – unique en Europe – complique énormément le calcul de la durée des droits (on va d’ailleurs cruellement s’en rendre compte lorsqu’il s’agira de célébrer le centenaire de 14-18). Pour unifier le régime du domaine public, cet article est à supprimer.
5° Supprimer le régime particulier des oeuvres posthumes
Article L123-4
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l’article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l’expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication.
Le droit d’exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Pour les oeuvres posthumes, non divulguées du vivant de l’auteur, la loi accorde un droit spécial de 25 ans, bénéficiant aux propriétaires du support physique en cas de publication, même lorsque l’oeuvre est dans le domaine public.
Ce régime est aberrant. Il conduit à des situations pathologiques, comme ce fut le cas avec Les Boréades de Rameau ou plus récemment avec des manuscrits inédits de James Joyce. Cette exception provoque également des effets choquants : c’est sur cette base par exemple que le département de la Dordogne revendique un copyright sur les peintures des grottes de Lascaux, au motif qu’il s’agirait d’oeuvres posthumes (!!!).
La justification de ce régime des oeuvres posthumes (inciter les propriétaires à publier les oeuvres) est insuffisante au regard de l’atteinte à l’intégrité du domaine public. Le bénéfice des droits durant 25 ans aux propriétaires en cas de publication après l’expiration des droits est à supprimer (enlever le dernier paragraphe).
6° Simplifier l’application internationale du droit d’auteur
La durée des droits varient selon les pays. En cas de mise en ligne, à quelle loi dont-on se référer ? La question s’était posée lorsque l’éditeur Gallimard avait demandé à Wikisource le retrait de textes qui avaient été mis en ligne sur la plateforme à partir du Canada.
A l’heure du numérique, où le domaine public a vocation à être numérisé pour être publié sur Internet, il est important de clarifier ces questions d’application internationale du droit d’auteur.
Pour résoudre ce problème, le manifeste de Communia propre la règle suivante :
Quand des œuvres tombent dans le domaine public structurel dans leur pays d’origine, ces œuvres doivent être considérées comme appartenant au domaine public structurel dans tous les autres pays du Monde. Quand dans un pays, une entité n’est pas soumise au droit d’auteur parce qu’elle tombe sous le coup d’une exclusion spécifique, soit parce qu’elle ne satisfait pas l’exigence d’originalité, soit parce que le terme de protection a expiré, il ne doit pas être possible pour qui que ce soit (l’auteur compris) d’invoquer le droit d’auteur dans un autre pays pour retirer cette œuvre du domaine public structurel.
A voir comment la traduire en droit et où l’insérer dans le Code (suggestions bienvenues en commentaires).
III Limiter le champ d’application du droit d’auteur
Le droit d’auteur, dans ses composantes patrimoniales et morales, s’applique très largement en France, alors que d’autres pays montrent l’exemple d’un champ d’application plus restreint. On peut s’inspirer de ces propositions pour élargir la sphère du domaine public et le rendre plus effectif.
7° Supprimer la protection spécifique des titres d’oeuvres
Article L112-4
Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Aux Etats-Unis, les titres des oeuvres sont exclus de la protection du droit d’auteur et appartiennent donc au domaine public. Cela ne signifie pas qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune protection, mais les titulaires doivent pour cela recourir au droit des marques.
Eu égard à la nature informative des titres, il paraît plus logique de supprimer cette protection accordée au titre du droit d’auteur.
8° Introduire en droit français la distinction oeuvres utiles/oeuvres artistiques
Aux Etats-Unis encore, les articles utiles (useful articles) ne peuvent être protégés par le droit d’auteur :
A “useful article” is an object that has an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. Examples are clothing; automobile bodies; furniture; machinery, including household appliances; dinnerware; and lighting fixtures. An article that is part of a useful article, such as an ornamental wheel cover on a vehicle, can itself be a useful article.
Un même système existe en Angleterre pour les objets tridimensionnels, qui ne peuvent être protégées par le droit d’autreur que s’ils constituent des « oeuvres d’artisanat d’art » (works of artistic craftmanship) (voir la fameuse affaire des casques de Stormtrooper).
Cette distinction entre les articles utiles et les oeuvres fait que des domaines ne sont en principe pas protégeables par le droit d’auteur (les costumes, les articles de mode, etc). Cette conception de la protection, qui recentre le droit d’auteur sur les oeuvres de l’esprit au sens propre, élargirait le domaine public et empêcherait l’application du droit d’auteur dans une sphère pour laquelle il n’a manifestement pas été conçue (des juges ont par exemple déjà considéré qu’une notice d’aspirateur était une oeuvre de l’esprit !).
Cette réforme reprendrait aussi les idées de Richard Stallman, qui demande depuis longtemps de distinguer selon les différentes catégories d’oeuvres et que les « oeuvres utilitaires » reçoivent un traitement différent.
Pour introduire ce genre de raisonnement en droit français, il faut agir sur l’article L.112-1 qui consacre au contraire la théorie dite de « l’unité de l’art » :
Article L112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il faudrait ici supprimer « ou la destination » « et indiquer que les « oeuvres utiles » sont exclues du champ de la protection.
A voir cependant comment introduire exactement cette distinction et éviter que son application en justice ne soit trop aléatoire (commentaires bienvenus ici si vous avez des idées sur ce point).
9° Limiter le droit moral à la durée de la vie de l’auteur
En France, le droit moral est dit perpétuel et il dure par-delà de la mort de l’auteur, même une fois que l’oeuvre est entrée dans le domaine public. Après la disparition de l’auteur, ce sont ses ayants droit qui exercent le droit moral à la place de l’auteur réel.
Même si l’on peut comprendre la philosophie qui est derrière ce mécanisme, on a écrit des livres entiers sur les abus auxquels peuvent se livrer les ayants droit dans l’exercice du droit moral de leurs aïeuls.
Si le droit d’auteur est un droit lié à la personne de l’auteur,comme l’indique lui-même le Code, il serait bien plus logique, qu’à l’instar du droit à l’image par exemple, le droit moral soit limité à la vie de l’auteur et qu’il soit le seul à pouvoir l’exercer. Le régime du domaine public n’en serait que plus clair.
Ce système d’un droit moral limité à la vie de l’auteur est déjà appliqué par d’autres pays, en Allemagne par exemple ou au Canada.
Pour introduire cette conception en France, il faut agir sur l’article L. 121-1 :
Article L121-1
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Indiquer « Ce droit est attaché à sa personne et persiste pour la durée de sa vie ». Supprimer l’adjectif perpétuel et les deux dernières phrases.
10° Préserver le domaine public incorporé dans des oeuvres composites
Article L113-2
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Article L113-4
L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Il faut éviter, quand des oeuvres du domaine public sont incorporées dans de nouvelles oeuvres par des créateurs, qu’elles soient à nouveau soumises au droit d’auteur. Je parle ici bien d’oeuvres composites, intégrant des oeuvres du domaine public sans les modifier, et pas d’oeuvres dérivées qui les transforment.
Pour ce faire, on pourrait ajouter à l’article L.113-4 la phrase suivante :
« Lorsque l’oeuvre composite incorpore une ou des oeuvres appartenant au domaine public, elles ne peuvent être considérées comme la propriété de l’auteur l’ayant réalisée. «
(Suggestions bienvenues sur ce point pour améliorer la formulation)
11° Garder le domaine public réutilisable en cas de simples rééditions d’oeuvres
Lorsque des oeuvres du domaine public font l’objet de rééditions, il est fréquent que les mentions de copyright indiquent « Tous droits réservés » pour l’intégralité de l’ouvrage, bloquant toutes formes de réutilisation de l’oeuvre du domaine public « encapsulée » dans la réédition.
Sans nier qu’une réédition puisse apporter des éléments originaux protégeables (mise en page, maquette, polices de caractères, préface, notes, tables des matières, index, etc), il faut empêcher que les rééditions « neutralisent » complètement le domaine public et aboutissent à une réappropriation des oeuvres.
(Suggestions bienvenues ici aussi pour traduire ces idées en droit).
12° Instaurer un « test en trois étapes à l’envers » pour prévenir les atteintes futures au domaine public
Le domaine public est juridiquement fragile et il ne suffira pas de faire entrer sa définition dans le Code pour le protéger. Il peut être menacé par l’allongement de la durée des droits (mais c’est au niveau européen qu’il faut agir sur ce point). Il peut aussi subir des attaques d’une autre nature, lorsque de nouveaux objets reçoivent une protection. Nous risquons d’en avoir un triste exemple en France si la fameuse Lex Google est adoptée qui créerait un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse.
La prolifération de ces nouvelles couches de droit ne peut que nuire au domaine public et il faut au maximum encadrer la possibilité d’introduire de nouvelles restrictions.
Le manifeste du domaine public de Communia formule cette exigence de protection de cette façon, mais appliquée à la durée des droits :
Tout changement de l’étendue de la protection par le droit d’auteur (y compris toute définition de nouveaux objets protégeables ou toute expansion des droits exclusifs) doit prendre en compte ses effets sur le domaine public. Un changement de la durée de protection du droit d’auteur ne doit pas s’appliquer rétroactivement aux œuvres déjà protégées. Le droit d’auteur est une exception de durée limitée au statut de domaine public de notre culture et notre savoir partagés. Au 20ème siècle, l’étendue du droit d’auteur a été significativement étendue, pour satisfaire les intérêts d’un petit groupe de détenteurs de droits et au détriment du public dans son ensemble. De ce fait, la plus grande part de notre culture et notre savoir partagés s’est retrouvée soumise à des restrictions liées au droit d’auteur ou techniques. Nous devons faire en sorte que cette situation n’empire pas (au minimum) et s’améliore significativement dans le futur.
Il me semble que l’on pourrait introduire un mécanisme de protection dans la loi en introduisant une sorte de « test en trois étapes à l’envers », auquel serait soumis le législateur. Ce test limiterait la possibilité que la loi porte atteinte au domaine public, en allongeant les droits ou en accordant une protection à de nouveaux objets.
(Suggestions bienvenues pour donner corps à cette idée).
IV Empêcher les atteintes à l’intégrité du domaine public
C’est sans doute le point essentiel de ce projet, car il vise à empêcher les pratiques dites de copyfraud, qui consistent à revendiquer illégitimement des droits sur le domaine public pour se le réapproprier ou restreindre sa réutilisation. Ces nouvelles couches de droits utilisées pour recouvrir le domaine public peuvent avoir plusieurs natures : droit d’auteur (copyfraud proprement dit), mais aussi droit des bases de données, droit des informations publiques, domanialité publique, clauses contractuelles, etc.
Pour empêcher les atteintes à l’intégrité du domaine public, il va s’agir à chaque fois de « neutraliser » la possibilité d’utiliser des droits de nature différente pour imposer des restrictions à sa réutilisation.
13° Les reproduction fidèles d’oeuvres en deux dimensions appartenant au domaine public doivent aussi être dans le domaine public
Ce point renvoie aux pratiques des très nombreux musées, bibliothèques et services d’archives en France estimant qu’ils bénéficient d’un droit d’auteur sur les reproductions numériques d’oeuvres appartenant au domaine public qu’elles produisent et diffusent.
Normalement, un tel usage du droit d’auteur est sans valeur, car la reproduction numérique d’une oeuvre ne créée par une « nouvelle oeuvre », faute d’originalité.
Cela vaut pour une reproduction opérée automatiquement (scanner), mais des instituions culturelles, et notamment les musées, ont développé une « tactique » particulière plus difficile à contrer juridiquement : ils font effectuer les reproductions d’oeuvres par des photographes à qui ils reconnaissent un droit d’auteur et se le font céder pour pouvoir apposer un copyright « Tous droits réservés » sur les reproductions et en contrôler totalement l’usage. C’est ainsi par exemple que procède la RMN.
Le problème, c’est que les tribunaux en France sont partagés concernant ce type de pratiques. Certaines cours ont débouté des photographes qui revendiquaient des droits sur des clichés de tableaux, mais d’autres ont accepté leurs prétentions, y compris des cours d’appel.
Pour lever cette incertitude et empêcher que le droit d’auteur soit ainsi détourné pour verrouiller le domaine public, il faut indiquer explicitement dans le Code que les reproductions fidèles d’oeuvres en deux dimensions appartiennent au domaine public comme les oeuvres originales reproduites. Ce principe a déjà été consacré dans la jurisprudence aux Etats-Unis, à l’occasion de la décision Bridgeman Art library v. Corel Corp.
C’est aussi la position officielle de Wikimedia Commons, qui ne reconnaît pas la validité des copyrights apposés sur les reproductions d’oeuvres du domaine public :
les représentations fidèles des œuvres d’art du domaine public en deux dimensions sont dans le domaine public et les exigences contraires sont une attaque contre le concept même de domaine public
Pour consacrer ce principe en droit français, on peut imaginer introduire un nouvel alinéa à l’article L.111-1 qui donne la définition des oeuvres de l’esprit et dans lequel, j’avais imaginé inséré les termes « domaine public » (voir 1°). Cela donnerait :
Les reproductions fidèles d’oeuvres de l’esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent elles-aussi au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
Pourquoi limiter cette règle aux oeuvres en deux dimensions ? Parce que les photographies d’objets (statues, monuments, etc) offrent plus facilement prise à l’originalité, le photographe bénéficiant d’une plus grande latitude dans le choix de l’angle de prise de vue. Mais de telles photos doivent néanmoins être originales pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur.
14° Empêcher la neutralisation du domaine public par le droit des bases de données
Le droit des bases de données pose un réel problème au domaine public, car il permet de faire renaître une couche de droits sur les oeuvres numérisées figurant sur un site internet, dans une bibliothèque numérique ou dans une base de données.
Le droit dit sui generis reconnu aux producteurs de bases de données leur permet d’interdire des extractions substantielles du contenu ou des extractions non substantielles répétées visant à reconstituer le contenu de la base.
Dans la pratique, beaucoup d’établissements culturels utilisent le droit des bases de données de manière abusive, pour interdire purement et simplement toute utilisation des contenus numérisés qu’is diffusent, même quand il s’agit d’oeuvres du domaine public numérisées.
Pour que le droit des bases de données ne puisse être utilisé pour neutraliser le domaine public, on peut agir sur l’article L.342-1 :
Article L342-1
Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
Ajouter un alinéa précisant :
Lorsqu’une base de données contient des oeuvres appartenant au domaine public, le producteur de la base ne peut interdire, ni s’opposer à leur extraction et leur réutilisation.
15° Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative aux informations publiques
Plusieurs institutions culturelles considèrent qu’en numérisant des oeuvres du domaine public, elles produisent des données (des suites de 0 et de 1) relevant du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 sur les informations publiques.
Cette interprétation a un effet redoutable, car cette loi de 1978 , si elle n’autorise pas en principe les administrations à s’opposer à la réutilisation des informations, leur permet de la soumettre au paiement d’une redevance, notamment pour les usages commerciaux (exemple). On peut donc dire que la loi de 1978 constitue une sorte de « voie royale » pour mettre en place un système de domaine public payant. De plus, les institutions culturelles bénéficient d’un régime dérogatoire complexe, dit exception culturelle, qui leur donne une plus grande marge de manœuvre pour poser des restrictions à la réutilisation.
Il n’est pas certain que cette application détournée de la loi sur les informations publiques tienne la route juridiquement, mais il paraîtrait plus sûr de la modifier afin qu’elle ne puisse plus servir à faire renaître une couche de droits sur le domaine public.
Voici l’article qui définit ce que sont les informations publiques :
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus [...]
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Deux stratégies sont possible pour protéger le domaine public : on peut modifier la loi pour faire en sorte que les informations produites à l’occasion de la numérisation du domaine public soient exclues de la définition des informations publiques.
Pour ce faire, il faut ajouter un d) à cet article, rédigé comme suit :
d) ou correspondant à des œuvres appartenant au domaine public
L’autre option serait de considérer que les informations produites à l’occasion de la numérisation du domaine public sont bien des informations publiques au sens de la loi (cela n’a pas que des inconvénients comme on le verra plus loin), mais d’empêcher les institutions culturelles de poser des restrictions.
On peut pour ce faire agir sur l’article 11 de cette loi, celui qui énonce la fameuse « exception culturelle ».
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
Il s’agirait de lui ajouter un alinéa, rédigé comme suit :
Néanmoins, s’agissant des informations contenues dans des documents correspondant à des œuvres du domaine public, les établissements mentionnés ci-dessus ne peuvent empêcher leur réutilisation, ni la soumettre au respect de conditions, hormis celles énoncées à l’article 13 de cette loi.
NB : article 13 = données personnelles
16° Empêcher les interférences entre le domaine public au sens de la propriété intellectuelle et le domaine public au sens de la domanialité publique
Il existe en réalité deux domaines publics différents en droit : un relevant de la propriété intellectuelle et un autre relevant de la domanialité publique. En droit administratif, ce domaine public s’entend des biens appartenant à l’État, à des collectivités locales et à des établissements publics et affectés à un service public.
L’article L.2112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques indique que « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, les biens présentant un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Une liste figure ensuite qui inclut notamment dans cette catégorie les exemplaires du dépôt légal, les archives publiques, les archives privées entrées dans les collections publiques, les collections des musées, les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques.
Ces ensembles peuvent donc tout à fait correspondent à des oeuvres du domaine public, compris au sens de la propriété intellectuelle cette fois. Or une partie de la doctrine estime que la propriété que possèdent les personnes publiques sur les objets physiques se « transmet »‘ aux versions qu’elles produisent à l’occasion de la numérisation du patrimoine. Sur ce fondement, elles seraient en mesure d’en conditionner la réutilisation.
Cette théorie, qui n’a pas été confirmée par la jurisprudence, est contestée par d’autres spécialistes de ces questions. Mais certains établissement sont déjà tentés d’utiliser la domanialité publique pour contrôler l’usage du domaine public numérisé. Les mentions légales de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, indiquent ainsi :
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l’article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Pour éviter que ce type de revendications ne dérive vers une nouvelle couche de droits recréés sur le domaine public, il faut modifier le Code de Général de la Propriété des Personnes Publiques afin d’empêcher les interférences entre les « deux » domaine publics.
Je ne suis pas assez spécialiste de ces matières pour proposer pour l’instant une solution, mais j’en appelle à ce qui pourraient faire des suggestions en ce sens.
17° Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des clauses contractuelles
Les sites qui diffusent des documents du domaine public numérisés peuvent comporter des conditions, assimilables à des clauses contractuelles, qui vont engager les utilisateurs et fixer des restrictions à la réutilisation du domaine public.
On trouve des clauses de ce type chez certaines institutions culturelles, mais aussi chez des personnes privées. Par exemple, c’est sur la base de simples clauses contractuelles (des CGU) que Google Livres interdit les réutilisations commerciales des ouvrages qui figurent dans sa bibliothèque numérique.
Par ailleurs, des établissements comme les musées peuvent indiquer sur leurs tickets d’entrée des conditions particulières, comme l’interdiction de prendre des photographies, qui sont assimilables également à des clauses contractuelles liant les visiteurs.
Pour éviter ce type de restrictions, on peut ajouter un article dans le chapitre du Code consacré au droit patrimoniaux.
Il serait rédigé comme suit :
Article L.122-13
Lorsqu’une oeuvre appartient au domaine public, la reproduction et la représentation sont possibles sans restriction et toute clause contractuelle s’opposant à de tels actes est considérée comme nulle et nulle d’effet.
18° Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des DRM
Le principe n°5 du Manifeste pour le domaine public de Communia évoque la question des restrictions issues de clauses contractuelles que nous avons examinée ci-dessus et il la rapproche de celle des DRM qui pourraient être utilisés empêcher l’usage d’une oeuvre du domaine public :
Les contrats et les mesures techniques de protection qui restreignent l’accès et la réutilisation des œuvres du domaine public ne doivent pas être mis en œuvre juridiquement.
Pour donner corps à ce principe, on peut agir sur l’article L. 331-5 du Code qui définit ce que sont les Mesures Techniques de Protection :
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre [...] :
Il contient un alinéa fixant des limites aux effets des DRM :
Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’oeuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Ajouter une phrase rédigée comme suit :
Les mesures techniques ne peuvent en outre s’opposer au libre usage d’une oeuvre appartenant au domaine public.
19° Empêcher que les reproductions d’oeuvres du domaine public soient interdites dans les emprises des institutions culturelles
L’affaire du Musée d’Orsay a montré que des établissements culturels pouvaient abuser de leurs pouvoirs pour empêcher que des photographies d’oeuvres du domaine public soient prises (même sans flash) par les visiteurs d’un musée. La RMN de son côté, tout en autorisant la photographie dans ses expositions, fixe des conditions restrictives à la réutilisation des clichés.
Pour contrer ce type de restrictions, le plus efficace serait sans doute de modifier le Code du patrimoine pour y introduire une disposition inspirée de la liberté de panorama (même si les deux choses sont différentes, car la liberté de panorama est une exception au droit d’auteur, applicable seulement aux œuvres protégées). On pourrait imaginer ajouter par exemple un article L.141-5 dans les dispositions générales relatives aux collections des musées de France :
Lorsque les collections des musées de France correspondent à des oeuvres appartenant au domaine public, les musées ne peuvent en interdire la reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou la vidéo, sauf pour des motifs strictement limités aux nécessité de conservation des oeuvres, ni empêcher la diffusion et la réutilisation de copies, y compris à des fins commerciales.
Une telle disposition permettrait de continuer à interdire la photographie avec flash, mais pas d’édicter des restrictions générales, comme l’a fait le Musée d’Orsay. Des articles similaires pourraient également être ajoutés en ce qui concerne les collections des bibliothèques et des archives.
Pour interdire la photographie en son sein, le Musée d’Orsay utilise en fait des mesures d’ordre intérieur (dont le fondement réside dans le pouvoir de police administrative dont dispose les administrations), mais une telle disposition légale me paraît de nature à les neutraliser (commentaires bienvenus si vous n’êtes pas de cet avis ou si vous pensez qu’il existe une meilleure solution).
V Encadrer strictement les partenariats public-privé de numérisation
Le contrat signé par la Ville de Lyon avec Google pour la numérisation des ouvrages de la Bibliothèque municipale avait mis en lumière le problème des exclusivités accordés par des personnes publiques à des firmes privées, à propos de l’usage des oeuvres du domaine public. L’Autorité de la Concurrence s’était alarmée de ces pratiques en 2010, en estimant que les exclusivités commerciales accordées à Google étaient trop longues et de nature à renforcer sa position dominante.
Depuis, cette question a encore rebondi, avec la révélation que la Bibliothèque nationale de France s’apprêtait à conclure des partenariats public-privé de numérisation avec des firmes privés, qui auront pour effet, non seulement de leur accorder des exclusivités, mais d’empêcher la mise en ligne de documents du domaine public, au profit de la commercialisation de bases de données.
Parallèlement, un Comité des sages européens a émis une série de recommandations concernant les partenariats de numérisation du patrimoine, dans un esprit d’équilibre. Il recommande que les exclusivités accordées aux entreprises ne dépassent pas une durée de 7 ans et qu’elles n’empêchent pas les établissements culturels de donner accès en ligne librement aux oeuvres du domaine public (les exclusivités ne peuvent donc porter que sur l’usage commercial).
20° Limiter les exclusivités concédées aux partenaires privés et introduire les préconisations du comité des sages européens dans la loi du 17 juillet 1978
La loi du 17 juillet 1978 sur les informations publiques contient déjà à vrai dire des dispositions relatives aux exclusivités :
La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
Si l’on considère que la numérisation d’oeuvres du domaine public produit des informations publiques (et nous avons vu plus haut que c’était possible), on peut déduire de cet article 14 que les exclusivités accordées à des partenaires privés dans le cacdre de PPP sont déjà interdits (à moins d’affirmer que ce serait « nécessaire à l’exercice d’une mission de service public », ce qui me paraît en l’occurrence bien difficile !). Autrement dit, la BM de Lyon est déjà sans doute dans l’illégalité pour le contrat signé avec Google et la BnF s’apprête à refaire la même erreur de son côté.
Pour être certain toutefois qu’aucune exclusivité ne puisse venir entraver l’usage du domaine public, on peut reformuler l’article 14 de cette façon :
La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public. Aucune exclusivité ne peut être accordée pour la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents correspondants à des oeuvres du domaine public.
Cependant, le Comité des sages européens a estimé que des exclusivités commerciales pouvaient accordées pendant 7 ans, afin d’inciter des firmes privées de s’impliquer dans la numérisation du patrimoine, tout en leur permettant un amortissement minimum de leur investissement. On peut estimer qu’il s’agit d’un compromis raisonnable (mais commentaires bienvenus si vous pensez le contraire).
Pour traduire cette vision dans la loi du 17 juillet 1978, on peut reformuler l’article 14 comme suit :
La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
Les informations publiques contenues dans des documents correspondants à des oeuvres du domaine public peuvent cependant faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, pour une durée de sept années maximum, à condition que l’exclusivité porte uniquement sur la réutilisation à des fins commerciales des informations.
Un établissement qui accorde une telle exclusivité ne peut être empêché de mettre en ligne et de rendre réutilisables sans restriction les informations publiques contenues dans les documents correspondant à des oeuvre du domaine public ayant fait l’objet de l’exclusivité accordée.
VI Élargir le domaine public par le versement d’oeuvres récentes
Le Manifeste pour le Domaine Public de Communia estime que le domaine public en devrait pas se limiter aux oeuvres pour lesquelles les droits sont échus à l’issue de la période de protection, mais que l’on devrait permettre aux auteurs qui le souhaitent de verser par anticipation leurs oeuvres dans le domaine public :
Les œuvres volontairement partagées par les détenteurs de droits. Les créateurs peuvent lever les restrictions d’usage de leurs œuvres en les soumettant à des licences libres, en utilisant d’autres mécanismes qui permettent de les utiliser sans restriction ou encore en les assignant au domaine public. Pour les définitions des licences libres, on se référera à la définition des logiciels libres (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html), à la définition des œuvres culturelles libres (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html), ou à la définition des connaissances ouvertes (http://opendefinition.org/1.0/Francais).
[...] Le renoncement volontaire au droit d’auteur et le partage volontaire des œuvres protégées constituent des exercices légitimes des droits d’auteur exclusifs. De nombreux auteurs titulaires des droits d’auteur sur leurs œuvres ne souhaitent pas exercer ces droits en totalité ou souhaitent y renoncer totalement. Ces actions, dans la mesure où elles sont volontaires, constituent un exercice légitime des droits d’auteur exclusif et ne doivent pas être empêchées ou rendues difficiles par la loi, des dispositifs statutaires ou d’autres mécanismes, y compris le droit moral.
Le domaine public se trouverait ainsi « agrandi » par ces apports volontaires des créateurs. Par ailleurs, on pourrait imaginer que les oeuvres créées par les agents publics dans le cadre de leurs missions de service soient versées automatiquement dans le domaine public, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis pour les oeuvres produites par les agents fédéraux.
21° Faciliter le versement volontaire au domaine public des oeuvres par leurs auteurs
Il existe déjà des instruments comme Creative Commons Zéro par exemple, qui permettent à un auteur de renoncer complètement aux droits qu’il détient sur son oeuvre et de verser sa création par anticipation au domaine public.
Néanmoins, certains soutiennent que la CC0 ne serait pas valablement utilisable en droit français, dans la mesure où le droit moral de l’auteur est dit inaliénable (c’est-à-dire qu’on ne peut y renoncer valablement par contrat). La CC0 précise bien cependant que le renoncement aux droits doit s’entendre « dans les limites prévues par la loi« .
Il n’en reste pas moins que l’articulation entre un instrument comme la CC0 et le droit moral à la française comporte en l’état du droit une part d’incertitude. On pourrait imaginer modifier la loi pour permettre explicitement le versement volontaire d’une œuvre dans le domaine public.
L’article L.122-7-1 précise déjà :
L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues.
On pourrait ajouter une phrase formulée comme suit :
L’auteur peut également déclarer, par le biais d’une manifestation expresse de volonté, que son œuvre appartient au domaine public. Cette faculté s’exerce sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues.
Pour régler clairement les difficultés liées au droit moral, l’article L. 121-1 pourrait être modifié :
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Ajoutez :
Cependant, l’auteur peut déclarer, par une manifestation expresse de volonté, que son oeuvre appartient au domaine public. Dans ce cas, les droits mentionnés au présent article sont réputés éteints. Une telle déclaration effectuée par l’auteur est définitive.
On conserve ainsi le principe de l’inaliénabilité du droit moral pour protéger l’auteur dans ses rapports contractuels avec des tiers, mais on lui permet de déposer volontairement son oeuvre dans le domaine public, en renonçant à son droit moral de manière générale.
22° Faire entrer dans le domaine public les oeuvres produites par des agents publics dans l’exercice de leurs missions de service public
La loi prévoit actuellement un système complexe dans lequel les agents publics sont bien titulaires du droit d’auteur sur les oeuvres qu’ils créent dans l’exercice de leur mission de service public, mais dans le même temps, ils sont réputés en céder automatiquement les droits d’exploitation à l’administration et ne conserver qu’un droit moral limité au respect de leur nom.
Pour faire en sorte que les oeuvres créées par les agents publics soient automatiquement versées au domaine public, il est nécessaire de supprimer les articles L. 1313-1-1 , L.131-1-2 et L. 131-1-3 qui organisent ce système.
Il faut ensuite modifier l’article L. 111-1 :
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous [...]
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
Supprimer les deux dernières phrases et les remplacer par celle-ci :
Les oeuvres de l’esprit créées par agents de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France appartiennent dès leur divulgation au domaine public.
En l’état, le dernier paragraphe de la loi fait que les professeurs d’université et les chercheurs restent titulaires des droits sur leurs créations (cours, articles, etc). Il conviendra d’examiner si on leur applique cette même règle du versement automatique de leurs oeuvres au domaine public. Il serait sans doute préférable que la loi organise plutôt une obligation de versement des résultats de la recherche dans des archives ouvertes.
VII Créer des mécanismes pour rendre effectif le domaine public
Une institution juridique n’est effective que si des mécanismes sont mis en place pour la protéger et permettre aux individus d’exercer les droits qu’elles leur confèrent. Le droit d’auteur est ainsi doté d’une multitude de mécanismes qui en assure l’effectivité. Il n’en est pas de même pour le domaine public, d’où son évanescence juridique.
Il est cependant possible de remédier à ce problème par une série de réformes.
23° Instaurer des sanctions en cas d’atteinte à l’intégrité du domaine public
Le Manifeste pour le Domaine Public de Communia prévoit ceci :
Toute tentative infondée ou trompeuse de s’approprier des oeuvres du domaine public doit être punie légalement. De façon à préserver l’intégrité du domaine public et protéger ses usagers de prétentions infondées ou trompeuses, les tentatives d’appropriation exclusive des œuvres du domaine public doivent être déclarées illégales.
Il ne suffit pas en effet de modifier les lois pour empêcher les atteintes à l’intégrité du domaine public, comme le point IV s’est efforcé de le faire. Il faut aller plus loin et ouvrir des voies de droits aux individus pour poursuivre en justice ceux qui continueraient à se livrer à des pratiques de copyfraud.
L’atteinte au domaine public étant aussi grave que la contrefaçon, il paraît nécessaire d’instaurer des sanctions à la fois au civil et au pénal. Néanmoins, les sanctions pénales de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amendes prévues pour la contrefaçon sont bien trop élevées et de ce fait, rarement appliquées. Il convient d’instaurer des sanctions proportionnées, mais suffisamment dissuasives, pour les atteintes au domaine public.
Je ne suis pas pénaliste, mais il me semble qu’un an de prison et 100 00 euros d’amendes me paraîtrait raisonnable, sachant que les personnes publiques peuvent tout à fait voir leur responsabilité pénale engagée en France.
24° Donner compétence à la CADA pour rendre des avis sur la réutilisation des oeuvres du domaine public
Néanmoins, les recours en justice ne sont pas une panacée pour rendre des droits effectifs, car ils sont souvent coûteux et difficiles à exercer pour les individus. Le copyfraud est en général pratiqué par des administrations culturelles et on pourrait imaginer qu’avant d’en arriver au procès, les citoyens aient la faculté de se tourner vers des recours moins difficiles à mettre en oeuvre, à l’image de celui qui existe actuellement devant la CADA pour l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques.
Il faut pour cela modifier l’article 20 de la loi du 18 juillet 1978 :
La commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante [...]
Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.
Ajouter :
ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’un document correspondant à une oeuvre du domaine public.
25° Créer un Registre national du domaine public
L’un des problèmes majeurs qui affecte le domaine public et nuit à son effectivité est la difficulté à savoir si une oeuvre donnée appartient ou non au domaine public.
Il existe déjà des outils qui permettent de calculer automatiquement le statut juridique des droits sur une oeuvre. C’est le cas par exemple du Public Domain Calculator d’Europeana ou du projet Arrow en Europe. Mais ces instruments ne sont pas pleinement satisfaisants, notamment pour Arrow parce que la base n’est pas ouverte au public.
Pour améliorer la situation, une solution serait sans doute de créer un Registre national du domaine public. Un tel outil pourrait par exemple être confié à la Bibliothèque nationale de France, qui serait chargée de maintenir une base de données, permettant de déterminer aussi finement que possible si une oeuvre appartient au domaine public ou non.
Tous les ans au premier janvier, la BnF aurait pour tâche de publier la liste des nouveaux auteurs entrant dans le domaine public. Par ailleurs, les auteurs pourraient également se manifester auprès de ce Registre pour indiquer leur volonté de faire entrer leur oeuvre par anticipation dans le domaine public et en garder trace.
Évidemment, ce registre devrait être ouvert au public et mis à disposition gratuitement. Les données qui l’alimentent devraient être placées sous une licence ouverte afin d’en permettre la réutilisation la plus large, dans le cadre d’une politique d’Open Data.
La loi pourrait aussi imposer aux différentes sociétés de gestion collective en France de mettre à disposition leurs propres données pour alimenter le Registre du domaine public.
Pour certifier l’appartenance d’une oeuvre au domaine public, le Registre pourrait utiliser à des fins d’étiquetage, la Public Domain Mark, mise en place par Creative Commons précisément à cette fin.
26° Faire en sorte que les métadonnées correspondants à des oeuvres du domaine public soient elles-aussi automatiquement placées dans le domaine public
Comme indiquer plus haut, il est vital pour que le domaine public soit effectif que l’on sache si les oeuvres en font partie ou non. Pour améliorer les données permettant d’effectuer ces calculs complexes, la meilleure manière de procéder est de les rendre interopérables et de les ouvrir pour permettre leur réutilisation et leur enrichissement.
Pour ce faire, il conviendrait d’instaurer une règle afin que les métadonnées associées aux oeuvres du domaine public soient automatiquement elles-mêmes placées dans le domaine public.
On peut arriver à ce résultat en modifiant la loi du 17 juillet 1978 sur les informations publiques. A l’article 11, ajouter cette phrase :
Les informations publiques produites par les administrations mentionnées au a et au b du présent articles afin de décrire des oeuvres du domaine public appartiennent elles-mêmes au domaine public. Leur réutilisation ne peut être empêchée, ni soumise à condition, exceptées celles fixées à l’article 13 de cette loi.
Questions sur le périmètre de la réforme
Pour terminer, des questions se posent quant à la portée d’un tel projet de loi pour le domaine public.
Le Manifeste pour le Domaine public de Communia a en effet une conception extensive du domaine public et lui fait également englober les exceptions au droit d’auteur :
Les prérogatives des utilisateurs créées par les exceptions et limitations au droit d’auteur, le fair use et le fair dealing. Ces prérogatives sont une part intégrante du domaine public. Elles sont une condition de l’existence d’un accès suffisant à notre culture et notre savoir partagés, permettant aux institutions sociales essentielles de fonctionner et aux individus ayant des besoins spécifiques (par exemple handicapés) de participer à la vie sociale.
L’idée peut paraître de prime abord étrange, mais il s’agit de considérer que le domaine public n’est pas limité aux oeuvres pour lesquelles les droits sont échus (domaine public structurel), mais qu’il s’étend aux mécanismes permettant d’élargirl’usage des oeuvres, même lorsqu’elles sont protégées (domaine public fonctionnel).
Si l’on adhère à cette conception, on peut imaginer incorporer dans la loi pour le domaine public en France un projet de refonte des exceptions au droit d’auteur. Je ne m’y lancerai pas ici, car cela m’amènerait trop loin. Il convient cependant de se demander si une telle extension est tactiquement opportune.
***
Ces propositions sont soumises à la discussion et tous les commentaires sont bienvenus.
Classé dans:Domaine public, patrimoine commun

























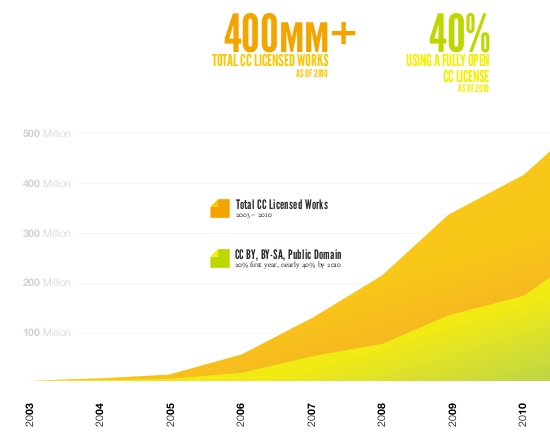





comments