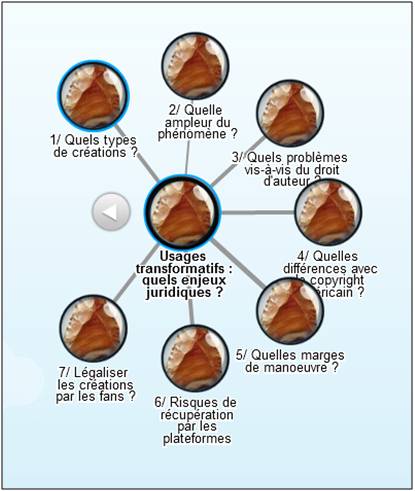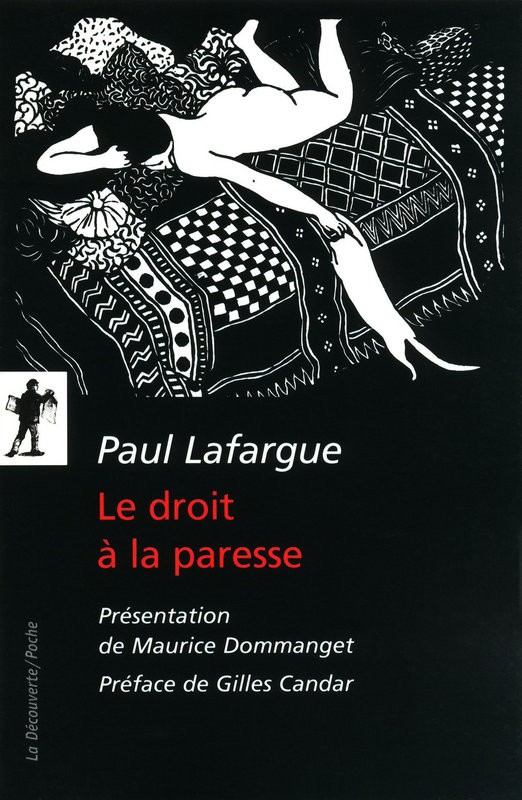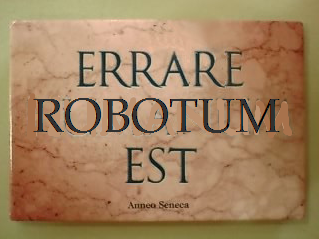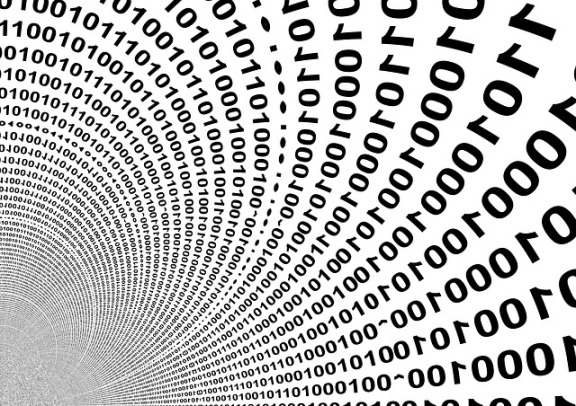Mettre en partage une marque : la Wikimedia Foundation montre que c’est possible
jeudi 13 février 2014 à 20:49Vous vous souvenez sans doute comment l’an dernier, le Parti Pirate français avait récolté un bad buzz mémorable en déposant une marque à l’INPI. J’avais à ce moment réagi en essayant de réfléchir à la manière dont on pourrait essayer de retourner la logique du droit des marques, pour pouvoir mettre des signes distinctifs en partage de manière contrôlée. Car à vrai dire, la question se pose pour les initiatives qui œuvrent dans le champ de la Culture libre : ouvertes au niveau des contenus par le biais des licences libres qu’elles utilisent ; elles peuvent éprouver le besoin de réguler l’usage de leur marque, mais faut-il pour cela en passer par l’application pure et dure de ce que prévoit le cadre classique de la propriété intellectuelle, au risque de tomber dans la contradiction ?

Le logo de Wikipédia est protégé par le droit des marques (Image par Mypouss. CC-BY. Source : Flickr)
Je m’étais alors demandé s’il n’était pas possible d’envisager la création "d’Open Trademarks" : une sorte de "Creative Commons du droit des marques", dans le but de renverser la logique, en réservant seulement certains usages et poser largement des libertés. L’entreprise ne me paraissait pas impossible, même si elle est relativement complexe.
Or il se trouve que la Wikimedia Foundation a annoncé hier sur son blog une nouvelle politique de marque extrêmement intéressante, dans un billet intitulé : "Nous lançons une politique de marque non-conventionnelle en faveur de la coopération ouverte".
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le montrer, la Wikimedia Foundation n’est pas propriétaire du contenu de l’encyclopédie collaborative ; elle ne fait que l’héberger et par l’effet de la licence CC-BY-SA sous laquelle il est placé, personne en réalité ne possède de droit de propriété sur le contenu de Wikipédia conçu comme un tout, ce qui en fait un des exemples les plus aboutis de Bien Commun de la Connaissance. Mais la Wikimedia Foundation est par contre titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur la marque Wikipedia, le logo de l’organisation, ainsi que des appellations et des emblèmes des projets satellites de Wikipedia (Wikimedia Commons, Wikisource, etc).
Jusqu’à présent, l’exercice de ces titres de propriété était gouverné par une politique de marque relativement classique (dont l’application avait d’ailleurs pu parfois faire grincer des dents…). Mais la Wikimedia Foundation a décidé de changer d’orientation pour que sa politique de marque "reflète la nature collaborative du projet". L’idée a donc été de produire une politique "centrée sur la communauté" (Community-Centered Trademark Policy) qui me paraît assez proche de l’Open Trademark à laquelle j’avais pu songer.
Cette politique liste trois séries d’usages auxquels s’appliquent des règles différentes.
 La première concerne les usages "libres", avec d’une part des usages autorisés par définition, de par le jeu du droit des marques lui-même (faire des liens hypertexte, rapporter des informations, parler d’un site de Wikimedia, créer des oeuvres littéraires, artistiques ou politiques se rapportant à un site Wikimedia) ou certains usages par les membres de la communauté (organiser un édithathon ou un atelier Wikipedia, former de nouveaux contributeurs, produire des produits dérivés portant la marque Wikipédia, mais sans les vendre).
La première concerne les usages "libres", avec d’une part des usages autorisés par définition, de par le jeu du droit des marques lui-même (faire des liens hypertexte, rapporter des informations, parler d’un site de Wikimedia, créer des oeuvres littéraires, artistiques ou politiques se rapportant à un site Wikimedia) ou certains usages par les membres de la communauté (organiser un édithathon ou un atelier Wikipedia, former de nouveaux contributeurs, produire des produits dérivés portant la marque Wikipédia, mais sans les vendre).
La seconde concerne des usages pour lesquels une licence reste nécessaire, mais selon deux modalités différentes. Pour organiser un événement GLAM (c’est-à-dire lié aux partenariats avec les bibliothèques, archives ou musées) ou un concours de photographies (comme Wiki Loves Monuments), les membres de la Communauté pourront utiliser un système de "Quick Licences", qui consiste à envoyer un mail à une adresse de l’organisation pour la prévenir simplement de la tenue de l’évènement. Pour organiser un évènement plus formel, comme une conférence, pour faire apparaître la marque à la télévision, dans un livre ou au cinéma, ou pour vendre des produits portant cette marque, une licence classique doit être conclue avec la Wikimedia Foundation (on revient alors au jeu classique du droit des marques).
Enfin, il existe une catégorie d’usages que la Wikimedia Foundation interdit, comme par exemple, le fait de créer des sites miroirs qui donnent l’illusion d’être sur le site d’origine (ce qui n’empêche nullement de "forker" Wikipédia, mais pas en s’appropriant sa marque), d’utiliser la marque pour pointer vers des sites qui ne sont pas ceux de Wikimedia ou de donner l’impression que Wikimedia s’associe à des causes sans l’avoir expressément décidé.
On obtient donc une gradation d’usages, du plus ouvert au plus fermé, qui repose en partie sur le même système que ces licences Creative Commons, à savoir accorder des libertés a priori, sans avoir à demander des autorisations préalables, à condition de respecter les principes posés par celui qui accorde la faculté de faire.
On peut relever aussi l’effort réalisé pour traduire graphiquement ces trois cercles d’usages et simplifier les termes employés pour exprimer cette politique, qui là aussi rappelle la démarche des Creative Commons.

Simplification du langage, réduction du nombre de mots, utilisation d’un code- couleurs, autant de moyen de rendre intelligible la politique de marque, qui rappellent les Creative Commons.
On n’est donc pas encore complètement en présence de "Creative Commons du droit des marques", mais la nouvelle politique de Wikimedia constitue ce qui s’en rapproche le plus à ma connaissance. Et ça tombe bien, par cette politique de marque a elle-même été placée sous licence libre, afin de pouvoir être reprise, développée et adaptée. En lui donnant un plus haut niveau d’abstraction et en la simplifiant, on arriverait peut-être à instaurer un système de marque partageable, destinée à favoriser la collaboration ouverte de communautés autour d’un projet. Un tel instrument – des "Open Trademarks" – pourrait sans doute s’avérer utile aux acteurs du mouvement des Biens communs.
En 2013, j’avais participé à un Labolex ouvert par ShareLex à propos des "marques collectives" où nous avions commencé à débroussailler ces questions. La politique de marque de Wikimedia pourrait être une source d’inspiration pour aller plus loin.
Classé dans:Quel Droit pour le Web 2.0 ? Tagged: Biens Communs, Creative Commons, droit des marques, logo, marques, trademark, Wikimedia, wikipédia