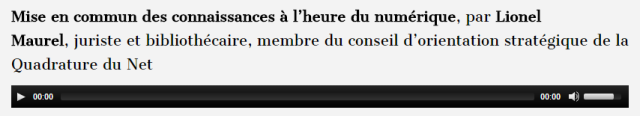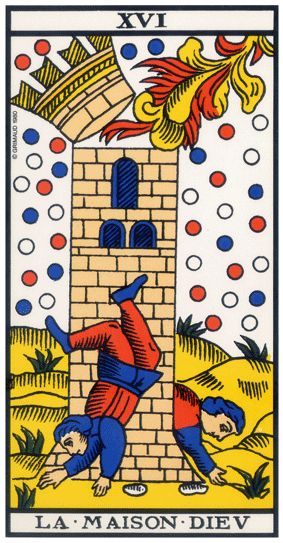What.cd, Zone Téléchargement et l’aveuglement de la répression du partage
lundi 5 décembre 2016 à 21:37La fermeture de Zone Téléchargement la semaine dernière a déclenché une vague de réactions impressionnantes, qui montre que la question du piratage/partage est loin d’être passée au second plan. J’ai du coup été interviewé par plusieurs sites d’information : Konbini, France Info, Libération et encore aujourd’hui par Le Monde. Je n’aurai hélas pas le temps de consacrer un billet détaillé à la question, mais je reposte ci-dessous la retranscription de mes propos effectuée par la journaliste Morgane Tual (merci à elle !).
J’ai simplement modifié et développé plusieurs passages pour les faire mieux correspondre à ce que je voulais dire.

Zone téléchargement : « Les industries culturelles luttent contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés »
Lundi 28 novembre, la gendarmerie nationale annonçait la fermeture de Zone téléchargement, un site qui permettait de télécharger directement des contenus protégés par le droit d’auteur. Une activité qui aurait permis à ses administrateurs, notamment grâce à la publicité, d’engranger plus de 1,5 million de chiffre d’affaires par an selon la Sacem, qui avait porté plainte. Son secrétaire général dénonçait, dans les colonnes du Monde, des « voyous qui se sont enrichis sur le dos des créateurs », et soulignait qu’il n’y avait « plus d’impunité pour les pirates ».
De son côté, Lionel Maurel, membre du conseil d’administration de la Quadrature du Net, une association française de défense des libertés numériques, déplore lui aussi l’existence de sites commerciaux tels que Zone téléchargement, tout en prônant la légalisation du partage. Explications.
La fermeture du site Zone téléchargement a provoqué énormément de réactions indignées de la part des internautes. Quelle a été la vôtre ?
Je n’ai pas été surpris. Les industries culturelles font régulièrement fermer ce genre de sites, tout en sachant que ça ne va pas mettre fin au problème. C’est une fausse solution, car d’autres sites vont immédiatement prendre la place de Zone Téléchargement. Ce n’est qu’un nouvel épisode dans un cycle d’ouvertures et de fermetures qu’on connaît depuis des années. J’avoue que je ressens par contre un peu de lassitude. Les industries culturelles se battent depuis des années contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés.
Des monstres qu’elles ont créés, c’est-à-dire ?
Au départ, le téléchargement s’effectuait essentiellement de manière décentralisé en peer to peer (P2P, de pair à pair), avec logiciels comme eMule, Kazaa, puis les torrents… Ce système ne nécessitait pas d’intermédiaire commercial. Mais les ayants droit ont agi pour réprimer ces pratiques, notamment par l’intermédiaire du système de la riposte graduée mise en oeuvre par la Hadopi [Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet], conçue pour contrer ce type de partage, alors qu’elle est totalement impuissante pour des sites comme Zone téléchargement.
Comme le P2P était dans la ligne de mire de la répression, cela a mécaniquement abouti à faire monter les sites de téléchargement direct et de streaming, qui sont centralisés, et qui permettent à leurs fondateurs de faire beaucoup d’argent. Certains internautes ont comparé Zone téléchargement à une sorte de Robin des bois, qui « prend aux riches pour donner aux pauvres« , mais c’est en fait une vulgaire dérive mafieuse du partage de fichiers. Et de leur côté, les ayants droits mettent dans le même sac des sites comme Zone téléchargement et What.cd.
Justement, le site de partage musical What.cd a été fermé par la gendarmerie nationale le 17 novembre, une dizaine de jours avant la fermeture de Zone téléchargement. En quoi ces deux sites sont-ils différents ?
Ils le sont totalement. What.cd, c’était une communauté privée dans laquelle des gens mettaient en commun leur musique. On n’y entrait que par cooptation : il fallait être invité par un membre, et adhérer à une charte, qui défendait la qualité et la diversité des fichiers échangés. Le but était d’accéder à de la musique rare, et même si des dons étaient acceptés pour financer des serveurs, les gens à l’origine de What.cd ne faisaient pas de profit. Un système de ratio était imposé qui empêchait les utilisateurs de se « gaver », en les incitant à enrichir la base. Pour pouvoir télécharger, il fallait partager des musiques qui ne figuraient pas déjà dans le catalogue de What.cd. Participer à cette communauté nécessitait donc un véritable investissement intellectuel. Et au final, les utilisateurs avaient réussi à constituer au fil du temps une des bibliothèques musicales les plus riches au monde, où l’on pouvait trouver toutes sortes d’enregistrements rares qui ne figurent dans aucune offre légale.
Zone téléchargement, ce n’est pas du tout ça. Ce type de sites existent pour satisfaisaire des besoins de consommation de masse de façon faussement gratuite – puisqu’il fallait regarder de la publicité. La philosophie était donc complètement différente.
Quelle est la bonne solution, selon vous ?
Ce qu’on veut depuis le début, c’est la légalisation du partage entre individus, en peer to peer, non centralisé et sans but de profit. Dans ce système, un site comme Zone téléchargement resterait illégal, tout comme le serait d’ailleurs la mise à disposition d’oeuvres protégées sur une plateforme comme YouTube. C’est légitime de fermer Zone téléchargement, car il s’agit de contrefaçon commerciale et l’action intentée par les ayants droit s’est déroulée dans le cadre d’une procédure judiciaire, apportant la garantie de l’intervention du juge.
Ce que nous proposons, c’est une légalisation du partage non-marchand, couplée à une redevance levée sur l’abonnement Internet des foyers, de l’ordre de 4 ou 5 euros par mois, afin que cela constitue une nouvelle forme de financement mutualisée pour la création. C’était l’idée originale de la licence globale que nous avons adaptée et que nous préférons appeler « contribution créative ». Mais à chaque fois qu’on essaie d’en discuter avec les ayants droit, on nous caricature, ils nous disent qu’on veut légaliser toutes les formes de partage. C’est faux !
La situation peut-elle évoluer ? Y a-t-il des signes en ce sens ? Et l’offre légale apporte-t-elle une amélioration ?
Il n’y a aucune raison que ça ne continue pas comme avant. La Sacem, par exemple, est très agressive. Elle s’en prend sans distinction à toutes les formes de partage, y compris à celle qui restent dans la sphère du non-marchand. Et c’est grave, car quand des sites comme What.cd ferment, les gens prennent l’habitude d’aller sur des sites de contrefaçon marchande, ils s’habituent aux pubs, ils ne participent à aucune communauté d’amateurs… La situation n’est pas réjouissante, car la guerre au partage menée par les ayants droit a dramatiquement réduit les pratiques réellement non-marchandes, en poussant les gens vers les sites mafieux.
Quant à l’offre légale, elle peut coexister avec le partage non marchand. C’est déjà très largement le cas pour la musique, où des offres de streaming de type Deezer ou Spotify ont réussi à trouver leur public, malgré le maintien à un niveau élevé des pratiques d’accès illégal aux oeuvres. Mais au niveau du cinéma, on n’y est pas du tout : les prix sont très élevés, la chronologie des médias en France reste la plus longue d’Europe et le catalogue est trop restreint… Tout cela favorise des sites comme Zone téléchargement.
Quelle philosophie sous-tend le « partage », mot que vous préférez à « piratage » ?
L’effet le plus intéressant du partage est l’élargissement de la gamme des oeuvres qui bénéficient de l’attention du public. Le partage décentralisé valorise des œuvres qui ne sont pas mises en avant par la distribution commerciale, celles qui forment ce que l’on appelle la « Longue Traîne ». Cette forme d’accès aux oeuvres élargit donc la diversité culturelle. Pour les gens qui partagent ainsi, ce n’est pas seulement une manière de consommer, c’est aussi une façon d’apprendre des autres, d’enrichir leurs goûts, de se forger une culture. Ce n’est pas ce qui se passait sur Zone téléchargement, qui se focalisait sur les derniers blockbusters.
Pour faire valoir ce type d’arguments, il aurait fallu pouvoir en discuter sereinement, mais en France depuis plus de 15 ans, cela n’a jamais été possible, on amalgame tout. Au début du quinquennat, nous avons un moment pensé que le débat était possible. Le candidat Hollande annonçait vouloir abroger la loi Hadopi et la remplacer par une grande loi culturelle. La question de la légalisation du partage a été abordée lors des consultations qui ont servi à élaborer le rapport Lescure. Mais très vite, le sujet a été politiquement enterré. La Sacem et les autres sociétés d’ayants droit ont littéralement « pilonné » le gouvernement pour que la question ne puisse plus être mise en discussion.
Avec la contribution créative que vous soutenez, comment pourrait-on rétribuer les créateurs, notamment les plus petits ?
Tout le problème, c’est d’arriver à ce que la répartition de la rémunération soit moins concentrée qu’elle ne l’est actuellement. Aujourd’hui par exemple, une toute petite minorité des sociétaires de la Sacem touche la majorité des sommes et le schéma est grosso modo identique dans tous les secteurs de la création. Nous voudrions que les règles de répartition soient revues, et c’est une des raisons pour lesquelles les ayants droit ne veulent pas mettre le sujet sur la table. Il faut prendre en compte le fait qu’Internet a permis à un nombre plus important d’individus de créer et de diffuser des oeuvres. Pour répartir équitablement les revenus, il faudrait donc « lisser » la courbe, par exemple en faisant en sorte que si vous êtes cent fois plus vus que d’autres artistes, vous ne touchiez que dix fois plus. Mais dans un tel système, les gros doivent accepter de lâcher beaucoup plus au bénéfice des petits. Or, les sociétés de gestion des droits d’auteur sont tenues par ceux qui en bénéficient le plus.
Quant aux petits, qui parfois soutenaient cette démarche, il est aujourd’hui difficile de leur faire entendre ce genre d’idées. Leur précarité s’est accrue et ils voient Internet comme quelque chose qui les fragilise. La peur de perdre le peu que leur rapporte les droits qu’ils touchent l’emporte souvent sur l’espoir de pouvoir changer le système.
C’est un combat isolé ?
Si demain vous organisez un référendum sur la légalisation du partage, vous pouvez être certain que la réforme serait adoptée ! Regardez la réaction des gens après la fermeture de Zone téléchargement ; les sondages d’opinion à propos de la Hadopi vont dans le même sens, car cette institution reste profondément détestée… C’est la même chose que la prohibition de l’alcool dans les années 1920 : socialement, les pratiques de partage ne sont pas condamnées. La loi va contre les mœurs et c’est toujours une situation profondément malsaine.
Je pense que la légalisation du partage finira par arriver, même si c’est un combat de longue haleine. Cela se fera peut-être dans dix ou vingt ans. En revanche, l’idée de la contribution créative n’est pas très populaire. Mais la question de la rémunération de la création est cruciale et elle doit rester au coeur du débat. Il faut repenser les modalités de cette rémunération, mais certainement pas la supprimer.
PS : juridiquement, je n’ai pas la possibilité de republier ici mes propres propos, car ils sont justement couverts par les droits du journal Le Monde du fait de la retranscription effectuée par la journaliste. Mais je tenais que ce blog garde la trace de ces débats autour de Zone Téléchargement et je ne fais par cette reprise qu’illustrer ce que je défends : le droit au partage non-marchand.
Classé dans:Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: échanges non-marchand, droit d'auteur, légalisation, partage, piratage, what.cd, Zone téléchargement