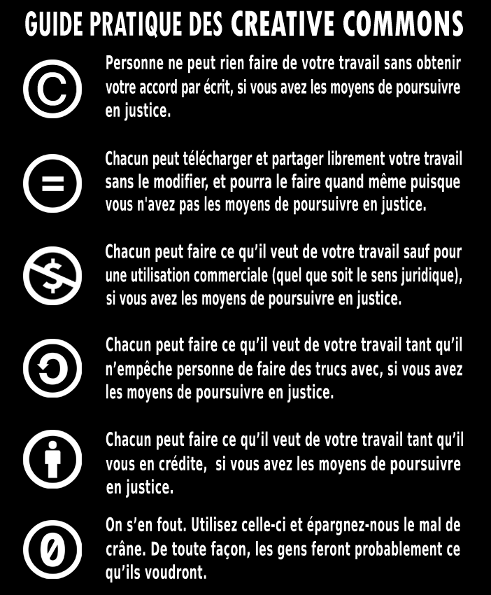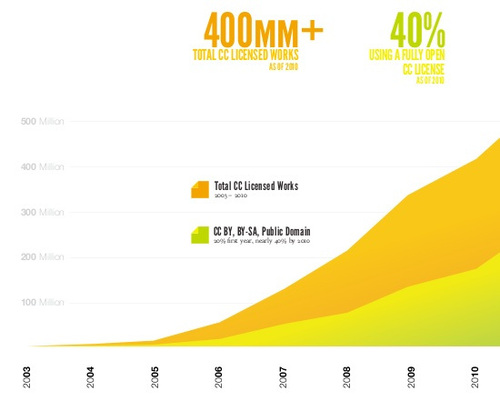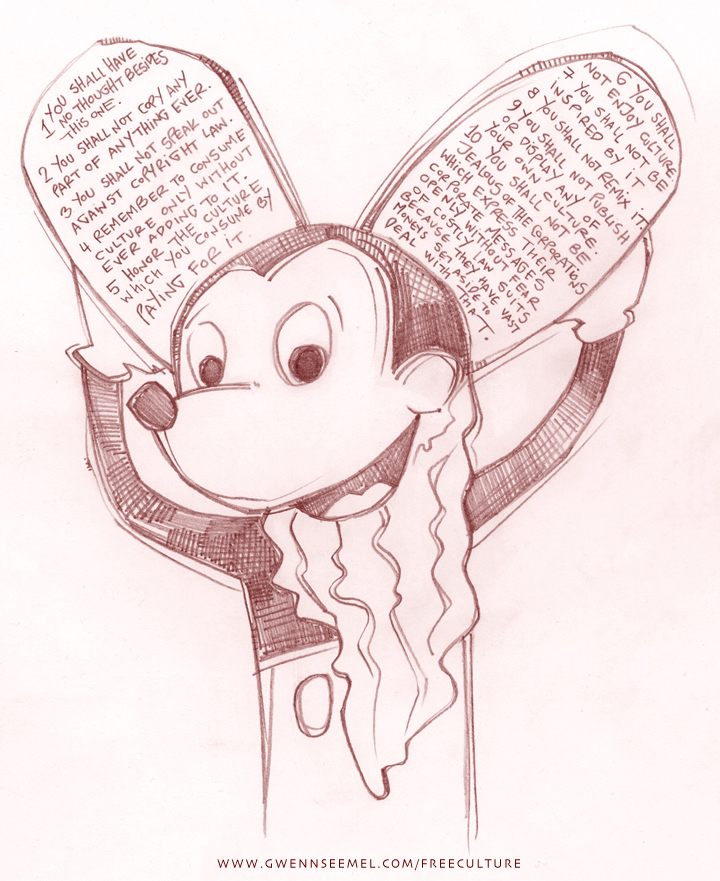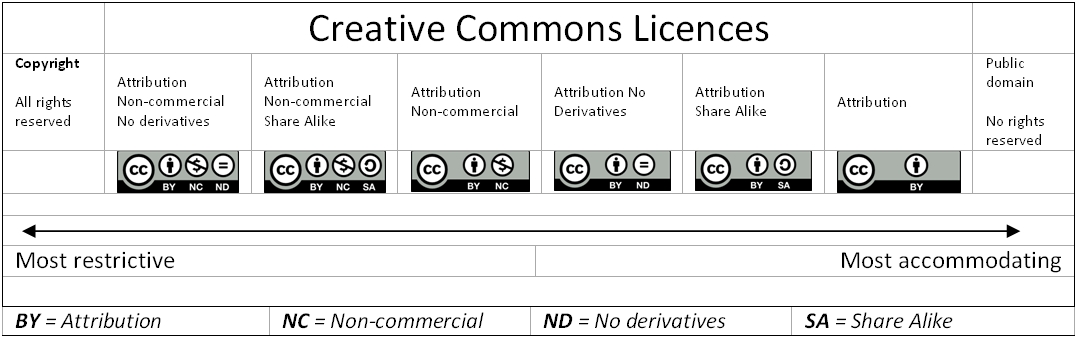Richard Prince et la loyauté de l’usage transformatif
dimanche 28 avril 2013 à 09:14L’artiste contemporain Richard Prince, célèbre pour la manière dont il s’approprie de manière spectaculaire et souvent controversée des oeuvres préexistantes, a remporté cette semaine un procès qui l’opposait au photographe Patrick Cariou.
Ce jugement rendu aux Etats-Unis est important, car il précise les frontières du fair use (usage équitable) dans un sens favorable à la réutilisation des oeuvres protégées pour un usage transformatif. Mais s’agissant d’un artiste comme Richard Prince, il ouvre aussi peut-être la porte à des formes d’usage "déloyal" des oeuvres, car ce ténor de l’art contemporain n’est pas réputé pour son "fair play" envers les artistes auxquels il emprunte des oeuvres pour ses propres créations.

A gauche, une des photographies originales de Patrick Cariou. A droite, ce qu’en a fait Richard Prince.
En matière d’usages transformatifs (ceux de l’art contemporain, mais aussi les mashup et remix sur Internet) où fixer la limite et comment réorganiser les règles du droit d’auteur pour favoriser la réutilisation, sans pour autant sacrifier les principes élémentaires du respect dû à autrui ? Ce procès permet de se pencher sur cette question épineuse, dans la perspective particulière du droit américain, mais aussi en interrogeant la rigidité du droit français, qui fonctionne selon des principes différents.
Échec au Prince en première instance
Richard Prince a réutilisé pour réaliser une série de peintures et de collages intitulée Canal Zone des photographies de Patrick Cariou tirées du recueil Ya Rasta, sur lequel il a visiblement travaillé pendant 10 ans pour aller photographier des Rastafaris en Jamaïque. En première instance l’an dernier, Richard Prince avait été condamné devant les juges de manière assez cinglante, qui l’avaient reconnu coupable de contrefaçon et avaient même ordonné la destruction de ses oeuvres.
Il faut dire que la superstar de l’art contemporain avait justement joué au "Prince" et s’était montré particulièrement arrogant lors de l’audience. Richard Prince a aucun moment n’avait pris la peine de créditer Patrick Cariou comme auteur des photographies originales et pendant le procès, il a continué à refuser de prononcer son nom, en le désignant seulement par un "him" méprisant…
Mais Prince s’était juridiquement tiré une balle dans pied par cette attitude hautaine, car il avait aussi refusé d’invoquer le fair use pour se défendre, en prétendant que son art ne "véhiculait aucun message" et qu’il n’avait pas eu l’intention de faire spécialement un usage "transformatif" des oeuvres de Cariou.
Les juges de première instance l’avaient alors condamné en estimant que le fair use nécessitait d’une manière ou d’une autre de "commenter, se référer au contexte ou se référer de manière critique aux oeuvres originales", un peu à la manière dont fonctionne en France notre exception de courte citation ou l’exception de parodie, pastiche ou caricature.

Autres images extraites de la série Canal Zone de Richard Prince.
L’usage transformatif et ses limites
Le problème, comme le souligne très bien le site Techdirt, c’est qu’une telle conception du fair use, aurait fortement limité le champ d’application de la notion, en la rabattant sur des usages de type commentaires, critiques et parodies. Face à cette conception restrictive, les juges d’appel ont réaffirmé que le fair use permet bien les usages transformatifs au sens propre :
La loi n’impose pas qu’une oeuvre constitue un commentaire sur l’original ou son auteur pour être considérée comme transformative et une oeuvre secondaire peut être reconnue comme un usage équitable même si elle vise d’autres buts que ceux inscrits dans la loi (critique, commentaire, information, enseignement, études et recherche). Au lieu de cela, la Cour Suprême ainsi que les décisions d’autres cours de justice ont insisté, pour retenir la qualification d’usage équitable, sur le fait qu’une oeuvre transformative devait modifier l’original de manière à produire une nouvelle expression, un nouvelle signification ou un nouveau message.
Les juges ont alors appliqué ces principes aux collages et peintures produits par Richard Prince à partir des photographies de Cariou, pour en conclure qu’il s’agissait bien d’un usage transformatif :
Ces 25 créations de Prince manifestent une esthétique entièrement différente de celles des photographies de Cariou. Là où Cariou a produit des portraits et des paysages sereins et délibérément équilibrés, traduisant la beauté naturelle des Rastafaris et de leurs lieux de vie, les oeuvres crues et discordantes de Prince sont au contraire nerveuses et provocantes.
Mais les juges ont dans le même temps indiqué que toute forme de modification ne suffisait pas pour que l’oeuvre soit "transformative" :
Nos conclusions ne doivent cependant pas être interprétées comme suggérant que le moindre changement apporté à des photographies serait suffisant pour constituer un usage équitable. Une oeuvre dérivée peut modifier l’original sans être "transformative". Par exemple, une oeuvre dérivée qui se contente de reprendre les mêmes contenus, mais en les présentant sous une autre forme façon, comme la publication en livre du synopsis d’une émission de télévision, n’est pas "transformative".
Les juges américains introduisent par là une distinction intéressante entre l’adaptation (passage d’une oeuvre d’un média à un autre), qui relève pleinement du monopole reconnu à l’auteur parce qu’elle "parasite" son exploitation, et la transformation qui peut être couverte par le fair use. Néanmoins, le maniement de tels critères s’avère complexe à l’usage, car dans cette affaire, les juges admettent que pour 5 oeuvres de Richard Prince, ils ne sont pas en mesure de déterminer "avec certitude" si les modifications apportées aux photographies sont suffisantes pour établir si l’oeuvre est transformative (c’est notamment le cas pour la première image qui illustre ce billet).

Intéressant montage, qui a laissé uniquement les ajouts de Richard Prince sur une des photographies de Patrick Cariou. Nouvelle transformation par soustraction cette fois…
Une approche plus ouverte que celle du droit français
Il est intéressant de mettre cette décision en relation avec les principes du droit français et de réfléchir à ses répercussions sur les pratiques numériques de transformation, comme le remix ou le mashup.
Ce qui est particulièrement remarquable avec le fair use américain, c’est qu’il accorde une prime à la créativité, justement grâce à cette notion d’usage "transformatif". Ce que les juges cherchent à savoir, c’est si le réutilisateur a produit quelque chose de nouveau, qui n’entrera pas en concurrence directe avec l’original, y compris d’un point de vue économique. Les juges ont d’ailleurs rappelé dans cette décision que le fair use n’exclut pas l’usage commercial et que l’usage transformatif admet l’emprunt de larges portions d’une oeuvre.
En France, la situation est complètement différente, puisque la transformation d’une oeuvre sera au contraire considérée dans la plupart des cas comme une altération violant le droit moral de l’auteur, et notamment son droit au respect de l’intégrité de son oeuvre. Le droit de citation est limité à l’emprunt de courts extraits et il doit viser des buts précis (critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information), parmi lesquels ne figure pas la finalité purement créative. L’exception de parodie, pastiche ou caricature existe également, mais elle recouvre seulement certains usages créatifs, qui par exemple, ne correspondent sans doute pas à ce qu’a fait Richard Prince avec les photographies de Patrick Cariou.
La parodie, la caricature ou le pastiche sont par ailleurs adaptés pour certains types de remix ou de mashup, mais c’est loin d’être le cas pour tous. Par exemple, la vidéo ci-dessous est un petit film d’animation de 60 secondes qui condense tout l’épisode IV de Star Wars.
Malgré l’humour dont elle fait preuve, cette vidéo ne constitue pas selon moi une parodie, un pastiche ou une caricature et je doute fort qu’un juge français puisse la considérer comme légale. C’est la raison pour laquelle je trouve que l’approche par l’usage transformatif du droit américain est excellente, dans la mesure où elle pourrait servir de fondement aux nouvelles formes de la créativité numérique.
Quelles conditions pour un usage loyal des oeuvres ?
Néanmoins, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans le fait que les juges aient pu estimer que Richard Prince avait fait un usage "équitable" des oeuvres de Cariou. On a l’habitude de traduire fair use par usage équitable, mais aussi par usage "loyal". Or l’attitude de Richard Prince n’a pas été à mon sens "loyale" envers Patrick Cariou, d’abord parce qu’il a omis de le créditer comme auteur des originaux réutilisés, mais aussi par son attitude méprisante lors du procès.
Le droit français pour le coup comporte des obligations qui sont à même de garantir un minimum de fair play en cas de réutilisation des oeuvres, et notamment l’article L.122-5 indique que les exceptions de courte citation et de parodie ne peuvent s’exercer que : "Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source".
Finalement en mélangeant la notion d’usage transformatif tirée du droit américain, tout en maintenant les marques de respect pour l’auteur original qui figurent dans le droit français, n’arriverait-on pas à un régime équilibrée et apte à épouser les contours des nouveaux usages numériques ?
Classé dans:Penser le droit d'auteur autrement ..., Regards d'ailleurs, regards ailleurs (droit comparé et actualités internationales) Tagged: courte citation, exceptions, fair use, mashup, parodie, patrick cariou, réutilisation, remix, richard prince
![]()